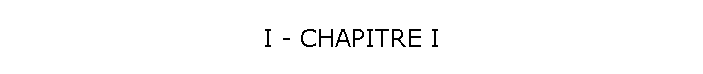|
|
|
|
PREMIÈRE PARTIE : ANTICIPATIONS
CHAPITRE PREMIER : ISABELLE BELLINZAGA, ACHILLE GAGLIARDI ET LA CHARTE DE L'AMOUR
Nous avons exposé maintes fois dans nos précédents volumes, et plus longuement dans notre Métaphysique des Saints, la charte de l'amour qui a réglé la religion du grand siècle ; charte sublime et simple, où se fondent en une synthèse vigoureuse la tradition augustinienne attendrie par saint Bernard, la théologie médiévale, enfin la psychologie plus subtile et les consignes plus mortifiantes des mystiques modernes. Au seuil du présent volume où je dois raconter les batailles incessantes qui se sont livrées, pendant tout le XVII° siècle, autour de cette charte fondamentale, peut-être n'est-il pas inutile que je dénonce une fois de plus le contresens qui a éternisé la querelle et qui offusque aujourd'hui encore, un trop grand nombre d'esprits, même parmi ceux à qui devraient être familiers les principes essentiels du christianisme. Car, pour les autres, il nous faut renoncer à les éclairer sur ce point. Comment les amener enfin à comprendre que l'oraison n'est pas un hachisch vaguement céleste, ni l'amour une de ces voluptés où la chair a autant de part que l'esprit; oubli de soi au contraire, dépouillement, anéantissement, sacrifice total, « inclination universelle », dit le P, Guilloré, et pressante et quasi automatique « à faire et à souffrir tout limaginable (1) ». On leur reprocherait avec plus d'apparence de trop daigner les joies
(1) Guilloré, Conférences, pp. 159-160. Cf. Mon Introduction à la philosophie de la prière, pp. 99, seq.
4
affectives, les « divins plaisirs » de la prière et de trop identifier l'amour à la croix. Mais ce reproche, répondraient-ils avec le P. Chardon, il faudrait l'adresser d'abord au Christ lui-même, qui proposito sibi gaudio sustinuit crucem, et dont la vie, plus encore que les paroles, nous enseigne que l'amour est abnégation, que l'abnégation est amour (1). Ainsi l'exige, du reste, le dogme de la grâce sanctifiante. D'une part en effet, comme dit Bérulle, « l'état de vie que nous recevons par la grâce de Jésus-Christ étant une sorte de vie non en nous, mais en autrui, il nous faut délaisser nous-mêmes pour entrer en cette vie » ; et d'autre part, cette vie « que nous recevons de lui... ne respire que croix et abnégation ». « Cette mort donc est vie, cette abnégation est possession (2).» En dehors des ouvrages plus récents et plus parfaits que nous connaissons déjà -
(1) Cf. Métaphysique des Saints, II, pp. 32 seq. (2) Oeuvres complètes de Bérulle (éd. Bourgoing, 1665), CXXXe élévation, pp. 653-655. (3) Par une étrange rencontre qu'autrefois on eût jugée miraculeuse, nous nous sommes mis simultanément quatre ou cinq, et sans nous être donné le mot, à ressusciter le Breve Compendio. Le R. P. Viller nous a gagnés de vitesse, son étude sur l'Abrégé de la perfection de la Dame Milanaise, ayant paru dans le numéro de janvier 1931 de la Revue dAscétique et de Mystique. Je l'ai suivi dare-dare d'un pied non boiteux, dans la Vie spirituelle de février et de mars 1931: deux articles qui ont pour titre : Bérulle quiétiste, ou Gagliardi? Avant même qu'eût paru le second de ces articles, M. J. Dagens, professeur à l'Université de Nimègue, publiait, dans le n°2 (1931) de la Revue d'Histoire ecclésiastique, ses notes sur la source du Bref Discours de l'Abnégation intérieure. Puis ce fut dans le numéro d'avril 1931 de la Revue dAscétique et de Mystique, l'article de Don Giuseppe de Luca : Quelques manuscrits romains sur Gagliardi. De ces quatre thaumaturges, il va sans dire que je suis de beaucoup le moins érudit. Jusqu'aux révélations du P. Viller, je ne connaissais du Breve Compendio que sa fortune de ce côté-ci des monts. J'ignorais tout du versant italien et tout ce que je sais aujourd'hui, soit de la Darne Milanaise, soit du P. Gagliardi, je le dois au P. Piller et à Don Giuseppe de Luca. Aussi bien cet épisode est-il encore mal connu, mais du point de vue où je me place, la plupart des problèmes que pose le Breve Compendio n'ont pas d'importance.
5
I. - Ce petit livre - Breve Compendio intorno alla perfezione cristiana, - nous arrivait d'Italie. Je n'ai pas qualité pour éclaircir les mystères dont sa naissance reste enveloppée et qui, d'ailleurs, n'intéressent pas la grande histoire. Qu'il nous suffise de savoir qu'il est dû à la collaboration d'une « dame Milanaise » et du fameux jésuite Achille Gagliardi (1537-16o7). La milanaise, Isabelle Christine Bellinzaga, née vers 1552, est morte à Milan en 1624, « avec une grande réputation de sainteté ». N'était qu'un siècle les sépare l'une de l'autre, on la prendrait pour une soeur de Mme Guyon. Sa grand'tante du moins ou son double. La parenté saute aux yeux ou la ressemblance. Même doctrine comme nous verrons, mêmes vertus, mêmes manies. Je ne parle bien entendu que de ce qui paraît au dehors, car ni de l'une ni de l'autre nous ne connaissons les derniers secrets. Chez toutes les deux un même attrait pour la « maternité spirituelle », mais avec cette particularité peu banale que les Fénelons et les Beauvilliers d'Isabelle appartiennent à la Compagnie de Jésus. Qu'avec Bossuet on se moque de ces femmes tant qu'on voudra et au risque d'éclabousser la mère spirituelle de Jean de la Croix, mais qu'on avoue du moins qu'elles ne manquent pas d'un certain discernement. Fénelon d'un côté, Gagliardi de l'autre, il y a moins exquis. Hélas, ne seraient-ce pas, d'aventure, ces heureux choix qu'on leur pardonne le moins. Si elles avaient montré plus de faveur à telles âmes vulgaires, à tels intrigants qui n'eussent demandé qu'à se mettre sous leur conduite et qu'à exploiter leur prestige, on les aurait peut-être moins persécutées l'une et l'autre. Isabelle morte, les jésuites italiens qu'elle avait trop aimés, ou d'un amour trop encombrant, semblent s'être appliqués à tenir cette chandelle- ou ce candélabre - sous le boisseau.
6
Les inédits assez nombreux qui la racontent, notamment la biographie enthousiaste qu'avait commencée le P. Gagliardi, c'est néanmoins un savant jésuite d'aujourd'hui qui nous les a mis sous les yeux. L'histoire vraie n'épouvante pas le R. P. Viller. Loyalement, il nous livre tout ce qu'il a pu rassembler sur Isabelle, sauf à la bousculer quelque peu, comme il en a certes le droit. Pour moi qui ne la connais que par lui, je serais moins rude à la sainte d'Achille Gagliardi, une longue expérience m'ayant appris que, dans le petit monde spirituel, les persécutés ont presque toujours raison, ou que, même lorsqu'ils se trompent, ils restent beaucoup plus dignes d'intérêt que ceux qui les persécutent. Je crois l'entrevoir moins vive, moins souple, moins séduisante, moins femme en un mot que Mme Guyon, mais avec autant d'intelligence - et c'est beaucoup dire - distante, rigide, impérieuse, plus sensée. Illuminée peut-être, mais qu'en savons-nous? peut-être aussi comblée des grâces les plus sublimes. Unicuique in arte sua credendum est. Avant de prendre en faute un spirituel aussi éminent que Gagliardi - ou que Fénelon - il faut y regarder à deux fois. Comme Mme Guyon, elle vivait dans le monde, mais non pas sur les routes. « Femme de tête, nous dit le P. Viller, elle avait de tels dons pour l'administration et des qualités si universellement reconnues pour le gouvernement que plus d'une fois le saint cardinal Borromée se servit d'elle pour la gérance des hôpitaux et des monastères. C'est un beau titre de gloire d'avoir été l'auxiliaire de saint Charles. » Bien entendu, et, au surplus, un nouveau préjugé en faveur de Gagliardi. Mais parmi les ténèbres où nous sommes, notre critique doit serrer de plus près ,les miettes d'indices qui nous restent. Ainsi appelée à maintenir ou à rétablir l'ordre dans les hôpitaux, et, qui plus est, dans les monastères de Milan, cette femme énergique n'aurait-elle pas irrité certaines personnes dévotes dont il lui fallait ou corriger les erreurs, ou paralyser l'influence, ou brider les convoitises! Ce n'est là qu'une conjecture, mais fort
7
vraisemblable ; elle éclaire peut-être l'origine des animosités qui, de très bonne heure, se sont déchaînées et liguées contre Isabelle. Un autre document, moins imprécis, et dont le P. Viller qui nous l'apporte ne semble pas avoir mesuré la portée, nous conduit, si je ne me trompe, au foyer principal où s'organisaient les complots contre Isabelle. En 1584, elle prononce les trois voeux de religion, mais d'une façon peu commune puisqu'elle s'engage, par son voeu d'obéissance, à suivre la direction de la Compagnie. Ce voeu, ajoute le P. Viller, « n'était que la confirmation d'une situation de fait existant depuis 1579. Cette année-là, à la suite de la visite du P. Sébastien Morales, chargé de faire une enquête sur la dame (on l'avait calomniée auprès du Général), Everard Mercurian, s'appuyant sur le rapport très favorable de son visiteur, avait accepté Isabelle « comme fille de la Compagnie de Jésus et sous l'obéissance des Pères (1) ». Lors de cette affiliation, Isabelle n'avait pas encore trente ans. Cette faveur, que le P. Viller déplore comme contraire à l'esprit de saint Ignace, nous étonne un peu ; mais combien davantage la démarche qui l'a précédée, et qui parait toute naturelle au P. Viller, je veux dire ce visiteur, envoyé de Rome par le général de la Compagnie pour enquêter sur une dame de Milan, soupçonnée, d'ailleurs très injustement, de nous ne savons quelles incartades: Si les méchants bruits qui sont arrivés jusqu'à Mercurien lui paraissent avoir quelque fondement, son zèle ne devrait-t-il pas se borner à mettre l'archevêque, saint Charles Borromée, en garde contre la dangereuse Isabelle ? Qui ne sent donc et c'est ce que le P. Viller aurait dû remarquer avant nous - que si le prudent général a cru devoir intervenir dans cette affaire, c'est d'abord qu'Isabelle lui aura été dénoncée par plusieurs jésuites de Milan, c'est qu'ensuite et plus encore lui auront été dénoncés en même temps d'autres jésuites de la même ville intimement mêlés aux prétendus scandales
(1) Viller, op. cit., pp. 77-79.
8
dont on demandait la répression. D'où je conclus que, dès 1579, c'est-à-dire bien avant que Gagliardi ait connu Isabelle et l'ait orientée sur les hautes voies de la mystique, les jésuites de Milan se querellent au sujet de cette femme ; les uns la vénèrent au point de vouloir qu'elle soit affiliée à la Compagnie, les autres la détestent si fort que, pour la détruire, ils l'accusent solennellement et, nous le savons, calomnieusement, des fautes les plus graves. Entre les deux, il est au moins permis d'hésiter. Plus tard, quand recommenceront les manoeuvres contre Isabelle et ses disciples, nous ne nous hâterons pas de croire à la probité de ses ennemis. On ne peut pas dire : qui a empoisonné, empoisonnera, mais il est prudent d'envoyer d'abord au laboratoire la coupe que présente, pleine d'eau bénite, un ancien empoisonneur. Il me parait d'ailleurs certain que les jésuites ne sont pas seuls à batailler pour ou contre cette femme. Elle a des ennemis - un Père capucin notamment - et des fidèles, également passionnés, religieux, prêtres séculiers, laïques, assez nombreux sans doute et puissants, dans toute la région milanaise. Aux érudits de débrouiller cette longue aventure qui fit presque autant de tapage que celle de Mme Guyon. Supérieur de la maison professe de Milan depuis les premiers jours de 1584, - il le restera dix ans - c'est probablement vers cette date qu'Achille Gagliardi aura fait la connaissance ou sera entré dans l'intimité d'Isabelle Bellinzaga. Presque aussitôt il fut fasciné. Fénelon, moins candide, pour ne pas dire moins naïf, résistera plus longtemps aux instances de Mme Guyon. Comment s'y prit-elle ? Nous l'aurions deviné sans peine, car elles ont toutes le même secret, mais Gagliardi s'est expliqué à ce sujet avec un détail et une chaleur qui nous rendent sensible la méthode, classique ou banale, je le répète, de ces enveloppements. Cette âme, écrira-t-il plus tard, lorsqu'il lui faudra se défendre de s'être laissé diriger par sa pénitente au lieu de la diriger,
9
cette âme a un don particulier de pénétrer les coeurs et de savoir leur état dans les choses spirituelles, et, s'ils veulent, de les amender et de les pacifier d'une façon dont elle a donné des preuves merveilleuses... Les exemples des autres ne manquent pas ici. Pour moi, en ceci qui touche au propre coeur et à l'intime du Christ, j'ai une telle évidence que, quand je pense à ce que le Seigneur a opéré en moi par un tel moyen, j'en reste vraiment comme étourdi. Et ceci est arrivé en moi et en d'autres, non point parce que nous nous sommes laissés gouverner par elle; je n'entends d'aucune façon tirer cette conséquence;
lire dans une âme, comme dans un livre ouvert; gouverner cette âme, Gagliardi, habitué aux précisions scolastiques, estime que cela fait deux;
.., mais parce que, dans les choses qui touchent à nos défauts et aux remèdes nécessaires pour les guérir, nous l'avons écoutée avec attention; nous nous sommes humiliés devant Dieu, et nous avons trouvé en pratique que ses avis étaient les meilleurs, estimant l'aide que nous procuraient ses prières, avec beaucoup de simplicité et de sûreté. Nous avons découvert par des résultats évidents qu'elle pénétrait l'intime de nos coeurs, ce qui ne pouvait venir que de Dieu.
Là serait pour nous, et là seulement, le point faible de cette apologie. Mais Gagliardi pensait, avec tous ses contemporains, qu'un tel don de clairvoyance dépassait les forces de la nature. Il y fallait une intervention directe ou de Dieu ou du démon. Or, pensait-il encore, puisque ces lumières me sont bonnes, ne me sont que bonnes, comment viendraient-elles du mauvais?
C'est pourquoi, avec actions de grâces, nous avons accepté le tout, de peur de perdre un don et une faveur très grande, si nous le repoussions ou en faisions fi. Et dans une chose aussi importante, il semble que le fait de nous sentir découverts jusqu'au plus profond de notre âme a été le remède efficace qui nous a obtenu la grâce d'une rénovation sincère de la tète aux pieds avec une grande stupeur. Dites-le, vous, mes frères, si cela est vrai, si vous l'avez éprouvé, ou si c'est seulement imagination pure (1).
(1) Viller, op. cit., pp. 85-86. Sauf une ou deux retouches de style -pacifier au lieu d'apaiser - je transcris telle quelle, non sans maugréer, la traduction du P. Viller.. On aurait pu, je croie, rendre en un français moins épineux le latin de Gagliardi. Mais le P. Viller, exaspéré par la naïveté de ce malheureux, n'a pas manqué cette occasion de l'égratigner une fois de plus.
10
Pauvre Gagliardi! Qu'on lui pardonne de ne pas mieux raisonner que la Samaritaine : Venite et videte hominem qui dixit mihi omnia quaecumque feci ; numquid ipso est Christus (1) ?
II. - Aussi bien, comme il le rappelle avec insistance, Gagliardi n'est-il pas le seul jésuite que l'araignée mystique de Milan ait pris dans ses toiles. Semblable à plusieurs autres, écrit encore le P. Viller, tout scandalisé, voici « un fait, raconté par le P. Jean-
Ne croirait-on pas qu'il a sous les yeux, en écrivant, la lettre de Gagliardi qu'on a lue plus haut? Cent ans plus tard, Fénelon ne parlera pas autrement quand il expliquera le facile mystère de ses relations avec Man Guyon. « Le résultat, conclut le P. Viller: Vipera fait les Exercices sous la direction du P. Gagliardi et il en sert tout transformé. » Que cette lettre de Vipera est précieuse, et cet épisode ! Nous y saisissons sur le fait l'action conjuguée d'Isabelle et de Gagliardi, nous y apprenons aussi qu'après tout l'aventure
(1) Jean, IV, 29.
11
a tourné le mieux du monde. Religieux assez médiocre ou divisé jusque-là, Vipera, grâce à Isabelle, a fait le pas, a coupé les ponts. Le P. Viller qui n'aime pas les araignées mystiques ne sait trop que penser de ce changement. Si, accorde-t-il, Isabelle « s'était contentée de convertir des particuliers, le mal n'eût sans doute pas été bien grand - rien qu'un tout petit mal, n'est-ce pas? - encore qu'il soit difficile d'admettre qu'une femme puisse, sans illusion, exercer le rôle d'un véritable directeur (1) ». Remarquez, je vous prie, le primesaut involontairement, inconsciemment crispé de ces dernières lignes; l'odeur de soufre qu'y dégagent les piteuses syllabes de femme. Poussées jusqu'au paroxysme, des réactions de ce genre vont jouer sans relâche dans la guerre de cent ans que nous racontons. Comme il vous plaira, mais enfin puisqu'iI était bon que Vipera fût converti, voire par une femme, n'a-t-il pas fallu pour en venir à cet heureux terme, que, d'une manière ou d'une autre, cette femme l'ait « dirigé ? » Rien ne prouve, d'ailleurs, qu'Isabelle ait manqué à la discrétion qui s'impose en de pareils cas. On ne voit pas qu'elle ait revêtu ni le surplis ni l'étole. Au contraire, sa proie à peine gagnée, elle la « dirige » sur Gagliardi. Parce qu'elle n'était qu'une femme, Lacordaire n'aurait-il dû parler à Mme Swetchine que de la pluie ou du beau temps? L'histoire des âmes est pleine de ces rencontres parfois lamentables, parfois ridicules, mais aussi et le plus souvent divines. Lorsque l'on est réduit à ne pas sentir en soi-même la présence et l'action de Dieu, on cherche instinctivement autour de soi, on appelle un de ces êtres privilégiés en qui se reflète cette action, cette présence, en qui l'on puisse voir « comme au travers de quelques petites fentes, disait le P. Surin, la lumière de l'autre vie ». Il est souverainement bon de se tenir en silence auprès d'elles, de les écouter, pleines qu'elles sont d'une science que les livres n'apprennent pas, et dont les
(1) Viller, op. cit., p. 82.
12
hommes n'ont pas le monopole. Un jour, écrit en ricanant l'auteur d'un pamphlet contre Fénelon,
un jour que la Maisonfort marquait quelque peine à croire ce que Mme Guyon lui disait sur les voies intérieures, l'abbé de Fénelon répondit : « Mme Guyon doit être crue sur cela; elle en a l'expérience. Ce n'est qu'une femme, mais Dieu révèle ses secrets à qui il veut. Si, de Paris je voulais aller à Dammartin et qu'un paysan du lieu se présentât pour me conduire, je le suivrais et me fierais en lui quoique ce ne fût qu'un paysan.
Riez donc aussi de sainte Thérèse :
Au lieu de faire les étonnés, écrit-elle, et de considérer ces choses comme impossibles, qu'ils sachent que tout est possible à Dieu et qu'ils prennent sujet de s'humilier de ce qu'il plaira à sa Majesté de donner plus de lumière à quelque bonne petite vieille que non pas à eux avec toute leur science.
N'allez pas croire, du reste, que, pour diriger Vipera ou Gagliardi, une sainte Thérèse soit nécessaire. Fénelon du moins ne le croyait pas.
Il faudrait un peu d'entretien avec quelqu'un qui eût un vrai fonds de grâce pour l'intérieur. Il ne serait pas nécessaire que ce fût une personne consommée ni qui eût une supériorité de conduite sur vous. Il suffirait de vous entretenir dans la dernière simplicité avec quelque personne bien éloignée de tout raisonnement et de toute curiosité. Vous lui ouvririez votre coeur pour vous exercer à la simplicité et pour l'élargir. Cette personne vous consolerait, vous développerait à vos propres yeux et vous dirait vos vérités.
C'est exactement le bien que Vipera dit avoir reçu d'Isabelle.
Par de tels entretiens on devient moins haut, moins sec, moins rétréci, plus maniable dans la main de Dieu (1).
Que tout cela paraîtrait simple si depuis la condamnation de Molinos et la panique fatale qui l'a suivie, la crainte de l'illusion n'était devenue une véritable phobie !
(1) Cf. mon Apologie pour Fénelon, pp. 42-45.
13
Il est d'ailleurs assez probable que Gagliardi aura plus ou moins manqué de bon sens et de prudence. La vénération éperdue qu'il professait envers cette femme, les nombreuses visites qu'il lui faisait, les facilités qu'il offrait à ceux de ses frères qu'elle dirigeait aussi, on s'explique aisément que ces maladresses, bien que très innocentes, aient été exploitées par ceux de l'autre parti. Le P. Viller a raconté leurs nouveaux exploits avec sa franchise ordinaire, mais avec une sérénité où je ne saurais prétendre. Décidément rien ne l'irrite que la simplicité de Gagliardi. « La vertu du supérieur, écrit-il, et celle de Mme Isabelle ont beau être au-dessus de tous les soupçons ; cela n'empêcha point les gens de parler. Dès juillet 1587, le Provincial de Milan... est averti par le général Aquaviva qu'il doit modérer les visites à mina Isabelle ; les Pères y vont trop souvent. Des dénonciations dont nous ignorons la teneur - il veut dire sans doute que les autographes ne se trouvent pas dans les archives ; car, pour la teneur, elle est assez claire ; - sont venues au général qui s'inquiète. A plusieurs reprises Claude Aquaviva réitère sa monition ». Puis, en 1588, il expédie à Milan un nouvel enquêteur, le P. Maggio. « Aquaviva lui mande des instructions précises : 1° qu'on ne reçoive de Mme Isabelle aucune victuaille - pour ne plus vouloir des confitures qu'elle leur envoyait, il faut vraiment que ces bons Pères aient exterminé au moins la moitié de leur vieil homme - ; 2° que son confesseur seul aille la voir, et une ou deux fois par semaine, et pas plus. » Pour le dire encore en passant, cette dernière consigne n'est pas d'un supérieur bien sévère, ni même bien alarmé. Deux fois par semaine, et à domicile. Pourquoi une faveur qu'on réserve d'ordinaire aux princesses du sang ? Isabelle était-elle si grande dame? Ou paralysée ? Quoi qu'il en soit, tant d'égards semblent bien montrer l'estime singulière où on la tenait, même à Rome. Détail plus important, une lettre du général à l'enquêteur « nous laisse entendre que c'est toute la spiritualité d'Isabelle qui est en jeu, et que ses écrits
14
sont incriminés (probablement notre Breve Compendio) ; que Maggio aille trouver l'archevêque de Milan, qu'il lui soumette tous les écrits d'Isabelle et qu'il le fasse juge de toute l'affaire. » A la bonne heure : enquête du P. Visiteur, procès à l'archevêché, pris entre ces deux feux, les coupables ne sauraient échapper au sort qu'ils méritent. Inutile d'ajouter que, pendant ces semaines d'ébullition, l'ennemi n'aura pas chômé. Toute l'équipe, assez puissante manifestement, aura donné. Ils en seront néanmoins, une fois de plus, si j'ose dire, pour leurs frais d'intrigues et de mensonges. « Il ne semble pas, conclut paisiblement notre historien, que l'affaire de 1588 ait le moine du monde ébranlé le crédit d'A. Gagliardi ni la renommée de sa pénitente. L'un et l'autre sortaient justifiés des calomnies répandues (1). » Comment ne voit-il donc pas, après cette double expérience, que les ennemis de notre petit groupe mystique sont disqualifiés pour toujours ? S'ils recommencent, et nous savons bien d'avance qu'ils recommenceront, ils ne feront que changer de calomnie. Mais cette fois ils choisiront mieux. A force de forger on devient forgeron. Voici donc ce qu'ils ont forgé. A en croire ces bons apôtres, si dignes de foi comme nous savons - et le R. P. Viller m'a tout l'air de les croire - Isabelle et Gagliardi préparaient de longue main une vaste réforme des Ordres religieux - les Mendiants compris - et de la Compagnie elle-même : complot scandaleux au premier chef et qu'il importait d'étouffer sans plus attendre. Le grave historien d'aujourd'hui qui nous le révèle ne s'étonne même pas qu'on ne l'ait enfin découvert qu'après quelque dix ans d'espionnage. Il ne s'étonne pas davantage de rencontrer sur les chemins de l'histoire un
(1) Viller, op. cit., pp. 8o-82. Détail délicieux parmi tant de vilenies ; Aquaviva, parfaitement sûr de Gaglierdi et des autres Isabelliens, a peur qu'ils n'obéissent avec trop de scrupule à ses prescriptions. Un an après l'enquête, il demande « qu'on n'abandonne pas tout à fait Mme Isabelle et quon ne cesse pas complètement les visites ». Curieux souci : nouvelle preuve de l'intérêt qu'on portait en si haut lieu à cette femme. Preuve aussi que l'on prenait très au sérieux l'affiliation d'Isabelle à la Compagnie.
15
jésuite aussi pervers, ou aussi fou. Pour moi c'est là un conte à dormir debout. « Réforme » a plusieurs sens, comme « direction (1) ». Les religieux qui venaient à elle, nul doute en effet, qu'Isabelle ne les pressât de « réformer » leur propre intérieur, et, pour cela, d'observer d'abord avec une sainte rigueur les règles de leur Institut; ainsi faisait, de son côté, le P. Gagliardi, après s'être d'abord imposé à lui-même comme il nous le disait plus haut « une rénovation sincère de la tête aux pieds »; rénovation, réforme, c'est ici la même chose. En tout cela, quoi de criminel ? Au pis aller, un certain rigorisme ou quelque exaltation de la part de Gagliardi et, chez Isabelle, des manques de tact ou de mesure. Mais qu'ils aient rêvé d'une réforme au sens anarchique du mot, c'est-à-dire qu'ils se soient concertés en vue de bouleverser, ou de fond en comble ou pour si peu que ce fût, les constitutions de saint Dominique, de saint
Si absurdes qu'ils nous semblent, c'étaient là pourtant les bruits qu'on faisait courir et, bien entendu, jusqu'à nome, comme le montre une lettre du général à Gagliardi :
On apprend que chez vous le bruit s'est répandu que Sa Sainteté s'est décidée à réformer les quatre ordres mendiants sur les instances de la Compagnie. Parce que cette rumeur peut apporter quelque dommage pour le service de Dieu, il nous a paru nécessaire que Votre Révérence déclarât notre amis là-dessus et qu'elle donnât l'assurance à tous que la Compagnie ne se mêle point de ces réformes.
Comme s'il eût écrit à un jésuite anglais ; dites partout que nous ne songeons pas à empoisonner votre souveraine (2).
(1) Comme nos conjurés, mais pertes en toute innocence, le P. Viner joue sur les mots quand il dit que nous savons «par A. Gagliardi lui-même que la mission d'Isabelle était une essieu de réformes », p. 83. (2) L'exégèse que le R. P. Viller propose de ce document est un bel exemple d'hallucination critique. a Rien de plus sage, écrit-il que ce mot d'Aquaviva. L'eût-il adressé à Gagliardi si celui-ci n'avait pas été pour quelque chose dans ces bruits de réforme? » La phrase est peu claire ; mais si elle a un sens, elle veut dire : 1° que le P. Aquaviva est très sage de ne pas songer à réformer les Mendiants, et Gaghardi très peu sage de méditer cette réforme; 2° que le P. Aquaviva n'aurait pas écrit cette lettre s'il n'avait pas soupçonné ce pauvre Père de s'apprêter à demander au Pape la réforme des Mendiants. La pensée d'Aquaviva est pourtant assez lumineuse. D'absurdes bruits courent sur notre compte ; appliquez-vous à les démentir. Il sait bien que Gagliardi est « pour quelque chose dans ces bruits » - eh ! c'est précisément le projet que ses calomniateurs lui prêtent. Mais Aquaviva ne croit pas du tout que Gagliardi soit a pour quelque chose » dans le projet même.
16
Aquaviva ne m'a pas fait de confidences, pas plus d'ailleurs qu'au P. Viller ; mais ni ses lettres, ni ses actes ne permettent de supposer qu'il ait donné raison aux accusateurs de Gagliardi. Il savait parfaitement que ce grand religieux - une des colonnes spirituelles de l'Ordre, un des commentateurs les plus autorisés de l'Institut - était bien incapable de comploter soit contre les Mendiants, soit contre la Compagnie elle-même (1). Assurément, il l'eut préféré
(1) Je laisse de côté, comme d'un intérêt plus spécial, et comme déjà résolue en principe la question de savoir si nos deux prétendus réformateurs, Isabelle et Gagliardi, songeaient sérieusement à « réformer » peu ou prou les Constitutions de la Compagnie. Sentant bien que c'était là le point le plus névralgique, les délateurs y auront insisté de préférence dans leurs lettres au général Aquaviva. Il est curieux que le P. Viller n'ait pas senti l'absurdité d'une pareille calomnie. Gagliardi écrit-il, « restait... intimement persuadé qu'on ferait bien de tenir compte des révélations d'Isabelle dans le gouvernement de la Compagnie ». Oui, sans aucun doute, mais qu'entendait-il par là? Encore une fois, a réforme a deux sens. Nous connaissons l'idée fixe de Gagliardi. Les conseils d'Isabelle l'ayant aidé lui-même à se « réformer », c'est-à-dire à se conformer de plus près à l'idéal que lui proposent les Constitutions, il trouve normal et désirable que d'autres jésuites bénéficient d'une pareille conduite. A cela se borne son illusion, car, à mon avis, c'en est une. Je suis persuadé qu'Isabelle ne donnait à ses fils spirituels que de bons conseils, mais cette consécration officielle de sa maternité mystique, si j'ose parler ainsi, risquait d'entraîner plus d'un abus et on ne s'étonne pas qu'Avaviva l'ait désapprouvée, comme l'aurait fait - et plus rondement - saint Ignace. Mais enfin les règles n'étaient pas en question. Loin d'en affranchir ses disciples, Isabelle aurait insisté plutôt avec quelque exagération sur la nécessité de les observer. Peut-être - je dis peut-être - désapprouvait-elle certains adoucissements que l'usage de ce temps-là permettait ou sur lesquels les supérieurs fermaient les yeux. De là viendrait, en partie du moins, l'exaspération de quelques-uns. De quoi va-t-elle se mêler ? La lettre de Gaghardi que cite le P. Viller à l'appui de son interprétation plus sinistre ne dit pas ce qu'il lui fait dire. « Pourquoi voit-on, écrit-il, qu'a été communiquée à cette âme (Isabelle) toute l'architecture de la Compagnie, un commerce très familier avec le P. Ignace, des remèdes excellents pour tous nos besoins... ? Et cette communication... se découvre... si conforme, si identique même à l'Institut, que l'on ne fait quasi pas doute qu'elle ne vienne de la même source (une révélation d'Ignace). Les quelques points que j'en ai écrits à Notre Père ne sont rien en comparaison de ce qu'elle sait sur la fin intime de la Compagnie)... Et j'en reviens à dire (c'est son refrain et celui de Fénelon) qu'en ceci le mode de recevoir l'avertissement est sûr, puisqu'il ne consiste qu'à le recevoir avec humilité, repos d'esprit et grande probabilité qu'il vient de Dieu ; et, que dans l'exécution, il suffit de se conformer à la règle de la raison, de la loi divine et de l'Institut »; (Viller, p. 86). Pour lire dans cette lettre l'aveu des ridicules desseins que l'on prête à Gagliardi et à Isabelle, il faut avoir des lunettes rouges. Quoi de plus simple ! On répète à Gagliardi qu'un jésuite ne doit se laisser diriger que par des spirituels à qui soient parfaitement connus l'esprit et les règles de la Compagnie. A cela il répond Bien entendu! Mais justement et notre esprit et nos règles, Isabelle les possède sur le bout du doigt, puisque c'est Ignace en personne qui les lui « communique ». Ne dites pas que cette imagination est ridicule : vous prêcheriez un converti. Mais pour l'instant la question n'est pas là. Elle est de savoir si, oui ou non, cette visionnaire veut « réformer » l'oeuvre d'Ignace. Non, répond Gagliardi, puisque toutes ses lumières sur notre Institut, elle les tient de l'auteur même des Constitutions. Quel danger y aurait-il donc à la suivre puisqu'elle ne fait autre chose que nous prêcher une conformité rigoureuse aux exigences de « l'Institut » ? Cette curieuse lettre présente, d'ailleurs, un intérêt que le R. P. Viller ne semble pas avoir soupçonné. Elle nous aide à résoudre le problème que soulève la composition du Breve Compendio elle explique et confirme tout ensemble l'hypothèse que je proposerai plus loin à ce sujet. Pour moi, toute la doctrine du Breve Compendio ce ne sont pas des révélations célestes, ce sont les entretiens de Gagliardi qui l'ont enseignée à Isabelle. Ici de même : toutes ses belles idées sur « l'architecture de la Compagnie » et sa « fin intime », pas ne fut besoin qu'Ignace descendit du ciel pour les lui souffler. Elle les tient de Gagliardi, un des jésuites qui, de l'aveu de tous, ont le mieux compris la philosophie des Constitutions. Encore une fois, et pour en revenir au sujet de cette note, un Gagliardi songeant à révolutionner l'Institut est aussi inconcevable qu'un cercle carré.
17
moins engoué d'une visionnaire, mais, s'il l'avait tenu pour sérieusement suspect, il ne l'aurait pas laissé gouverner, pendant si longtemps et parmi tant de contradictions 1a maison professe de Milan. Un jour vint toutefois où, sentant qu'il devait mettre fin à une agitation aussi furieuse, il éloigna Gagliardi de Milan et d'Isabelle. 1594. Entre temps l'affaire avait rebondi jusqu'au Saint-Père, lequel, du reste, ne se montra pas beaucoup plus pressé que le P. Aquaviva. Gagliardi avait, pour le défendre auprès de Clément VIII, un certain cardinal Bellarmin, canonisé depuis, mais qui dès lors ne passait pas pour illuminé. La sentence fut portée en 1601, « très bénigne » nous assure le P. Viller. « Par un vivae vocis oraculum, le pape défendait à Mme Isabelle de dicter désormais ses révélations et lui
18
imposait silence. Le P. Jérôme Domenchi, provincial de Milan, s'empara de toutes les dictées existantes et les fit renfermer dans les archives de la province. » Prison pour prison, celle de Mm' Guyon sera plus dure. Le pauvre Gagliardi n'était pas oublié. « On le blâmait d'avoir cru à la mission réformatrice de Mme Isabelle? Défense lui était faite d'en traiter encore avec elle, fût-ce par intermédiaire. Il devait, en outre, fournir une liste de tous ceux qui avaient traité avec lui ou avec la dame con intento di reforme e pretesto di perfettione spirituate; mais aucune peine ne fut prononcée... Leur soumission à tous deux fut exemplaire. » Gagliardi n'en resta pas moins supérieur de la maison professe de Venise, où cette sentence était venue le trouver. Il mourut à Modène en 1607. « Après 1601, Isabella Christina Bellinzaga entre à peu près complètement dans le silence... Nous ne savons presque plus rien d'elle. Son nom reparaît de loin en loin dans les lettres de missionnaires milanais, qui, du Japon ou de Macao, se recommandent à ses prières. » Comme Fénelon à Mme Guyon, ces missionnaires restent fidèles à leur ancienne « Mère spirituelle »; à celle, veux-je dire, qu'ils allaient voir jadis con intento di riforme e pretesto di perfettione spirituali (1). « Elle est morte à Milan, le
(1) Viller, op. cit., pp. 87-88.
19
III. - Il est très curieux, comme le P. Viller le fait remarquer à plusieurs reprises, que les ennemis, pourtant si avisés, si implacables de nos deux mystiques n'aient pas exploité contre eux les singularités doctrinales du Breve Compendio. N'auraient-ils donc pas su discerner le venin de ce petit livre que de plus clairvoyants le R. P. Pottier, par exemple, assimileront un jour au Moyen Court de Mme Guyon, et à d'autres oeuvres également diaboliques? Seules paraissaient alors compromettantes les révélations proprement dites d'Isabelle, avidement recueillies et maladroitement répandues par Gagliardi (1). La sentence de Clément VIII ne frappe que des paperasses de ce genre : elle ignore ou elle épargne le Breve Compendio, dont elle ne gênera d'aucune façon l'extraordinaire fortune (2). Il ne faut demander ni à Gagliardi ni à Isabelle quelle est exactement leur part respective dans la composition de cet ouvrage. Question mal posée, diraient-ils, puisque en vérité le Breve Compendio ne leur appartient ni à l'un ni à l'autre. Ils ne sont tous deux que de simples secrétaires. Isabelle écrit ou parle sous la dictée du Saint-Esprit; Gagliardi, écrit sous la dictée d'Isabelle, conservant, autant qu'il est possible à un théologien, « les termes mêmes » de la voyante « afin de ne point altérer l'élévation du style dont elle s'est servie (3) ». C'est ainsi, du moins, qu'à tort ou à raison, mais avec la conviction la plus absolue, ils se représentent les choses, et bien que, pour ma part, je n'accepte
(1) Sauf quelques lignes, et qui ne figurent que dans un très petit nombre d'éditions et de traductions, le Breve Compendio, oeuvre de spéculation pure, ne renferme pas de visions. L'auteur ne se donne jamais comme inspiré. (2) Ce petit livre se trouvait-il parmi les nombreuses dictées d'Isabelle qui avaient été examinées à Rome, bien avant la condamnation de 16o2, et où les théologiens de la Compagnie (en cela d'accord avec ceux de Milan) n'avaient rien trouvé de répréhensible ? C'est fort probable, mais le P. Viller n'ose l'affirmer (op. cit., pp. 8o-81). Il nous semble à nous que l'attention des réviseurs aurait dû s'absorber dans l'examen de cette synthèse proprement doctrinale. Mais en fait Ies révélations et lesvisions les ont retenus d'abord, et peut-être au point de leur faire négliger le Breve Compendio. (3) Viller, op. cit., p. 77.
20
pas leur construction ni la psychologie un peu sommaire qu'elle suppose, je ne crois pas qu'on puisse a priori la trouver ridicule sans contester du même coup la possibilité même de toute révélation particulière. Non certes que, de mon autorité propre, j'interdise aux grâces prophétiques, ainsi que d'autres semblent le faire, l'accès de ces deux âmes foncièrement bonnes, et peut-être d'une vertu rare. Les saints eux-mêmes ne sont pas toujours à l'abri de l'illusion. Nul besoin toutefois d'attribuer une origine quasi-miraculeuse à une oeuvre qui n'apportait rien de proprement nouveau, et dont le plus grand mérite, l'unique même, est de ramasser en quelques pages lumineuses, l'enseignement commun des mystiques. Ils ont, d'ailleurs, tout à fait raison d'assurer que leur doctrine ne leur appartient ni à l'un ni à l'autre; ils l'ont apprise, non pas directement du Saint-Esprit, mais l'un de l'autre; elle est née d'une longue collaboration inconsciente, d'une sorte d'imprégnation réciproque dont ils sont excusables de n'avoir pas éclairci le mystère, plus facile pour nous, grâce aux documents que l'on vient de découvrir. Ce sont, je crois, les directions tâtonnantes de Gagliardi - et notamment les maquettes de méditations qu'il lui proposait - qui auront conduit cette femme si intelligente à réaliser puis à ordonner spéculativement une doctrine qu'elle vivait sans doute, depuis de longues années, mais qu'elle eût été jusqu'alors incapable de professer. Gagliardi, de son côté, lui a dicté les éléments, les prémisses d'une synthèse qu'il entrevoyait déjà confusément, mais qu'il ne savait pas encore ou qu'il n'osait pas construire, partagé entre les pressentiments, les attraits qu'avait éveillés chez lui la lecture des mystiques modernes et les résistances que plusieurs de la Compagnie opposaient alors à cette même littérature, considérée par eux comme chimérique et propre à faire oublier les consignes « pratiques » du combat spirituel. Par où s'explique sans peine la stupeur éblouie où le plongèrent les révélations d'Isabelle. Sa voyante lui rendait ce
21
qu'elle avait reçu de lui, elle lui renvoyait en quelque sorte ses propres leçons, mais amplifiées, filtrées, affermies et surtout simplifiées. Quoi d'étonnant qu'il ne les ait pas reconnues, qu'elles lui aient paru toutes neuves et tombées du ciel ! Je suis d'ailleurs persuadé que Gagliardi a révisé de très près, pour ne rien dire de plus, sinon les visions d'Isabelle, au moins l'opuscule exclusivement doctrinal, et, si l'on peut dire, objectif qui seul nous intéresse. Méthodique jusqu'à l'excès, tel que noua le montrent ses propres ouvrages, façonné de longue main au style de l'école, il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour rendre inattaquable la présentation technique d'un message dont il croyait certes la substance toute divine, mais qui déconcerterait d'abord les théologiens de métier.
J'espère bien, écrivait-il à un de ses frères qui se trouvait près du général, à Rome, pendant qu'on y examinait les écrits d'Isabelle, J'espère bien, à cause des rapports qui toujours ont été favorables et de la science du Père qui l'a dirigée, qu'on ne trouvera rien de faux. Voyez pourtant avec le P. Louis Mansone, si, dans ces écrits, on a corrigé quelques façons de parler qui paraîtraient nouvelles. Car, bien que quelques théologiens qui les ont vus ici aient jugé qu'il n'y avait rien qui se puisse noter d'erreur, néanmoins il nous paraît bon de supprimer quelques expressions qui peuvent paraître nouvelles (1).
Que le Breve Compendio ait figuré ou non parmi les écrits dont il est question dans cette lettre, comment imaginer qu'avant de répandre un ouvrage de ce caractère, Gagliardi n'en ait pas soumis tous les mots à une critique minutieuse ? Pour moi, je ne m'en tiendrais pas là et je ferais encore plus large, immédiate, personnelle, la part qui lui revient soit dans la conception, soit dans l'ordonnance, soit dans la
(1) Viller, op. cit., pp. 8o-81. A en croire Gagliardi, ces nouveautés litigieuses sont moins imputables à Isabelle qu'aux théologiens de Milan qui ont révisé ses écrits : « Ce sont plutôt des explications des nôtres que ses expressions personnelles ». L'engouement ne pourrait aller plus loin. Mais pour l'inquiéter ainsi, ne faut-il pas que les retouches aient été assez nombreuses.
22
rédaction de cette somme mystique. Mais enfin, sa collaboration aurait-elle été aussi réduite qu'on nous le dit, et que sans doute il l'a cru lui-même, nul ne peut contester que Gagliardi approuve, s'approprie de tout son esprit et de tout son coeur, ensemble et détail, ligne à ligne, la doctrine du Breve Compendio. Fort de cette évidence, nous prendrons ici congé d'Isabelle Bellinzaga et, pour faire court, nous attribuerons désormais leur oeuvre commune au seul Achille Gagliardi. Au surplus, comme ces deux italiens ne sont pas de notre paroisse, nous n'aurions pas à étudier ici leur doctrine si la haute spiritualité française ne l'avait unanimement adoptée. IV. - Le Breve Compendio, dont les copies - sinon les éditions - se multipliaient en Italie pendant les dernières années du XVI° siècle, n'avait pas tardé à franchir les monts. L'épître dédicatoire d'une des plus anciennes traductions, - revue en 1599 - est très remarquable.
Très chères épouses de Jésus-Christ, il y a quelque temps que ce livret a été traduit d'italien en français par le soin et diligence de quelque gentilhomme gascon. Mais parce qu'il s'est trouvé après l'impression rempli de tant de manquements et d'omissions, d'obscurités et de tantes, qu'en plusieurs endroits on n'y entendait rien que le haut allemand, plusieurs personnages de rare vertu et heureusement versés en la théologie mystique, jugeant que c'était un grand dommage quo cet excellent trésor fut ainsi caché et obscurci de si grandes ténèbres ... - car cet oeuvre, pour petit qu'il soit, traite d'une très haute et très admirable perfection, et ne s'est rien vu de plus beau en ce misérable siècle où nous sommes... selon l'avis et jugement des plus sublimes et plus experts de cette sainte et sacrée théologie ; - quelques bons docteurs et Pères spirituels de divers ordres se sont soigneusement étudiés à le corriger, l'éclaircir et y restituer plusieurs passages mutilés et corrompus (1).
(1) Cf. Dagens, op. cit., pp. 32o-321. Personne encore n'a pu mettre la main sur le livre du « gentilhomme gascon », qui aurait paru vers 1589. La première édition de la traduction « corrigée » est également introuvable, on ne la connaît que par la réédition, rarissime, que cite M. Dagens.
23
N'est-il pas curieux de voir ce petit livre s'élancer ainsi comme un géant à la conquête spirituelle de notre pays? Dès qu'ils l'ont entrevu, même défiguré par le galimatias du « gentilhomme gascon », les docteurs ès choses mystiques en ont deviné la splendeur; ils ont voulu en propager le bienfait. Débuts deux fois émouvants, si on les rapproche des chicanes sordides que nous racontions plus haut. Et voici maintenant des prêtres, des religieux, un petit concile qui travaillent de concert à rendre au Compendio sa beauté originelle. Quand j'aurai exposé la dure doctrine du traité, on avouera que cet accueil enthousiaste en dit long sur les prédispositions mystiques du XVI° siècle finissant. L'épître dédicatoire poursuivait fort curieusement :
Nous vous supplions aussi.., ne prendre aucun ombrage si le nom de celui ou celle qui a composé ce discours n'est point inséré au frontispice d'iceluy.
comme l'eût exigé le Droit canon ;
car nous n'avons pu savoir jusqu'à présent le nom de celui ou celle qui l'a fait; toutefois la commune opinion est qu'il est sorti de la boutique d'une très vertueuse et très honorable Dame Milanaise, douée de grande perfection. Tout ce qui est écrit en ce livre ressent plutôt l'esprit de saint Denis ou d'une sainte Catherine de Sienne que l'entendement frêle et débile d'une simple femmelette (1).
Prenaient-ils donc sainte Catherine pour un homme? Lapsus amusant qui trahit leur judicieuse perplexité. Ils pensent comme nous qu'à en juger par la critique intime, l'Abrégé de la perfection ne peut avoir été conçu, ou du moins rédigé, que par un théologien blanchi sous le harnois. La femme capable d'une synthèse aussi limpide et aux articulations si vigoureuses ne se rencontre qu'une fois tous les quatre siècles. Mais enfin, ils s'en tiennent, vaille que
(1) Viller, op. cit., p. 66.
24
vaille, aux affirmations des graves personnages qui ont apporté d'Italie cette uvre merveilleuse ; c'étaient probablement des jésuites. Quoi qu'il en soit, le public n'en demanda pas plus long. Pendant longtemps on attribua l'Abrégé à la « Dame milanaise ». Ce ne sera que vers 1635 que les jésuites eux-mêmes le rendront sans plus d'embarras à Gagliardi (1). Cette édition révisée de la première traduction était à la veille de paraître, ou venait à peine de paraître, lorsque le jeune Pierre de Bérulle publia, sans le signer de son nom, mais avec l'approbation doctorale du théologien le plus considérable de ce temps-là, André Duval, un Bref discours de l'abnégation intérieure qui n'est en vérité qu'une traduction libre du Breve Compendio; une adaptation, pour mieux dire, mais qui, le plus souvent, suit le texte de très près, sauf à en laisser délibérément et prudemment tomber les passages qui risquaient de déconcerter ou d'égarer le commun des Lecteurs. Il y a là de jolis mystères. Bérulle ignorait-il la traduction, déjà ancienne, du «gentilhomme gascon»; la jugeait-il par trop incorrecte, ou bien encore ignorait-il que d'autres avaient formé le projet de la réviser? Tout donne à croire que ce prêtre de vingt ans, génial déjà sans doute mais novice, n'aura pris cette initiative que sous l'inspiration de ceux qui le conduisaient. On nomme son directeur, le chartreux Dom Beaucousin. Celui-ci, très avide de littérature mystique, n'aura pu, en effet, que l'encourager. Mais il semble plutôt que l'idée de ce travail lui sera venue des jésuites. A cette date, il les voyait constamment. Il était de la maison et on n'avait pas de secrets pour lui. « Personne ne nous a dit, écrit le P. Viller, comment Bérulle avait découvert l'Abrégé de la perfection. Si je puis risquer une hypothèse, je croirais volontiers qu'il le tenait des jésuites du collège de Clermont. Un des Pères, en rentrant d'Italie, sera passé par Milan et aura emporté un exemplaire ou une
(1) Ib., p. 52.
25
copie. » Pourquoi, se demande encore le P. Viller, ce premier intermédiaire entre la France mystique et le Breve Compendio ne serait-il pas le P. Coton, dès lors et pour toujours si intimement lié avec Bérulle, le Père Coton, dit-il, qui précisément avait fait ses études théologiques à Milan pendant que Gagliardi gouvernait la maison professe de cette ville ? Qui sait même si, dans sa jeune ferveur, Coton n'aura pas avidement suivi l'exemple de ceux de ses frères - et ce n'étaient pas les médiocres - qui recherchaient alors la direction d'Isabelle Bellinzaga ? « Je ne serais nullement surpris, avoue encore le savant P. Viller, si l'on prouvait que l'extatique qui... prédit (au futur confesseur de Henri IV) les « faveurs d'un grand roi », s'identifie avec Madame Isabelle (1) ». Mais quoi qu'il en soit de ces délectables vraisemblances, il m'est presque évident que le Bérulle de 1597 n'aurait jamais publié son adaptation du Breve Compendio, si les jésuites de Paris, ses maîtres, avaient jugé quelque peu troublante la doctrine commune de Gagliardi et d'Isabelle. Il faut bien, d'ailleurs, que les jésuites français de ce temps-là aient eu singulièrement et persévéramment à coeur la diffusion du Breve Compendio, puisque le P. Étienne Binet, plusieurs fois Provincial et un de leurs écrivains les plus fameux, se fit un devoir de le traduire à nouveau. C'est l'Abrégé de la perfection chrétienne qui figure dans le recueil de ses oeuvres spirituelles, imprimé pour la première fois à
(1) Viller, op. cit., p. 85. Je puis bien dire, à ma gloire et à ma honte, qu'en même temps que le P. Viller, j'étais arrivé à une conjecture presque semblable, bien que par une route moins savante et moins grave. J'avais affaire au R. P. Pottier qui venait de dénoncer triomphalement le quiétisme de Bérulle, sans se douter que ses coups tombaient d'abord sur le P. Gagliardi. Après avoir démontré que le Bref Discours de Bérulle et le Breve Compendio n'étaient que le même livre, « tout s'illumine, continuais-je ; entre 1596 et 1597, plus tôt peut-être, il y a dans Paris, vraisemblablement au Collège de Clermont, au moins un jésuite préquiétiste. » Celui qui a passé le livre de Gagliardi à Bérulle. « Ce malheureux - serait-ce, juste ciel! le Père Coton? - a reçu d'Italie le Breve Compendio de son confrère. Il le communique sous le manteau aux bonnes âmes de sa connaissance, entre autres au jeune Pierre de Bérulle, presque tout jésuite en ce temps-là et à qui on pouvait livrer les secrets de l'Ordre. » Cf. Bérulle quiétiste... ou Gagliardi? Vie sprituelle, 1er février 1931, p. 1, 69, 3.
26
Rouen en 162o (1), Vit-on jamais pareil engouement pour un traité de mystique. Après le « gentilhomme gascon » ; après le groupe doctoral qui revisa la traduction de ce gentil-homme trop pressé ; après l'adaptation bérullienne de 1597, encore une traduction en 162o, au plus tard, et due au Père Binet! Encore n'ai-je pas dit, que le sublime Père Surin recommande cette traduction comme une des oeuvres maîtresses de la littérature mystique (2). En vérité quel poids de gloire pour ce petit livre, et quelle profusion de paratonnerres! Il ne lui manque plus que le suffrage solennel de l'école salésienne, et voici que Jean-Pierre Camus va lui donner enfin cette suprême consécration. Au moment où il intervient dans cet extraordinaire concert, le fidèle disciple de
(1) Sur cette traduction, cf. Viller, op. cit., p. 51, seq. ; et mon article déjà cité, pp. 67, seq.. Bien qu'elle n'existe plus aujourd'hui que dans le Recueil des oeuvres spirituelles de Binet, j'inclinerais à croire que cette nouvelle traduction de l'Abrégé avait été déjà publiée à part - nous ne savons naturellement pas à quelle date - comme la plupart des pièces que Binet a réunies dans son recueil. Je croirais même que cette édition séparée était plus complète. Elle contenait peut-être ces élévations - gagliardiennes, elles aussi, ou à la manière de Gagliardi dont parle P. Camus et que l'on chercherait en vain dans le recueil de Binet. Mais, encore une fois, cette bibliographie est un labyrinthe désespérant. Pourquoi par exemple, Binet ne fait-il pas la moindre allusion aux traductions antérieures ? On croirait, à le lire, qu'il vient de découvrir le Breve Compendio. (2) La voie mystique, écrivait Surin, « a encore des pratiques de vertu plus délicates qu'on peut voir dans Blosius, et qui sont clairement expliquées par le P. Achille Gagliardi... Dans un petit livre intitulé Abrégé de la perfection chrétienne, qui a été traduit en français par le P. Etienne Binet. » Dialogues spirituels, édition d'Avignon, 1721, p. 2, p. 46. De l'insigne, P. Rigoleuc, disciple comme Surin, du P. Lallemant, nous savons qu'il estimait « beaucoup le Traité de l'Abnégation intérieure du cardinal de Bérulle ». Cf. R. P. Ramon, Histoire de la dévotion au Sacré-Coeur, III, p. 76.
27
la mettaient ces petits livres - ce n'est là peut-être qu'une fiction - l'infatigable écrivain entreprend de la rassurer.
Encore un livret de lui : Le renouvellement de soi-même. Éclaircissement spirituel... Paris, 1637.
Je ne me fusse jamais imaginé, Zéphyrin - dit-il - que vous eussiez dû rencontrer des ténèbres dans ces deux petits traités.
Le Bref discours et l'Abrégé de la Perfection
tout pleins de lumière, et qui sont à mon avis des lampes ardentes et luisantes aux pieds de ceux qui marchent dans les voies de Dieu. Au contraire, je me persuadais que vous y trouveriez des clartés aimables... Vous m'aviez pressé de vous marquer en quel livre spirituel vous pourriez mieux apprendre non une vague théorie, mais une pratique courte et serrée de ce renoncement de soi-même auquel tout homme tant soi peu versé en la parole mystique sait bien que consiste ce haut degré de perfection tant recommandé en l'Evangile. Je vous avais adressé à cet Abrégé de la Perfection chrétienne que la commune opinion attribue à une Dame Milanaise, fort avancée dans la vie de l'esprit; et à l'Abnégation intérieure dont on fait auteur un très grand et docte personnage de notre temps,
Bérulle, bien entendu,
mais on tient qu'il l'avait trouvé en sa jeunesse. Il est vrai que les pensées de l'un et l'autre Traité sont fort hautes, mais elles me semblent couchées en des termes si clairs et digérées par une méthode si facile qu'à un esprit comme le vôtre, il me semble que ce doivent être des flambeaux et des éclairs, et non pas des obscurités, des énigmes et des nuages tels que vous les dépeignez (1).
Le livre de Camus n'est à proprement parler ni une traduction, ni même une adaptation proprement dite ; c'est, écrit le P. Viller, a un commentaire, ou pour mieux dire, une apologie détaillée » des deux traités jumeaux, perpétuellement rapprochés l'un de l'autre (2). Au demeurant, cette
(1) Le renoncement, pp. 1, 2. (2) Viller, op. cit., pp. 54-56. Bien qu'il se gouverne comme si c'étaient là deux ouvrages différents et indépendants, Camus a fort bien vu qu'ils se ressemblaient plus que deux frères. Pour lui, l'Abrégé n'est « quasi que la répétition » du Bref Discours. Nous renverserions aujourd'hui les termes ; c'est le Bref Discours qui répète l'Abrégé. Camus trouve ce dernier plus lumineux que l'autre. Je ne vois pas à quelles enseignes. Mais il avoue implicitement par là que les passages supprimés par Bérulle ne le déconcertaient lui-même d'aucune façon.
28
intervention de Camus n'est qu'un épisode stratégique dans la campagne que le vieil évêque menait alors contre les ennemis du pur amour; campagne qui fera l'objet d'un autre chapitre. A cette date, en effet (1637), on devait s'intéresser de moins en moins à la « Dame milanaise ». Après un demi-siècle de vogue, les beaux jours de cet opuscule étaient passés; l'automne venait pour lui. La France mystique se l'était assimilé si profondément qu'elle n'avait plus besoin de le lire. D'autres livres l'éclipsaient qui, d'ailleurs, ne faisaient que le répéter, ou que le recommencer. Nous les connaissons déjà et nous savons que, bien ou mal, ils enseignent tous, chacun à sa façon, la même doctrine (1). Cette oeuvre, peu ordinaire, cette oeuvre protée, si nous la lisions, en regardant tantôt du côté Bérulle, tantôt du côté Binet ? Traduisant le même original, exprimant la même philosophie, il n'est pas sans intérêt de comparer les deux styles. Parfois aussi, du côté Camus (2). Pour le titre, Bérulle l'emporte... Abrégé de la Perfection est vague et promet ce que le livre ne donnera pas. Le Breve Compendio n'est pas un Rodriguez de poche, mais un bref discours de l'abnégation intérieure, ou, comme préfère Camus, un traité du renoncement de soi-même. Je donne aussi la palme à l'avant-propos de Bérulle. « Nous avons deux natures, l'une corporelle et spirituelle ; l'autre spirituelle et raisonnable. La perfection consiste à perfectionner l'une et l'autre en l'amour de Dieu et à en chasser l'amour-propre
(1) Sur l'histoire postérieure du Breve Compendio, qui ne serait plus de mon sujet, on trouvera quelques détails dans l'article de P. Viller. (2) Je cite Bérulle d'après l'édition Bourgoing des Oeuvres complètes et le Recueil de Binet d'après l'édition de 1637. Mais, comme ces traités sont très courts, je ne donne pas les références.
29
qui y est profondément enraciné. » L'amour-propre, voilà l'ennemi ; le seul ennemi. Tout l'opuscule veut nous façonner à le dépister et à lui donner la chasse. a) Il est perpétuellement en nous, Philistin que Dieu a laissé, non aux environs, mais au coeur même du pays. b) Il y est partout. Aucune de nos actions, voire la plus intime, qu'il ne guette, prêt à l'infecter « de son venin, soit la corrompant du tout, soit en diminuant sa force et sa vertu... Il n'y a chose si sainte... qu'il ne convertisse en son goût et en ses propres délices ; il n'y a grâce de Dieu, tant pure et efficace, qu'il ne s'en serve comme d'un moyen et empêchement pour nous divertir et éloigner d'icelui ». Bref, « il n'y a état de l'âme si élevé, où il n'entre et ne dispose l'âme par ses artifices et propriétés à une chute fort préjudiciable ». Remarquez, en passant, apprenez peut-être la genèse de ce mot : propriété, cher aux quiétistes de toute robe, et même aux mystiques. Propriété, propriétaire, pas de mots qui reviennent plus souvent dans cette littérature. Il vient tout bonnement d'amour-propre. c) Enfin, si l'amour-propre est toujours là, et dans tous les coins, il y fait si peu de bruit qu'on ne s'aperçoit ni de son action ni de sa présence. Dieu seul est « plus intime en nous-même » et plus agissant que «l'amour-propre », seul il peut nous aider à le maîtriser. Deux sentiments qu'il nous faut renouveler en nous sans relâche : d'abord « une très basse estime de toutes choses créées et de soi-même », puis,
(1) Plus loin : « une démission de son être », p. 429.
3o
Soit trois chefs principaux, « conformément aux trois degrés de pauvreté » ou d'abnégation, ou de désappropriation, où ce livre veut nous conduire : I. « Pauvreté par où nous sommes dénués des choses en soi indifférentes à la vie de l'esprit » ; II. « Des choses très utiles à cette vie de l'esprit » ; III. « De ce qui semble le plus nécessaire à l'établissement et à la conservation de la vie de l'esprit. »
I° DEGRÉ. Parfait renoncement « aux choses extérieures et corporelles, de soi indifférentes à l'état de la vie de l'esprit, comme les dignités ou les honneurs, les richesses ou pauvreté, la santé ou maladie, la vie ou la mort; bref toutes commodité, goûts et intérêts des choses créées (1). » Aucune difficulté sur ce point. J'entends pour les candidats à la perfection. Car c'est à eux, à eux seuls, que l'opuscule s'adresse, comme d'ailleurs tous les traités de mystique.
II° DEGRÉ. Désappropriation « des choses saintes et spirituelles », celles, explique Binet, « qui nous unissent à Dieu et font la liaison de Dieu et de nos esprits ». Et il ajoute excellemment : « Non pas pourtant en les retranchant d'autant qu'elles sont telles, mais d'autant que, sous
(1) Gagliardi emprunte manifestement au Fundamentum ignatien la notion d'indifférence et les exemples de choses indifférentes ; mais la vertu où il veut ici nous conduire n'est pas à proprement parler l'indifférence ignatienne qui est expectante ; c'est le renoncement actif et donc déjà décidé aux choses indifférentes.
31
couleur de sainteté, l'amour-propre et notre intérêt particulier s'y glisse et s'y met à couvert ». Non, insiste Bérulle, « par une résistance intérieure ou par le contraire de telle grâce particulière..., mais par une démission totale de soi et de telle grâce et abnégation de l'un et de l'autre ». a) De ces grâces de liaison, les unes ne pénètrent que l'étage inférieur de l'âme; les autres atteignent directement, et occupent uniquement la partie supérieure. Rentrent dans la première catégorie les grâces actuelles que l'on appelle communément consolations sensibles, goûts, suavités de la prière. Notre austère trio, Gagliardi, Bérulle, Binet, fait peu de cas de ces « friandises »; « choses basses, très infirmes et puériles... Objet fort proportionné à l'amour-propre, lequel se nourrit du propre contentement et plaisir, et par une gloutonnerie spirituelle et abus déplorable des choses saintes, les convertit en ses propres délices » traduit Bérulle : « vrai gibier d'amour-propre » traduit Binet ». Ce mépris est très remarquable puisqu'il semble devoir logiquement s'étendre, sinon à toutes, du moins à la plupart de ces consolations que saint Ignace, dans ses Exercices, nous invite à désirer, à rechercher et à demander. Petere id quod volo... lacrymas. Il semble, du reste, que, de très bonne heure, les spirituels de la Compagnie aient senti la nécessité de réduire le prix que saint Ignace attachait à ces «goûts sensibles. » Souci dont l'on s'explique aisément les raisons, et qui se trahit à toutes les pages d'un autre opuscule où Gagliardi soumet à une critique subtile les règles ignatiennes du Discernement des Esprits. J'ai l'impression que cet opuscule, très embarrassé par endroits, est antérieur à notre Breve Compendio, beaucoup plus ferme et décidé, comme on vient de voir (1).
(1) S. P. Ignatii de Loyola de Discretione spirituum regulae explanatae P. A. Gagliardi : oeuvre très souvent réimprimée. L'édition où je viens de la relire a paru à Naples en 1851. Pour la manière et le style, la parenté entre le De Discretione et le Breve Compendio est frappante.
32
De son côté, le prudent Camus, tout salésien, je le répète, estime que ces contempteurs des goûts sensibles vont, si j'ose dire, un peu fort. Ces pieuses délectations, écrit-il, peuvent venir de trois sources : Dieu, les tempéraments, le diable ; et la difficulté est grande de les discerner.
Dans l'incertitude de cette reconnaissance, que fera une bonne âme ? Je ne sais point de meilleur avis, sans s'amuser (mot salésien) à un long discernement..., en quoi, outre la perte de temps, il y a beaucoup de tromperies et d'incertitudes, que de renvoyer indifféremment toutes ces consolations à la gloire de Dieu, sans en faire ni mise ni recette, c'est-à-dire, sans en faire aucune propriété. C'est ici qu'il faut certes pratiquer la sainte indifférence, ne les priser ni mépriser, ne les louer ni blâmer, ne s'y amuser ni les rejeter, mais, telles qu'elles sont, les présenter au trône de Dieu, à la façon du canal par où l'eau passe sans s'y arrêter, et de la poule qui donne le grain à ses petits sans le goûter.
Par où l'on voit, soit dit en passant, que la littérature est utile à tout, notamment à désespérer la malveillance des critiques prévenus. Cette poule est ici un paratonnerre, si j'ose ainsi m'exprimer... Philosophe pur et trop pur, c'est pour n'avoir pas su parler quelquefois de poules que le très orthodoxe Gagliardi a paru dangereux à certains critiques peu bienveillants.
Je ne suis pas en ce lieu, Zéphirin, de l'avis de nos deux traités (Bérulle et l'anonyme) qui conseillent absolument de les rejeter. Car pourquoi rejeter les présents de Dieu? Quelle injustice de rejeter le précieux à cause du vil, et le bon métal à raison de la marcassite et de l'écume? Mais je dis que, sans s'y arrêter et sans les savourer avec une complaisance propriétaire, nous en devons faire un sacrifice à la gloire de Dieu, en quoi consiste leur légitime usage, de quelque part qu'elles procèdent..., nous privant en elles de toute propriété et les appliquant à la gloire (de Dieu) (1).
(1) Le renoncement de soi-même, pp. 69-73. On a bien reconnu la pensée et jusqu'aux expressions de
31
C'est le bon sens même. Il y a bien là un peu de poudre aux yeux, mais bienfaisante. Pour un moraliste, la vraie difficulté demeure, qui est de savoir précisément où commence et par où se traduit cette « complaisance propriétaire ». Encore un nid à scrupules ! Plus habile que Gagliardi - ici du moins -, Camus tourne si bien les choses qu'on les voit plus simples qu'elles ne le sont. Et c'est justement comme il faut les voir, quand on n'est pas docteur ès choses mystiques. Nul doute, du reste, que Gagliardi n'eût pleinement approuvé ces réserves de Camus. Sa pire maladresse est d'avoir pris pour devise : Intelligenti pauca. On lui apprendra qu'il faut toujours tout expliquer, même les truismes. b) Jusqu'ici nous voguions sur une mer d'huile, et à la clarté de
Témoin émerveillé et déjà frétillant de ce divin travail qui se fait en nous sans nous, l'amour-propre ne se résignera pas volontiers à perdre une aussi belle proie. Il cherche à la rendre sienne et de deux façons. D'abord en la recevant « avec satisfaction et occulte complaisance de soi en icelle » ; puis, en secondant et prolongeant à sa façon, vraie mouche du coche, les opérations de la grâce. Qu'on le laisse faire, et tout est perdu. Ces lumières, ces affections, il ne faut pas, dit Bérulle,
les étendre par discours et allumer par effort de ses fonctions et
34
affections naturelles, dont il semble faussement que les premières lumières et affections soient accrues et dilatées intérieurement. Car cet effet ne procède ni de Dieu ni d'une vraie augmentation d'icelles. Ains seulement d'une pure réflexion de l'âme occasionnée d'amour-propre, et d'une vaine affection de telles grâces, qui, au lieu de les accroître, comme elle pense, a fait cesser l'infusion de Dieu par cet empêchement qu'elle y a mis, et rester seule en elle l'effort naturel et raisonnable.
Prenez la peine de relire, de peser mot à mot ces lignes si denses, trop denses. A elle seules, elles prouveraient que le Bref Discours ne peut être l'oeuvre d'un théologien de vingt ans. Non pas que toutes nos activités doivent cesser dès que s'amorce le travail divin. Gagliardi condamne seulement ici comme très dangereux, ou plutôt comme absurdes, ceux de nos pauvres efforts qui tendraient directement à prolonger et à amplifier ces « infusions » de grâces. Qu'y pouvons-nous en effet? Mais aussi longtemps que nous est laissée « une pleine liberté d'user des fonctions naturelles » - et c'est le cas du plus grand nombre - l'âme « ne doit faire difficulté de coopérer... par étendue de discours en l'entendement et dilatation des mouvements en la volonté ». Sans quoi, elle se priverait « du fruit de vertu qu'elle devait recueillir, tandis qu'elle y était plus habile et disposée par telles lumières et affections célestes ». Il en va autrement de certaines âmes très avancées qui reçoivent les « lumières et affections divines en telle abondance qu'elles la possèdent toute fort intimement et efficacement, sans liberté d'opérer et user de ses puissances intérieures ». Dans ces cas, très rares, je le répète,
il faut exclure les puissances raisonnables et supérieures... ; n'y permettre aucune activité que celle qui procède, non plus du coeur, ni de l'entendement et volonté, mais de la partie suprême et plus intime de l'esprit (apex)..., laquelle, par actes simples et uniformes, les rend (ces lumières, ces affections divines) et convertit à Dieu, et les emploie à fonder les solides vertus, en
35
une manière fort secrète, spirituelle et efficace, tandis que les autres fonctions, tant inférieures que supérieures, demeureront assoupies, accoisées et dénuées de leurs opérations. J'ajoute d'abondant que, selon que s'augmente l'affluence des bénédictions de Dieu, elle doit même quelquefois se dénuer de l'activité de cette partie suprême, et ne permettre qu'elle exerce autre industrie que recevoir avec soumission, indifférence et patience d'esprit, l'infusion divine, sans qu'elle lève la pointe de son activité vers icelle, pour la pénétrer avec soudaineté et vitesse, autrement elle la détruirait et encourrait les effets déjà condamnés de propriété et affectation de telles grâces, et les peines d'aveuglement intérieur et autres, qui l'émeuvent (1).
Ce sont là, du reste, et on l'avoue expressément, des états extraordinaires. On ne doit pas « présumer faussement avoir » cette grâce, et il ne faut se comporter, « comme si on l'avait acquise, qu'après qu'un très expérimenté directeur eu aurait donné conseil (2) ». Il ne faut pas « s'élever par
(1) Si l'on veut bien excuser mon impertinence, je dirai qu'il y a là peut-être quelque confusion. On semble croire que, dans ces hauts états, la partie suprême est réduite, comme la partie inférieure, à une sorte d'inertie, puisque, dit-on, elle n'exerce plus « autre industrie que recevoir ». N'est-il pas plus exact - et combien plus beau ! - de dire que cette activité de réception est l'activité propre de la partie suprême - et non une activité diminuée - et que recevoir ainsi, ou se laisser faire et combler par Dieu, est la plus parfaite, la plus active de toutes les activités humaines ? On semble croire aussi que cette partie suprême est par elle-même capable de « soudaineté et de vitesse », au lieu que, selon moi, dès que se manifestent tee troubles de ce genre, empressement, inquiétude, c'est un signe certain que les facultés inférieures viennent de rentrer en scène. (2) Nous avons déjà rencontré Gagliardi dans un de nos volumes et pour le classer parmi ceux des mystiques ignatiens qui tâchent désespérément de sauver à la fois la primauté de la contemplation et la primauté de l'ascèse. (Introduction à la Philosophie de la Prière, pp. 159 seq.) C'est à lui que l'ascétisme contemporain emprunte la meilleure définition que l'on puisse donner, je veux dire la plus spécieuse, de ce qu'ils appellent « l'oraison pratique », entendant par là une oraison qui aurait pour fin première le perfectionnement moral de celui qui prie : oraison qui, de ce chef, l'emporterait de beaucoup sur la pure contemplation « stérile », disent-ils, puisque d'elle-même elle n'est pas féconde en fruits de vertu. D'où encore, pour eux, la nécessité et la supériorité de l'oraison discursive, la seule où il nous soit possible de travailler directement à l'acquisition des vertus. Dans le Breve Compendio, Gagliardi revient à la tradition commune des mystiques. Il ne cesse pas de vouloir, avec les ignatiens, et avec le bon sens, que la prière soit féconde en fruits de vertu, mais il montre excellemment que, dans les oraisons même les plus passives - celles donc où le discours est impossible -, l'âme se perfectionne moralement « en une manière fort secrète, spirituelle et efficace ».
36
dessus ses opérations» avant que Dieu n'y attire ; il ne faut pas vouloir « se perpétuer » en ces hauts degrés, « après que l'infusion divine est cessée » ; mais au contraire,
retourner à l'usage de nos fonctions sitôt que la liberté nous en est rendue; et derechef, s'en dépouiller quand Dieu survient avec nouvelle infraction ; conservant ainsi la vie de l'esprit par un perpétuel flux et reflux de notre âme à Dieu par nos actions, et de Dieu en notre âme par ses infusions, jusqu'à ce qu'il lui plaise disposer l'âme à une telle perfection de vertu... qu'il en ait pris totale possession à perpétuité..., sans jamais plus lui rendre la faculté d'agir par elle-même;
grâce rarissime, du reste, on tient à le répéter: « Que d'elle-même, et sauf avis du directeur, elle se contienne fort longuement en la mortification des passions et exercices de vertu. »
III° DEGRÉ. Renoncement à la vertu. Pour achever la ruine de l'amour-propre, Dieu, bien qu'il nous laisse l'habitude foncière et les effets extérieurs des vertus, opère en nous quatre soustractions.
§ 1. - Il nous enlève le souhait de la vertu par une réformation de l'excès qui « peut se mêler aux désirs des choses saintes et vertueuses ». Il s'agit ici, dit Camus, « de renoncer aux désirs agréables et angoisseux des vertus solides et des biens véritables, non pour autant qu'ils sont bons et utiles pour nous avancer au service de Dieu..., mais en tant que, sous cette angoisse et agrément, il y a de l'inquiétude cachée, inquiétude qui n'est jamais sans la fièvre de l'amour-propre ». Renoncer, non pas au désir, pris en lui-même, lequel « demeure pur et entier en son énergie et efficace », reprend Bérulle, mais à la « propriété par laquelle l'âme est attachée à ce qu'elle désire ». Ou bien, dit-il encore, « on fait échange d'une vertu créée au vouloir divin » ; ou, plus clairement avec Binet, « au lieu d'une vertu créée », on ne désire plus que « la volonté de Dieu qui est incréée et infiniment plus excellente ».
37
C'est déjà le cantique enfantin que Mme Guyon doit apprendre un jour à Fénelon. Binet, du reste, a laissé tomber ici un précieux détail, tout Gaillardin, et dont Bérulle a bien senti l'importance. Dans cet état de renoncement, disent-ils, et d'insouciance apparente, on ne cesse pas de travailler aux diverses vertus qu'on se prive de désirer, on y travaille au contraire, et très efficacement, « comme hors de soi ». C'est la « manière fort secrète, spirituelle et efficace » dont Gagliardi a déjà parlé.
§ 2. - Dieu nous enlève le désir « de la gloire éternelle ». Affreux dépouillement que prêcheront tous les mystiques du XVII° siècle, et qui ne cessera pas de scandaliser leur adversaire. Mais ni Bérulle, ni Binet lui-même n'ont reculé devant cette extrémité :
38
Ici encore le plus décidé, ou, si l'on préfère, le plus étourdi n'est pas le jeune Bérulle. Qu'à vingt ans il ait préféré purifier à dépouiller, cela mérite un bon point! Mais c'est bien chez l'un et chez l'autre, la même doctrine. Camus lui aussi, l'a faite sienne, avec son originalité coutumière. Car enfin nous n'avons pas affaire à des perroquets.
O que de gens se trompent ici...! Le bien souverain qui n'est autre chose que Dieu, au lieu d'être souverainement aimé pour lui-même, est aussitôt aimé et désiré par cette pauvre abusée volonté humaine pour le bien qu'elle en espère pour soi..., adhérant à ce bien et jetant en lui, non son amour d'amour, mais son amour d'espérance... Renonçons donc... au désir intéressé du Paradis ; au désir qui le fait souhaiter par amour de concupiscence, désir aveugle, puisqu'il nous fait chercher dans le Paradis ce que la foi nous enseigne n'y être pas, savoir notre propre intérêt, celui de Dieu y régnant seul.
39
Nous montrerons plus loin que Bossuet ne pensait pas autrement.
§ 3. - Dieu nous enlève le sentiment de la vertu et, pour cela, il permet que l'âme soit assiégée par des tentations abominables. Épreuve critique, du reste, puisque, si d'une part, elle a pour fin providentielle de détruire la self-consciousness, d'un autre côté, elle risque de ressusciter et d'exaspérer l'amour-propre.
Cette purgation d'esprit.., agace et réveille en son esprit auparavant accoisé et recolligé... (un besoin de) rechercher désordonnément la source et les circonstances de son mal; une présomption à s'élever, aigrir, ennuyer et impatienter de la privation du sentiment...; une affectation propriétaire d'un certain repos sensible.
Il faut donc pour tirer de cette épreuve, tout le bien et la désappropriation que Dieu veut qu'elle nous apporte,
a) s'occuper « beaucoup plus, à tirer fruit de ses tentations qu'à les éplucher et discuter» ; b) s'abaisser « intérieurement comme une chose de néant... et reconnaissant être bien raisonnable que Dieu la mette en l'échelle de Satan par tentations, puisqu'elle a si peu profité en l'échelle de Dieu par ses consolations, puis les acceptant avec patience » ; c) « en renonçant volontairement au repos intérieur qu'elle ressentait avant la privation et la tentation, et s'accoutumant à ne les (le) fonder plus ès sentiments, mais au vouloir de Dieu qui ne s'accomplit pas moins en cet état qu'en l'autre ».
Non moins exact, Binet est peut-être plus tapageur :
Il faut trouver bonne la soustraction que Dieu fait et s'y porter avec grande joie et promptitude, étant bien aise qu'il ne veuille pas que la partie supérieure secoure l'inférieure... Il ne se faut pas mettre en peine de chasser les tentations avec de grosses pénitences..., comme on faisait en son noviciat, parce que les tentations s'augmentent plutôt, comme on lit ès vies des Saints. Mais il se faut soumettre à Notre-Seigneur avec grande humilité,
40
endurer fort volontiers, et du reste les mépriser et ne s'en soucier nullement.
Il est trop évident que l'allégresse où nous invite ici le P. Binet, comme le fera plus tard Mlle Guyon, est aux antipodes de la délectation morose. On endure « fort volontiers », non pas du tout les mala gaudia qui accompagnent nécessairement la tentation, mais bien au contraire, et comme voulue de Dieu, l'étrange peine que ce plaisir involontaire apporte à une âme qui ne craint rien davantage que le péché.
§ 4. - Dieu enlève à l'âme le pouvoir de réfléchir sur son intérieur.
Forcé de quitter le sentiment (de vertu) par la privation d'icelui et la tentation de sa partie inférieure, (l'amour-propre) a bien su trouver un autre Bite pour se musser et un autre sujet pour se divertir de Dieu et s'arrêter en soi-même... Le point auquel l'amour-propre s'est réfugié... est une assurance intérieure que l'âme prend en ses actions internes de vertu par une réflexion qu'elle exerce en icelle, et appuie en elle-même et en sa vertu, et non en Dieu. (Cette assurance, Dieu) la veut ébranler et renverser de fond en comble; et afin que ce soit sans préjudice de la vertu interne et actuelle, qui toutefois sert de fondement et entretien à cette perverse et fausse assurance, Dieu ne permet en rien son efficace être diminuée, ains seulement il la cache à l'âme... Il soustrait la réflexion par laquelle elle venait à discerner et ressentir la vertu actuelle, d'où vient qu'elle ne paraît non plus que si elle n'y était point, et que ce néanmoins elle n'est en rien diminuée, vu que sentir et reconnaître les opérations n'est point vertu proprement, aies seulement satisfaction et contentement de vertu.
Ainsi Bérulle, usais comme c'est ici un point de grande conséquence, j'ajoute la version de Binet, qui doit serrer de plus près le texte de Gagliardi:
Dieu ne soustrait pas les vertus, ni aussi peu les dons; car cela demeure en son entier; non pas même les actions des
41
vertus, de façon que l'âme en soit tout à fait dégarnie... En nos actions intérieures et spirituelles, il y a deux sortes d'actes. L'un est droit, qui est celui qui sort de la vertu, qui désire jouir de son objet (atteindre son objet irait mieux)... L'autre est un acte réfléchi sur le premier, qui se fait à l'heure que la personne prend garde et fait réflexion qu'elle fait un acte d'amour, de tempérance, etc., qu'elle y prend plaisir à le faire..., qu'elle remarque le courage qu'elle a, faisant cet acte, qu'elle se voit victorieuse de la tentation avec un repos d'esprit qui est très grand. Au reste, le premier de ces deux actes est le vrai et pur acte de vertu; le second n'est que le fruit qui en revient à l'âme... Or il est bien aisé de voir que l'acte de la tempérance ne consiste pas au plaisir qu'on y prend..., mais à le vouloir et à le faire. Dieu donc concourt au premier acte, et partant on ne laisse pas de faire de beaux actes de vertu en cet état-là, mais il retire son concours au second acte, c'est-à-dire à notre réflexion, jugement, connaissance et plaisir d'avoir fait cette action de tempérance. De là vient que nous la faisons et si nous semble pourtant que nous ne la faisons pas. La vertu ne consiste pas au contentement que nous en tirons, ni à nos réflexions. C'est pourquoi Notre-Seigneur, - lequel a entrepris de nous dénuer de tout intérêt et contentement nôtre, comme d'un obstacle qui s'interpose entre lui et nous - prend plaisir à nous laisser ce qui est de pur et net en la vertu, c'est-à-dire la vouloir et la pratiquer, et nous sèvre et prive du second, qui est un certain amour-propre, bien plus fin que les autres susdits, et un propre intérêt, duquel l'âme s'engraissait et se divertissait d'une plus grande union avec son Dieu... (Ainsi) par un merveilleux artifice de Dieu, l'âme est épurée en l'exercice de la vertu, et purgée de toute propriété et intérêt le plus occulte qui puisse être.
Que tout cela paraît lumineux!
§ 5. - Dieu dépouille l'âme des actes mêmes de vertu.
Qui penserait jamais - s'écrie le P. Binet au paroxysme de l'émerveillement - qu'après tant de retranchements, il y eût encore quelque chose dans l'âme dont on la pût et dût dépouiller? Et nommément, voyant l'âme réduite à ce point qu'elle ne saurait faire que le seul et pur acte de vertu, et l'acte droit
42
auquel ne semble pas qu'il y puisse avoir aucun intérêt et amour-propre ains une pure vertu et entièrement dénuée. Toutefois, si nous considérons que cet acte, quoique épuré et bien affiné, ne laisse pas pourtant de sortir de notre volonté et libre élection, qui peut avec sa vertu active oeuvrer et commander aux puissances inférieures de faire leur devoir..., on ne peut bonnement nier qu'il y ait encore de la propre volonté, et de notre intérêt, quoique très épuré ; partant il y a encore quelque chose qui se peut purifier davantage et dont il se faut dépouiller.
Notre-Seigneur a donc de coutume ,trouvant une âme... à laquelle il n'a laissé autre pouvoir que de faire ces actes (droits ou directs) de vertu (pure) - de se retirer petit à petit, et ôter la puissance de faire ces actes de vertu, la privant tantôt de l'un, tantôt de l'autre, jusques à tant qu'il les ait ôtés trestous, hormis la conformité avec sa divine volonté. L'expérience montre assez que quelquefois l'âme se trouve tellement accablée d'ennuis..., assiégée de tant de distractions et assaillie de tant de misères que, se voulant contraindre, il n'est pas en sa puissance d'arracher aucun acte ni de remerciement à Dieu, ni de courage, ni de patience, ni d'autre vertu quelle qu'elle soit, si ce n'est de vouloir ce que Dieu veut, et, au reste, pâtir... Elles n'ont point aucune vertu active, ni puissance de faire aucun acte de vertu, puisque Dieu se retire, mais peuvent seulement endurer tout ce que Dieu permet, et pour l'amour de lui, s'en contenter.
Remarquez, je vous prie, ces mots, vingt fois répétés : plus de vertu possible « si ce n'est de vouloir ce que Dieu veut ». Quelques formules très claires de Bérulle sont ici à retenir :
Et en dernier lieu, (Dieu enlève à l'âme) ce même acte intérieur de vertu, non toutefois pour la dégarnir de la vertu, mais pour l'élever à une manière de l'opérer plus simple et plus parfaite, et non tant procédante des actes et affections internes de chaque vertu particulière, comme d'une simple refusion d'amour de Dieu.
L'action que Gagliardi prête ici à Dieu serait donc, si je comprends bien, plutôt simplifiante que dépouillante. Ce qui est soustrait à l'âme, ce n'est pas à proprement parler son activité, mais le pouvoir d'appliquer cette activité « à
43
chaque vertu particulière » : soustraction qui, non seule ment laisse entière, mais encore redouble, exalte en la libérant, notre activité la plus haute, à savoir celle qui adhère amoureusement à la volonté divine. Nous verrons plus loin que cette adhésion elle-même, Gagliardi veut encore qu'elle se laisse paralyser par la grâce; mais au degré où nous sommes présentement, elle reste sauve. Il distingue donc dans notre activité, comme deux étages, deux foyers; l'étage où sont produits un à un les actes de différentes vertus ; l'étage où seule se manifeste « une manière d'opérer plus simple et plus parfaite », c'est-à-dire, toujours si je comprends bien, le foyer d'un amour qui serait si intensément et par suite si exclusivement amour que nul autre objet, même excellent - humilité, patience -, ne pourrait plus occuper le vouloir profond, le distraire, le colorer, le nuancer, le diversifier. De ce point de vue, l'amour lui-même ne serait plus vertu particulière, mais quintessence globale de toutes les vertus ; doctrine chère à saint Augustin. Plus encore : le mot même d'acte, impliquant un je ne sais quoi de particularisé, de morcelé, d'évanescent, ne conviendrait plus que faute de mieux aux manifestations de cette activité essentielle. Et d'autant moins qu'ici tout l'agir est un pâtir ; une dilatation de toute l'âme se donnant au Dieu présent qui se donne à elle ; Dieu voulu en même temps que reçu, et parce que reçu. Que cette psychologie nous déconcerte d'abord, je le sais mieux que personne. Mais puisque les saints agissent plus parfaitement que nous, faut-il s'étonner que ceux d'entre eux à qui la spéculation est familière se fassent de l'activité pure une idée où notre expérience propre a quelque peine à se reconnaître ? Car enfin, j'admets comme un axiome que nous avons affaire ici à plus fort, à plus éclairé, à plus expérimenté que nous: Gagliardi n'est pas un bateleur. Et puis que fait-il autre chose que dire, à sa manière, ce que nous ont enseigné déjà les maîtres de la métaphysique des Saints, et notamment le P. Piny ? Mais il n'en est pas moins remarquable qu'au seuil du
44
degré suréminent où nous arrivons, le jeune Bérulle soit pris de vertige. Ce n'était pas l'intrépide fanfaron que nous disent ses ennemis. Il n'a retenu de ces pages difficiles que ce qu'il en a pu s'assimiler, beaucoup plus, hélas! qu'il n'en faut pour que j'aie moi aussi le vertige. Mais, par bonheur, Binet nous reste. A celui-ci rien ne parait trop sublime ni trop subtil. S'il ne comprend pas, ou pour mieux dire, s'il ne réalise qu'à moitié la pensée de Gagliardi, du moins il la traduit et en virtuose (1). En route donc avec lui pour les derniers degrés du dépouillement mystique.
§ 6. - Dieu dépouille l'âme de l'acte même de conformité ou d'amour.
(Dieu) passe encore plus outre, et nous ôte voire même cet acte ici de conformité..., de façon que l'âme, non seulement ne s'aperçoit pas de le faire, mais ne le peut faire (du) tout, puisque Dieu se retire tout exprès et à l'heure la pauvre âme demeure en un certain repos et vie passive, laissant faire à Dieu tout ce qu'il lui plaira d'elle, comme ferait un pauvre petit agnelet entre les mains d'un qui lui tond sa laine... Et ceci est soustraire à l'âme toute sa vertu active, c'est-à-dire que Dieu retire réellement son concours et sa divine assistance : que, pour l'heure, l'âme ne peut nullement eu sa partie supérieure faire aucune action, pour sainte et excellente qu'elle puisse être, puisqu'elle seule ne le peut et Dieu ne veut point y porter la main de son aide. Tout ce qu'elle peut est de supporter volontiers tout ce qu'il plaira à Dieu de permettre.
Si j'avais le droit d'écouter ici les réactions de mon incompétence, je dirais à Gagliardi qu'il me semble piétiner. « Supporter volontiers », l'inaction où Dieu condamne ces hautes âmes, n'est-ce pas agir? Que peut-on concevoir de plus héroïque, et par suite, de plus actif? Fort de l'expérience
(1) Binet n'entend pas, du reste, que le premier venu s'aventure sur de tels sommets. Il nous prévient à ce sujet dans son avis au lecteur : « Je dispenserai beaucoup de personnes de lire le dernier chapitre et le 3e degré. Car, de vrai, il est trop relevé pour le vulgaire, je dis le vulgaire des personnes spirituelles, et, pour les gens du monde, ils n'y entendront goutte. »
45
des saints, il me répondrait qu'on peut imaginer un dépouillement plus radical.
(Il faut donc), reprend Binet, avec une grande libéralité renoncer et se dépouiller de tout acte de vertu et de tout ce qui peut agir en nous.
Formules extrêmes peut-être, mais qui s'atténueront ou s'expliqueront, chemin faisant. Ce « repos passif » où l'âme se trouve ainsi réduite, donne de grandes forces, non pas pour opérer, mais pour s'abandonner à Dieu ». C'est toujours la même contradiction apparente ; « s'abandonner » n'est-ce pas « opérer » ? Eh ? sans doute, mais d'une manière toute divine, et qui n'en est, pour cela, que plus humainement, plus vraiment, plus activement active. Il y a là, pour nous, un mystère, non pas une absurdité.
Ce repos est suivi d'une conformité avec la divine volonté, mais une conformité passive et bien plus excellente que la susdite; item une déification plus ineffable, non pas comme les autres qui font des donations, oblations, dédicaces, sacrifices et holocaustes, mais se donnant en proie à Dieu de façon que nous ne sachions rien faire, sinon permettre que Dieu dispose absolument de nous tout comme il lui plaira (1).
Il met donc très certainement une différence entre les actes qu'il vient de désigner, oblation, donation... et cette permission, cet abandon total par où toute l'âme se donne en proie à Dieu. Doctrine commode, gémit le chur des anti-mystiques. Cette belle passivité vous dispense, en effet, de vous conduire, au dehors, comme les simples chrétiens ; vous permet tous les scandales. L'objection est plus stupide encore que venimeuse ; car,
jamais on ne perd les actes extérieurs de vertu;
(1) On le remarquera, au fond de cette passivité se cache ce qu'il y a de plus vivant et de plus actuel dans l'amour : l'adhésion à Dieu.
46
il y a loin, très loin, de la passivité mystique à la paralysie générale :
Ains, avec plus de vigueur que jamais, l'homme a la puissance de mettre en oeuvre les parties de son corps et ses facultés pour parler, penser..., faisant actes de tempérance, patience et autres... La volonté a encore l'acte de commandement et ménage tous les actes qui sont commandas... Quand on parle ici de soustraction, cela s'entend en l'entendement et en la volonté, selon leurs propres actes intérieurs de volition, intention, fruition...
Tout ce que nous appelons - et très improprement sans doute - opérer, agir, lui est soustrait. Elle se voit, ou plutôt, sans le voir distinctement, elle se trouve « réduite au fond, et dans le sein le plus profond - que les théologiens mystiques appellent apex animae, -le pouvoir d'opérer lui étant ôté » et « sans pouvoir produire aucun acte, hormis que pour l'amour de Dieu » elle veut se laisser faire par lui. Mais, « à l'heure où elle se soumet » ainsi, Dieu opère au dedans d'elle « des actes très sublimes, avec le consentement passif et libre d'icelle, comme de remerciement, d'amour, d'union avec lui..., sans que l'âme se sente de faire ces actions, mais seulement les recevant et y coopérant de tout son coeur », entendez, de son coeur profond, de sa fine pointe.
Tout ainsi que l'esprit étant ravi en extase, et les sens étant assoupis, ne peut entendre par ses forces naturelles..., mais il reçoit une lumière divine qui lui fait voir des choses très hautes, et on opère en lui des choses merveilleuses, ce que les théologiens mystiques appellent pati divina...
passion active, puisque enfin ces « choses merveilleuses », l'esprit les « voit » ;
tout ainsi, dis-je, que Notre-Seigneur opère en l'esprit ravi, par-dessus ses forces naturelles, ces choses si étranges, aussi le pourra-t-il bien faire, et à plus forte raison, dans la volonté, quand elle est dépouillée de toute sa vertu active, et y renonce tout-à-fait.
47
Dépouillement relatif, ne cessons de le redire, et qui laisse à la volonté profonde tout son élan, puisque ce dépouillement de son activité ordinaire, l'âme l'accepte.
Aussi, est-ce l'heure que Dieu l'élève en une extase non spéculative, mais extase en pratique et très vertueuse...; et ceci est vraiment un pati divina, (puisque on y reçoit) les impressions divines en une façon bien plus relevée; parce que les extases de l'entendement sont bien plus dangereuses... (beaucoup plus rares), pleines d'occasions de curiosité et de propriété... Au reste, tout le inonde est capable de cette extase-ci, quoiqu'elle soit plus excellente que l'autre.
Page infiniment remarquable, s'il est vrai, comme je le crois, que tout l'effort - inconscient d'abord peut-être, mais de plus en plus délibéré - de la mystique moderne se ramène à substituer en quelque sorte, et à préférer, l'ancien pati divina de l'intelligence avec ses contre-coups physiologiques, au pati divina de la volonté. « Extase pratique », dit Gagliardi ; « extase des oeuvres », va bientôt dire
§ 7. - Dieu dépouille l'âme de sa volonté elle-même.
Devant ce degré suprême de renoncement, ni Binet, toujours intrépide, ni Camus toujours sensé, ne reculent.
48
Voyez-vous, écrit celui-ci, en cette passiveté ou souffrance de l'action de la grâce en nous..., il y a encore de nous et du nôtre..., et c'est à ce petit filet que se prend ou se pend l'amour-propre. Car ne voyez-vous pas que nous ne pâtissons cette opération divine que parce qu'il nous plaît de la souffrir, ayant une pleine puissance de la rejeter et repousser ? Or c'est sous cette pierre de liberté que se cache le scorpion de l'amour-propre.
Image parfaite. Cet extraordinaire Camus ferait comprendre le calcul infinitésimal à un enfant de huit ans ! Ah! si tous les mystiques savaient écrire, que de catastrophes n'aurait-on pas évitées !
C'est en jetant dans l'âme une secrète et presque imperceptible, complaisance de laisser agir la grâce.
Le dernier effort du renoncement sera donc « de trancher la tête à la volition propre », c'est-à-dire de « ne vouloir plus rien de soi-même comme de soi ». Dieu, par ces ultimes épreuves, fait que librement la volonté « détruit son être moral et malin qui consiste à vouloir par principe d'elle-même, et par une propriété qui en veut être indépendante ». Ainsi, traduit de son côté le P. Binet, l'âme se trouve privée « non seulement de pouvoir agir et de sa vertu active, mais aussi de la passive » que lui laissait encore le degré précédent. « Notre volonté a un si grand empire sur sa liberté qu'elle peut renoncer » à cette liberté elle-même. Elle se gouverne alors « tout ainsi que si elle n'en avait point ». « La volonté se rend comme sans volonté..., quitte tous ses droits et se résigne entre les mains d'une autre volonté. »
Tout ce qu'elle fait, elle ne le fait pas parce qu'elle le veut, ni parce que en cela sa volonté se trouve entièrement conforme à la volonté de Dieu, mais, quant à soi, elle renonce absolument à tout ce qui lui appartient.
Au dedans, comme au dehors, ce sont toujours les mêmes gestes ;
49
elle fait voirement tout ce qu'elle faisait auparavant, mais purement et simplement parce que Dieu le veut ainsi..., et non pas comme de soi-même, faisant son compte de n'être quasi plus au monde, et laissant absolument tout pouvoir... à la volonté divine.
Jusqu'ici « ma volonté voulait voirement endurer la croix, parce qu'elle se voyait en cela conforme avec la vôtre ». Mais elle dit maintenant à Dieu : Je porterai ma croix, « non pas parce que je le veux et que ma volonté en cela sera très sainte, mais purement et simplement parce que c'est votre volonté ».
Que votre volonté soit au lieu de la mienne... C'est en ce point que l'annihilation, expropriation, substraction, reluisent très parfaitement. Il n'y a point de conformité ; mais une chose bien (plus) relevée, parce que la volonté, avec cette renonciation, se lie, s'enfonce et s'abîme en Dieu; et, heureusement perdue, gît en celle de Dieu, et est souverainement déifiée et totalement identifiée en icelle (1). Et ce qui est à considérer est que tout ceci se peut pratiquer réellement, aisément, et possible plus aisément qu'il ne se peut dire, quoique j'aie tâché de le dire le plus intelligemment qu'il m'a été possible.
Il se peut fort bien que le Sume... voluntatem de saint Ignace aille aussi loin, mais, quoi qu'il en soit, il est bien évident que saint
Et lors, le coeur ne dit plus « Votre volonté soit faite et non la mienne », car il n'a plus aucune volonté à renoncer?... Ce n'est pas proprement comme les serviteurs suivent leurs maîtres (car) la volonté du maître et celle du serviteur sont deux... ; (au lieu que) la volonté qui est morte à soi-même..., elle est sans
(1) Je ne suis pas sûr que Gagliardi entende la déification dont il parle eu fonction, si l'on peut dire, de la grâce sanctifiante. N'est-il pas ici plus philosophe que théologien? En tout cas, l'accent est sur la suppression du moi, plus que sur l'infusion divine.
50
aucun vouloir particulier, demeurant, non seulement conforme et , sujette, mais tout anéantie en elle-même et convertie en celle de Dieu (1).
C'est exactement, et presque dans les mêmes termes, le texte de Gagliardi que nous venons de lire. Je n'oserais affirmer qu'en écrivant de la sorte, le saint a sous les yeux la traduction française du Compendio (l'Abrégé de la perfection) qu'il connaissait bien, mais je crois la chose fort probable. Quoi qu'il en soit, l'important est pour nous que le saint docteur nous invite aussi au plus haut degré de l'échelle gagliardienne. Après quoi, je ne me donnerai pas le ridicule de défendre l'orthodoxie de ce grand jésuite, Achille Gagliardi. Au surplus, me semble-t-il de taille à se défendre tout seul. Bien malin qui trouvera le défaut de sa cuirasse. Rompu à l'argumentation et aux précisions scolastiques, lucide et ferme, plus maître de sa pensée et de sa plume que tel ou tel parmi les mystiques de son Ordre, le P. Guilloré, par exemple, il ne manque pas d'une certaine ferveur massive, mais avant tout il est philosophe. Les objections que pourraient lui faire les étourdis ou les malveillants, il les a prévues. Celles qu'il n'écarte pas d'un revers de main, c'est qu'il les juge par trop futiles. Avec cela, il est légion. Pour peu que l'on soit familier avec les grands mystiques de l'âge moderne, il saute aux yeux que le Breve Compendio n'apporte rien de nouveau. A chaque paragraphe de cet opuscule, je pourrais épingler vingt textes, empruntés aux maîtres les plus vénérés, et qui affirmeraient, presque dans les mêmes termes, ce qu'affirme Gagliardi. Ses défauts, s'il en a, n'intéressent pas la doctrine. Croyez-en plutôt saint
Vous pourrez utilement lire les livres de la Mère Thérèse..., la Méthode de servir Dieu, l'Abrégé de la Perfection Chrétienne
(1) Jai cité et commenté ce grand texte de saint
51
(Breve Compendio), la Perle évangélique; mais ne vous empressez point à la pratique de ce que vous y verrez de beau, mais allez tout doucement aspirant après ces beaux enseignements... La Méthode, la Perfection, la Perle, sont des livres fort obscurs et qui cheminent par la cime des montagnes; il ne s'y faut pas amuser (1).
Remarquez son premier mouvement, qui est de conseiller en vrac, si l'on peut dire, ou de mettre sur la même ligne les livres de sainte Thérèse et l'opuscule de Gagliardi. Sur l'orthodoxie foncière de ce dernier, un tel rapprochement en dit assez long. Mais aussitôt, il se ravise. Il songe à la générosité impétueuse de Mme de Chantal, encore novice, pressée de brûler toutes les étapes sur le chemin de la perfection. Ces enseignements, quoique « beaux », ou plutôt parce qu'ils sont beaux, ne menacent-ils pas ou de l'éblouir ou de l'accabler? Qu'elle se résigne donc pour l'instant au train-train des « basses vallées ». Qu'elle s'en tienne à un autre petit livre qui n'a jamais tourné la tête à personne, et que
Ce petit livre est la parfaite anatomie de la vertu et de la perfection. Je ne crains qu'en voulant faire un présent à la France, je ne fasse monter la couleur au visage de ceux qui se donneront la patience de le lire. Certes si la vertu n'est bien fine et de vingt-quatre carats, en la portant à ce parangon, elle se trouvera de bas or. On dit que l'empereur Aurelian attacha au temple de
(1) Oeuvres complètes, XIII, pp. 334, 335. Je ne crois pas, du reste, que sa lettre de 1607 sur Gagliardi, saint
52
Jupiter un lambeau de fine écarlate qu'on lui avait envoyé des Indes. Tous ces seigneurs romains et ces dames y allaient confronter leurs habillements, et s'en retournaient honteux, trouvant toute sorte d'écarlate si blafarde et si basse en couleur au prix de celle des Indes qu'il n'y avait d'apparence de faire aucun état de l'écarlate romaine... Ou je me trompe fort ou beaucoup de personnes qui se tiennent au rang des plus spirituelles, lisant ce livre, auront pitié de leur vertu et se jugeront être seulement à l'apprentissage de la perfection.
Va-t-il conclure de là, comme saint
Pour moi, écrit-il, je confesse franchement qu'en le traduisant, j'ai été tout étonné, voyant les belles lumières qui y éclatent et des maximes de vie parfaite très hautes et, ce qui est admirable, TRÈS AISÉE A PRATIQUER ET A ENTENDRE... Si vous avez envie d'être parfait, et EN PEU DE TEMPS ET BIEN SOLIDEMENT, jetez les yeux sur ce petit livre.
Nul besoin de souligner l'importance d'une pareille approbation, aussi entière, aussi chaleureuse. Le vieux Binet, ce vétéran de la littérature ascétique et dévote, ce Rodriguez amusant, vient de découvrir, et avec un enthousiasme qu'on n'eût pas attendu de ses cheveux blancs, l'Atlantide mystique. Lui qui a tant lu et tant écrit sur la vie parfaite, il n'avait jamais rien rêvé de si beau. Aussi, dare-dare, a-t-il voulu faire de ce trésor inouï « un présent à la France ». Comme, d'ailleurs, il est très intelligent, d'une part il a balayé à sa vive façon les objections puériles qui n'ont pu manquer de s'offrir d'abord à lui, et de l'autre, balayant du
53
même coup les préjugés, assez fortement ancrés chez lui, de l'ascéticisme, il a clairement compris que de tels ouvrages, bien loin de compromettre, voire de paralyser tout à fait les solides progrès de l'âme, offraient, au contraire, le moyen le plus sûr, le plus court, un moyen infiniment simple, d'arriver à la perfection. Voilà donc, résumé aussi brièvement que possible, ce prodigieux opuscule. Pour moi, parmi les sentiments divers que j'éprouve à le manier, la stupeur domine. Que Gagliardi, sous la dictée d'Isabelle, ou qu'Isabelle sous l'inspiration de Gagliardi inspiré lui-même par les mystiques antérieurs, aient poussé les exigences de l'amour à de tels degrés d'anéantissement, cela n'aurait pas de quoi nous surprendre ; mais que cette synthèse aussi dépouillée d'onction, de poésie, d'éloquence; que cette géométrie morne et glaciale ait séduit, ait comblé, pendant si longtemps, non pas seulement une poignée de contemplatifs, mais une foule d'âmes dévotes, en Italie d'abord, puis, et plus nombreuses semble-t-il, chez nous, voilà qui dépasse l'imagination! Les faits sont là néanmoins, et les témoignages. Quelle leçon pour l'historien, au début du présent volume, quelle lumière sur l'invincible attrait qu'exercera dans tous les milieux et jusqu'à la fin du XVII° siècle cette charte de l'amour anéantissant. A la fin du siècle, lorsque sous l'inspiration d'une seconde Isabelle, un second Gagliardi enseignera une doctrine semblable, chacun les, appréciera comme il l'entendra, mais ils ne feront figure de novateurs qu'aux yeux de ceux qui ne connaissent pas l'histoire antérieure de la spiritualité française. Discuter l'orthodoxie de Gagliardi n'est pas non plus mon affaire et je ne me donnerais pas le ridicule de défendre ce grand jésuite. Au surplus, un docteur de l'Église, saint
54
Surin et Rigoleuc ; l'autre courant spirituel de la Compagnie, représenté par Etienne Binet..., en présence d'une telle unanimité, ne faut-il pas avouer que si Gagliardi et Isabelle, et derrière eux leurs unanimes, Fénelon et Mme Guyon, sont quiétistes, toute la France mystique d'Henri IV et de Louis XIII l'est également. J'entends bien que cette conclusion étonnera plus d'un lecteur et j'avoue que les textes que j'ai apportés jusqu'ici ne l'imposent pas assez. Mais qu'on veuille bien considérer que le présent chapitre n'est qu'un prélude, qu'une première prise de contact avec le sujet. De ces deux aventures spirituelles qui me semblent se répéter, à un siècle de distance, nous ne connaissons pour l'instant que la plus ancienne ; l'autre nous occupera plus loin. Aussi bien le rapprochement que je viens d'indiquer, à la manière des prophètes, n'est-il pas de mon invention, j'en dois l'idée au R. P. A. Pottier, de la Compagnie de Jésus. Sans lui, ma candeur n'eût jamais flairé le venin quiétiste que distille l'opuscule de Gagliardi et d'Isabelle. Il est vrai que ce docte critique n'a pu mettre à profit les travaux tout récents qui ont éclairci le mystère de cet opusculeu. Quoi qu'il en soit de l'auteur du traité, écrit-il, la spiritualité qui s'y développe est aux antipodes de la spiritualité de la Compagnie ». Évidemment, c'est là un peu se hâter d'excommunier en bloc le P. Gagliardi, les jésuites milanais qui ne juraient comme lui que par Isabelle, les PP. Binet, Surin, Rigoleuc et d'autres encore. N'ayant eu, d'ailleurs, sous les yeux ni l'édition italienne du Breve Compendio, ni les nombreuses traductions qui en ont été faites chez nous, pas même celle de Binet, le R. P. Pottier n'a étudié l'oeuvre gagliardienne que dans l'adaptation qu'en a donnée Pierre de Bérulle, à savoir le Bref Discours de l'Abnégation intérieure. Et c'est tant mieux pour nous qui savons que Bérulle a expulsé du texte original les passages les plus troublants. Si le texte ainsi delphinissé parait encore tout guyonien au R. P. Pottier, combien plus le Breve Compendio lui-même ou la traduction plus
55
complète de Binet. In arido quid fiet (1) ? Au demeurant, il a bien raison et je me rends allègrement à sa clairvoyance. Peut-être même irais-je plus loin que lui, avouant sans barguigner que des deux Moyen Court - celui de Gagliardi, celui de Mme Guyon -, le premier parait d'abord plus que le second, « contaminé de quiétisme » ; moins précautionné et plus dangereux (2). C'est bien, de part et d'autre, exactement point par point la même philosophie de l'amour anéantissant, la même consigne impitoyable de dépouillement, d'oubli de soi, de sacrifice ; mais il y a, chez Mme Guyon, plus d'esprit
(1) L'étude comparée du Breve Compendio italien et du Brief Discours montrerait chez le jeune Pierre de Bérulle une sûreté doctrinale et une prudence deux fois remarquables. Cf. à ce sujet les remarques pénétrantes de M. Dagens, réponse implicite mais décisive aux après critiques du R. P. Pottier Dagens, op. cit., passim et plus expressément, pp. 343, seq., M. Dagens incline à croire - et c'est en effet très vraisemblable - que le mérite principal de cette adaptation atténuée reviendrait à Dom Beaucousin. A quoi je dois ajouter d'un mot qu'en écrivant les Maximes des Saints, Fénelon se proposait aussi de corriger le Moyen Court de Mme Guyon, un peu comme Bérulle le Breve Compendio. C'est que, différant en cela de Gagliardi, Fénelon n'a jamais cru que sa « mère spirituelle » fut directement inspirée d'en haut. (2) R. P. Aloys Pottier, S. J. Essai de théologie mystique comparée. Le P. Louis Lallemand et les grands spirituels de son temps, III, La spiritualité bérullienne..., Paris, 1929, pp. 1o5 seq. Ce chapitre est des plus curieux. Pour montrer, par exemple, que la spiritualité du Brief Discours est « aux antipodes de la spiritualité de la Compagnie », le Révérend Père se fonde sur « le pessimisme augustinien » qui assombrirait, pense-t-il, cet opucule : « La spiritualité de la Compagnie, écrit-il, n'a rien de ce pessimisme ; elle est ouverte à l'humanisme dévot. « Vraiment c'est là jouer de malheur, puisque l'une des traductions du Breve Compendio est dûe à un des chefs de l'humanisme dévot, le P. Binet. Aussi bien la base philosophique du Breve Compendio n'est-elle pas le dogme du péché originel, mais le dogme de la création. Plus loin, ayant cité un long passage du texte, le Révérend Père conclut : « Mme Guyon ne parlait guère autrement... et Benoit de Canfeld disait-il donc autre chose ? », p. 19. Inutile d'ajouter que pour le R. P. Canfeld est quiétiste. N'a-t-il pas été mis à l'index, « en même temps que des ouvrages plus ou moins quiétistes de Jean Falconi, de M'"° Guyon? », p. roi. Pourquoi ne pas ajouter : du P. Surin? Comment Bérulle ne serait-il pas quiétiste? N'a-t-il pas pour directeur Dom Beaucousin, et celui-ci ne figure-t-il pas parmi les approbateurs de Canfeld? « Nulle part, à ma connaissance, dit-il encore, le quiétisme n'a poussé sa pointe aussi loin dans les oeuvres de Bérulle », pp. 107, 108. D'où l'on peut conclure que si le Brief Discours est le plus quiétiste des ouvrages bérulliens, il n'est pas le seul, etc., etc. La thèse générale du R. P. est d'ailleurs fort simple : tout ce qu'il y a d'excellent dans la doctrine bérullienne, Bérulle l'a emprunté à la « tradition ignatienne » ; tout ce qui ne vient pas de là est plus ou moins suspect. C'est ainsi que, dans l'entourage de Corneille, on jugeait Racine.
56
de finesse, une méthode moins accablante ou moins inhumaine. On n'attend pas de moi sans doute que j'entre ici dans le détail de ce parallèle. Aux spécialistes de comparer page à page ces deux livres. Ou je me trompe fort, ou l'expérience tournera comme je dis. Sans compter qu'un théologien de métier est moins excusable qu'une femme de ne pas peser tous ses mots. Le Moyen Court de Gagliardi ne peut même se flatter d'avoir échappé aux condamnations de l'Église. Il a été mis à l'index en 17o3; pris dans le sillage des Maximes des Saints, il avait alors plus de cent ans. On sait bien, du reste, que les sentences des congrégations romaines n'atteignent pas nécessairement la substance doctrinale d'une oeuvre. Le R. P. Pottier lui-même donnerait aujourd'hui son imprimatur doctoral à tel livre également condamné du P. Surin. Sans doute aussi aurait-il montré plus d'indulgence au Breve Compendio, s'il avait su que ce livre était l'oeuvre d'un jésuite, s'il avait été moins pressé de prendre le fondateur de l'Oratoire en flagrant délit de guyonisme. Chétif épisode et sur lequel je n'appuierais pas si lourdement s'il n'éclairait d'une lumière crue la guerre de cent ans que nous allons raconter. Qui veut noyer son chien le dit enragé. Au XVI° siècle, quand on veut se défaire de quelqu'un, on l'accuse d'illuminisme ; la Compagnie naissante en a su quelque chose; au XVII° siècle, de jansénisme et de quiétisme. Au XX° siècle, pour exterminer Bérulle, on l'accuse de guyonisme. A l'origine de presque tous ces procès, pas n'est besoin d'ausculter longtemps la conscience des accusateurs, pour y découvrir la passion, extra-doctrinale, si l'on peut dire, où s'est allumé leur zèle.
|