| |
Chapitre 36 Étant partie de cette ville (Tolède), je m'en revenais fort joyeuse, et j'acceptais de grand cur tout ce qu'il plairait à mon divin Maître de me faire souffrir. Le soir même de mon arrivée ici (Avila), nous reçûmes les dépêches de Rome et le bref pour l'établissement de notre monastère . Ma surprise fut grande, et ceux qui savaient de quelle manière Notre Seigneur m'avait pressée de revenir, ne furent pas moins étonnés quand ils virent combien ma présence était nécessaire, et dans quelle conjoncture le divin Maître me ramenait. Je trouvai dans la ville l'évêque, le saint frère Pierre d'Alcantara et ce vertueux gentilhomme (François de Salcédo) qui le logeait chez lui, les serviteurs de Dieu trouvant toujours dans sa maison asile et bon accueil. Ils s'employèrent tous deux auprès de l'évêque, et le déterminèrent à prendre sous sa juridiction le nouveau monastère. Comme il devait être fondé sans revenus, la faveur demandée au prélat n'était pas petite; mais il était si affectionné aux personnes en qui il voyait une ferme résolution de servir Dieu, qu'il se sentit aussitôt disposé à nous aider. Ce fut le bienheureux Pierre d'Alcantara qui fit véritablement tout, soit en approuvant notre. entreprise, soit en nous ménageant la faveur de plusieurs personnes. Si, comme je l'ai dit, je n'étais pas arrivée dans un moment si favorable, je ne vois pas comment notre dessein eût pu réussir. En effet, le saint vieillard ne passa ici que huit jours tout au plus, durant lesquels il fut fort malade, et Dieu l'appela à lui très peu de temps après (le 18 octobre 1562). Il semble que sa divine Majesté n'avait prolongé sa vie que pour conduire à terme cette entreprise; car, depuis plus de deux ans, si mon souvenir est fidèle, ses forces étaient entièrement épuisées. Tout se fit dans le plus grand secret, et si l'on ne s'y fût pris de la sorte, je ne sais si on aurait pu rien exécuter, tant la ville était opposée à un tel dessein, comme la suite le fit voir. A cette époque, Notre Seigneur envoya une maladie à un de mes beaux-frères (Jean de Ovalle, mari de Jeanne de Ahumada); sa femme étant absents de cette ville, il se trouvait dans un tel abandon, qu'on me permit de demeurer auprès de lui. Ainsi l'on ne se douta de rien. Il s'élevait bien quelques légers soupçons dans l'esprit de certaines personnes, mais elles ne pouvaient y croire. Chose admirable! la maladie de mon beau-frère ne dura que le temps nécessaire à notre affaire; et lorsqu'il fut besoin qu'il recouvrât la santé, pour que je pusse retrouver ma liberté et que lui-même pût quitter la maison, Notre Seigneur la lui rendit si soudainement qu'il en était émerveillé. Ce que j'eus à souffrir ne fut pas peu de chose. J'avais bien des démarches à faire auprès d'un grand nombre de personnes, pour obtenir leur approbation. Je devais en même temps soigner mon malade, et, en outre, presser les ouvriers de donner au plus tôt à la maison quelque forme de monastère; car les travaux étaient encore bien loin d'être terminés. Ma compagne n'était point dans la ville; nous avions pensé que son absence couvrirait mieux notre dessein. Plusieurs raisons m'engageaient à hâter l'ouvrage; je craignais, en particulier, qu'à tout moment on ne m'ordonnât de retourner à mon monastère. J'eus tant de peines à essuyer, qu'il me vint en pensée si ce n'était pas là cette grande croix que Notre Seigneur m'avait prédite; je la trouvais néanmoins légère auprès de celle dont je m'étais fait l'idée. Enfin, tout étant prêt pour la fondation, il plut à Notre Seigneur que le jour même de la fête de saint Barthélemy, quelques filles prissent l'habit , et que le très saint Sacrement fût mis dans notre église; et ainsi se trouva légitimement érigé, en l'année 1562, avec toutes les approbations requises de l'autorité, le monastère de notre glorieux père saint Joseph. J'assistai à la prise d'habit avec deux religieuses de notre couvent, qui s'en trouvaient alors absentes. La maison où ce petit monastère venait d'être fondé était celle qu'habitait mon beau-frère; car, ainsi que je l'ai dit, c'était lui qui l'avait achetée, afin de mieux dissimuler notre affaire. De la sorte, j'y étais par la permission de mes supérieurs, et de plus, pour éviter le plus petit manquement à l'obéissance, je ne faisais rien que de l'avis de savants théologiens. Comme ils voyaient que, pour diverses raisons, mon dessein était très avantageux à tout l'ordre, ils m'assuraient que je pouvais en poursuivre l'exécution, bien que ce fût en secret et en prenant soin que mes supérieurs n'en eussent point connaissance. Si l'on m'eût dit qu'il y avait en cela la moindre imperfection, j'aurais abandonné non seulement ce monastère, mais mille monastères; ceci est certain. Car, quelque désir que j'eusse de l'établissement de ce couvent, pour y vivre entièrement séparée du monde, selon toute la perfection de mon état, et dans une clôture plus étroite, ce désir était de telle nature, que si j'avais compris qu'il était plus de la gloire de Dieu de tout abandonner, je l'aurais fait avec une tranquillité et une paix parfaite, comme je l'avais fait une autre fois. Ce fut pour moi un avant-goût de la gloire céleste, de voir cette petite maison honorée de la présence du très saint Sacrement, et de remédier à la nécessité de quatre pauvres orphelines, grandes servantes de Dieu, en les recevant sans dot. Dès le principe, j'avais désiré que les premières qui entreraient fussent, par leur exemple, le fondement de cet édifice spirituel, et propres à réaliser le dessein conçu par nous de mener une vie très parfaite et de très grande oraison. Je voyais enfin accomplie une uvre qui devait, je le savais, glorifier Notre Seigneur, et tourner à l'honneur de l'habit de sa glorieuse Mère. C'était là mon vu le plus ardent. C'était aussi pour moi une grande consolation d'avoir exécuté ce que Notre Seigneur m'avait particulièrement recommandé, et d'avoir élevé dans cette ville une église à mon glorieux père saint Joseph, qui n'y en avait point auparavant . Ce n'est pas que je crusse y avoir contribué en rien; une pareille pensée était alors comme elle l'est encore, bien loin de moi. Je le sais très bien, Notre Seigneur seul faisait tout; et si je lui prêtais quelque petit concours, j'y mêlais tant d'imperfections, qu'il me devait plutôt des reproches que de la reconnaissance. Mais je me sentais inondée de joie, en voyant que sa divine Majesté avait daigné se servir d'un aussi faible instrument que moi pour une uvre si grande; et cette joie remplissait tellement mon âme, que j'en étais comme hors de moi et tout absorbée dans une oraison profonde. Trois ou quatre heures après la cérémonie, le démon me livra un combat intérieur dont je vais parler. Il me mit dans l'esprit que peut-être j'avais offensé Dieu dans ce que j'avais fait, et manqué à l'obéissance en fondant ce monastère sans l'ordre de mon provincial. Celui-ci, je le sentais bien, devait voir avec quelque peine que j'eusse mis le couvent sous la juridiction de l'évêque sans lui en avoir rien dit; néanmoins, comme il avait refusé de le prendre sous la sienne, et que personnellement je restais sous son obéissance, il me semblait qu'il n'en serait point fâché. D'autre part, les religieuses que je venais de recevoir vivraient-elles contentes dans une si étroite clôture? Le nécessaire ne leur manquerait-il point? Cette fondation n'était-elle pas une folie? Pourquoi m'étais-je engagée dans cette entreprise, moi qui pouvais si bien servir Dieu dans mon couvent? Les ordres que j'avais reçus de Notre Seigneur au sujet de ce nouveau monastère, les avis des personnes sages que j'avais consultées, les prières que depuis plus de deux ans on n'avait pour ainsi dire pas cessé de faire à cette intention, s'effacèrent tellement de ma mémoire qu'il ne m'en restait plus la moindre idée. Je me souvenais seulement des pensées que j'avais eues par moi-même. Toutes les vertus, et même la foi, étaient alors suspendues en mon âme, et je n'avais la force ni d'en produire aucun acte, ni de me défendre contre tant d'attaques de l'ennemi. Le démon m'inspirait d'autres craintes: avec tant d'infirmités, pourrais-je m'enfermer dans une maison si petite, et m'y assujettir à un genre de vie si austère, après avoir vécu dans un monastère si spacieux, si agréable, où j'avais toujours été si contente, et où j'avais tant d'amies? Je ne me plairais peut-être pas avec celles qui composaient la nouvelle maison. Je m'étais engagée à bien des choses, et la difficulté de les accomplir pourrait me jeter dans le désespoir. Peut-être le démon avait-il prétendu par là m'ôter la paix et la tranquillité d'esprit; en proie au trouble, comment pourrais-je me livrer à l'oraison? Enfin, n'allais-je pas hasarder le salut de mon âme? Le démon présentait tout cela à mon esprit, sans qu'il me fût possible de penser à  autre chose; et il répandait en même temps dans mon âme une affliction, une obscurité, des ténèbres, que je ne saurais dépeindre. Me voyant dans cet état, je m'en allai devant le très saint Sacrement, bien que je fusse incapable de former une prière, une personne à l'agonie n'étant pas, me semble-t-il, dans une angoisse plus grande. De plus, je n'osais confier ma peine à personne, parce que je n'avais pas encore de confesseur désigné. autre chose; et il répandait en même temps dans mon âme une affliction, une obscurité, des ténèbres, que je ne saurais dépeindre. Me voyant dans cet état, je m'en allai devant le très saint Sacrement, bien que je fusse incapable de former une prière, une personne à l'agonie n'étant pas, me semble-t-il, dans une angoisse plus grande. De plus, je n'osais confier ma peine à personne, parce que je n'avais pas encore de confesseur désigné. O mon Dieu! Qu'elle est grande la misère de cette vie! Nul plaisir n'y est assuré, et tout y est sujet au changement. Il n'y avait qu'un moment, je n'aurais pas voulu, me semble-t-il, échanger mon bonheur contre toutes les félicités de la terre, et un instant après, ce qui avait fait ma joie me causait un tel tourment, que je ne savais que devenir. Ah! si nous considérions attentivement les choses de cette vie, chacun de nous verrait par expérience combien il doit faire peu de cas du plaisir ou du déplaisir qu'il y éprouve. Ce fut là, je puis le dire, un des moments où j'ai le plus souffert dans ma vie; mon esprit devinait, ce semble, toutes les souffrances qui m'étaient réservées, dont aucune cependant n'eût égalé celle-là si elle eût duré plus longtemps. Mais Notre Seigneur ne voulut pas laisser souffrir davantage sa pauvre servante, et il fut fidèle à m'assister dans cette tribulation, comme il l'avait fait dans toutes les autres. Par un rayon de sa lumière il me découvrit la vérité; il me fit voir que le démon était l'auteur de cet orage, et qu'il prétendait m'épouvanter par des mensonges. Rappelant alors à mon souvenir les grandes résolutions que j'avais formées de servir Dieu, et les ardents désirs que j'avais eus de souffrir pour lui, je considérai que si je voulais en venir aux effets, je ne devais pas chercher le repos; si je rencontrais des travaux et des peines, j'aurais aussi plus de mérites; et si j'endurais ces peines par amour pour Dieu, elles me tiendraient lieu de purgatoire. Pourquoi craindre? J'avais désiré des croix, je devais me réjouir d'en trouver de si bonnes à porter; plus la répugnance était grande, plus le profit serait considérable; enfin, pourquoi devais-je manquer de courage dans le service de Celui qui m'avait comblée de bienfaits? Animée par ces considérations et d'autres encore, et faisant un grand effort sur moi-même, je promis, en présence du très saint Sacrement, de solliciter, avec toutes les instances dont je serais capable, la permission de venir dans ce nouveau monastère et, si je le pouvais en sûreté de conscience, d'y faire vu de clôture. A peine avais-je fait cette promesse, que le démon s'enfuit, et me laissa dans un repos et un contentement qui n'ont jamais cessé depuis. La retraite profonde, les austérités et les diverses observances de cette maison ont pour moi une suavité extrême, et me semblent un joug bien léger. J'y goûte un si indicible bonheur, que je me dis quelquefois à moi-même: Où aurais-je pu choisir sur la terre une vie plus agréable que celle que je mène ici? Je ne sais si cela est cause que j'ai plus de santé que je n'en avais auparavant, ou si c'est Notre Seigneur qui, voyant qu'il est nécessaire et raisonnable que je donne l'exemple, veut me consoler en me donnant la force de supporter, quoique avec peine, les mêmes austérités que les autres. Ce qui est certain, c'est que toutes les personnes qui savent quelles étaient mes infirmités, ne peuvent le voir sans étonnement. Béni soit Celui qui est la source de tous les biens, et par la puissance duquel on peut tout! Je restai très fatiguée du combat que le démon me livra en cette occasion; mais quand je vis clairement qu'il en était l'auteur, je ne fis qu'en rire. Notre Seigneur, je crois, le permit pour me faire connaître la grâce signalée qu'il m'avait faite et le tourment dont il m'avait délivrée, en ne permettant pas que, depuis plus de vingt-huit ans que je suis religieuse, j'aie jamais été un seul instant mécontente de mon état. Il voulait aussi m'apprendre à voir sans crainte dans mes surs une tentation de ce genre, à leur porter compassion, et me mettre à même de les consoler. Cette tempête étant calmée, j'aurais bien voulu prendre un peu de repos après midi, n'en ayant presque pas eu dans toute la nuit, et ayant passé plusieurs des nuits précédentes, ainsi que des journées entières, dans des travaux et des soucis qui m'avaient extrêmement fatiguée. Mais cela fut impossible. Déjà la nouvelle de ce qui venait d'avoir lieu excitait une grande rumeur tant dans la ville que dans mon couvent; et comme je l'ai dit plus haut, ce n'était pas sans quelque apparence de raison. La prieure m'envoya l'ordre de revenir sur-le-champ; je partis sans délai, laissant mes religieuses plongées dans la peine. Je prévoyais bien des tribulations; mais comme le monastère était fondé, j'en étais fort peu émue. J'élevai mon âme à Dieu pour lui demander son assistance, et je suppliai mon père saint Joseph de me ramener dans sa maison, lui offrant ce que j'aurais à endurer, et m'estimant fort heureuse de le souffrir pour son service. Ainsi je partis, avec la conviction qu'on me mettrait aussitôt en prison; j'avoue que jen aurais été charmée, pour ne plus parler à personne et pour prendre un peu de repos dans la solitude, car j'en avais un extrême besoin, épuisée comme je l'étais d'avoir eu à traiter avec tant de monde. Lorsque je fus arrivée, j'exposai mes raisons à la prieure, et elle s'apaisa un peu. Cependant la communauté fit prier le provincial de se rendre au monastère, remettant toute l'affaire à son jugement. Dès qu'il fut venu, je me présentai devant lui pour être jugée, souverainement contente de souffrir quelque chose pour Notre Seigneur, sans néanmoins avoir rien fait en cette occasion ni contre sa divine Majesté, ni contre mon ordre. Je travaillais, au contraire, de toutes mes forces à son avantage, et de bon cur j'aurais donné ma vie pour ce sujet, car tout mon désir était d'y voir établie une entière perfection. Je me rappelai le jugement que Notre Seigneur eut à subir, et je vis que celui qui m'attendait n'était rien en comparaison. Je dis ma coulpe, comme si j'eusse été fort coupable, et je paraissais l'être à ceux qui ignoraient les motifs de ma conduite. Le provincial me fit une grande réprimande, non pas telle, toutefois que le délit semblait le mériter, vu les rapports qu'on lui avait faits. J'avais pris la résolution de ne rien dire pour me justifier, et je souhaitais réellement la tenir; aussi, je n'ouvris la bouche que pour lui demander pardon, pénitence, et pour le prier de n'être point fâché contre moi. En certaines choses, je le voyais, on me condamnait à tort: en disant, par exemple, que je n'avais agi que par vanité, pour faire parler de moi, ou par de semblables motifs. Mais voici d'autres plaintes très justes à mes yeux: j'étais, disait-on, moins parfaite que mes surs; n'ayant point fidèlement observé la règle dans un couvent où elle était si bien en vigueur, c'était témérité de ma part d'entreprendre d'en garder une autre plus austère. A cela on ajoutait que j'avais scandalisé la ville, et ne songeais qu'à introduire des nouveautés. Tout cela me laissait calme, et ne me causait point de peine; je témoignais cependant en avoir, pour ne pas donner sujet de croire que je méprisais ce que l'on me disait. Enfin le provincial m'ayant commandé, en présence de toute la communauté, de rendre compte de ma conduite, je fus obligée d'obéir. Comme mon âme était tranquille, et que Notre Seigneur m'assistait, j'exposai mes raisons de manière que ni ce père, ni les religieuses, ne trouvèrent de quoi me condamner. Je vis ensuite le provincial en particulier, et j'entrai avec lui dans plus de détails que je ne venais de faire; il demeura très satisfait et me promit, si mon entreprise se poursuivait, de m'autoriser à retourner dans le nouveau monastère dès que la ville se serait apaisée; car le trouble que cette affaire venait d'y exciter était fort grand, comme on va le voir. Deux ou trois jours après, le corregidor, quelques échevins, et quelques membres du chapitre s'assemblèrent pour délibérer; ils prononcèrent tous d'une voix unanime que ce nouveau monastère, étant manifestement nuisible au bien publie, ne devait point être toléré; qu'il fallait en ôter le très saint Sacrement, et qu'ils ne souffriraient en aucune façon qu'on passât outre. Ils ne tardèrent pas à convoquer une nouvelle assemblée de tous les ordres; deux députés de chaque ordre, choisis parmi les hommes les plus capables, devaient dire leur sentiment. Les uns gardaient le silence, les autres nous condamnaient; et la conclusion fut qu'il fallait sans délai supprimer le monastère. Seul, un présenté de l'ordre de Saint Dominique, qui, tout en approuvant la nouvelle fondation, n'était pas d'avis qu'elle fût sans revenus, fit remarquer qu'on ne pouvait pas procéder ainsi à la suppression d'un monastère; qu'on devait bien réfléchir à ce qu'on ferait, qu'on avait tout le temps d'attendre, et que cela regardait la juridiction de l'évêque . Par ces raisons et d'autres de cette nature, il calma beaucoup les esprits; ils étaient tellement emportés, que l'on regarda comme une merveille que le dessein de détruire le monastère ne fût pas sur-le-champ exécuté. Mais la véritable cause qui les retint, fut que Notre Seigneur voulait que cet établissement se fît, et tous nos adversaires ensemble ne pouvaient rien contre une telle volonté. Sans doute ils n'offensaient point Dieu, parce qu'ils étaient animés d'un bon zèle, et croyaient avoir de justes raisons; mais ils me firent beaucoup souffrir, ainsi que les personnes en petit nombre qui nous favorisaient, car elles eurent une bien rude persécution à essuyer. L'émotion du peuple était si grande, que l'on ne parlait point d'autre chose; tous me condamnaient et accouraient, les uns auprès du provincial, les autres auprès des religieuses de mon couvent, pour s'élever contre ma conduite. En mon particulier, je n'en étais pas plus affectée que si l'on n'eût rien dit. Je craignais seulement qu on ne détruisît la maison; cela me causait une grande douleur, comme aussi de voir les personnes qui nous assistaient perdre dans l'estime publique, et être exposées à tant de tribulations à cause de nous. Quant à ce qu'on disait de moi, j'en avais plutôt de la joie que de la peine. Si ma foi eût été plus vive, la paix de mon âme n'aurait en rien été troublée; mais il suffit d'un léger manquement à une vertu pour rendre toutes les autres comme endormies. C'est pourquoi j'éprouvai une très grande peine pendant les deux jours où l'on tint ces assemblées. Mais au plus fort de ma douleur, Notre Seigneur me dit: « Ne sais-tu pas que je suis tout-puissant? que crains-tu? » Et il m'assura que le monastère ne serait pas détruit. Ainsi, je demeurai très consolée. La ville porta l'affaire au conseil du roi; il en vint un ordre de dresser une enquête exacte de tout ce qui s'était fait, et voilà un grand procès commencé. La ville envoya ses députés à la cour. Notre monastère devait aussi envoyer les siens; mais nous n'avions pas d'argent, et je ne savais que faire. Le divin Maître y pourvut; car mon provincial ne me défendit jamais de m'occuper de cette affaire. Ami comme il l'est de tout ce qui tient à la vertu, s'il ne nous prêtait pas son concours, il ne voulait point nous faire opposition; il n'attendait même que de voir l'issue de ce débat, pour me permettre de venir habiter dans ce petit monastère. Cependant ces servantes de Dieu, qui y étaient restées seules , faisaient plus par leurs prières, que moi par toutes mes négociations qui ne me demandèrent pas peu d'activité. Il semblait quelquefois que tout fût perdu, et particulièrement le jour qui précéda l'arrivée du provincial; car la prieure me défendit de me mêler désormais de rien, ce qui était tout ruiner. Je m'en allai alors trouver Notre Seigneur, et je lui dis: Mon divin Maître, cette maison n'est pas à moi, c'est pour vous qu'elle a été faite; maintenant que personne ne défend ses intérêts, c'est à vous d'en prendre soin. Après cela, je demeurai aussi tranquille et aussi joyeuse que si tout l'univers eût travaillé à ma place, et je ne doutai plus du succès de cette affaire. Un ecclésiastique (Gonzalve de Aranda), grand serviteur de Dieu, ami de tout ce qui respire la perfection, et qui m'avait toujours assistée, se rendit à la cour pour y défendre notre cause, et il le fit avec le plus grand zèle. D'un autre côté, ce saint gentilhomme (François de Salcédo) que j'ai toujours considéré et considère encore comme mon père, s'y employait avec une bonté incroyable, sans tenir compte des peines ni des persécutions que lui attirait son dévouement. Notre Seigneur donnait tant de zèle à ceux qui nous défendaient, qu'ils faisaient leur cause de la nôtre, et lon eût dit qu'il y allait de leur vie et de leur honneur, quoiqu'il n'y eût au fond que le motif de la gloire de Dieu qui les fit agir. Notre Seigneur daigna aussi soutenir d'une manière visible ce vertueux ecclésiastique dont j'ai parlé (Gaspar Daza), et qui était l'un de ceux de qui je recevais le plus d'assistance. L'évêque l'envoya pour parler en son nom dans une grande assemblée qui se tint à notre sujet. Il s'y trouva seul contre tous; pourtant il parvint à apaiser ses adversaires par certains expédients qu'il proposa. Cela suffit pour gagner du temps, mais non pas pour les empêcher de revenir bientôt à leur résolution de détruire à tout prix le monastère. C'était ce serviteur de Dieu qui avait mis le très saint Sacrement dans notre église et donné l'habit à ces filles; ce qui lui valut une grande persécution. Cette tempête dura près de six mois; mais le détail de nos souffrances dans cet intervalle serait trop long à rapporter. Je ne pouvais assez m'étonner de voir tous les obstacles que soulevait le démon contre quelques pauvres femmes, et comment il pouvait mettre dans l'esprit de tout le monde, j'entends de ceux qui nous étaient contraires, que douze religieuses seulement, avec leur prieure (car elles ne peuvent être davantage), fussent capables d'apporter un si grand préjudice à la ville, en menant une vie si austère. L'inconvénient ou le mécompte, s'il y en avait, ne pouvait retomber que sur elles; mais quant au dommage de la ville, en vérité, c'était une chimère. Et néanmoins il était si grand à leur avis, qu'ils pouvaient en bonne conscience nous faire une aussi forte opposition. Enfin ils en vinrent à dire que, pourvu que le monastère eût des revenus, ils consentiraient à le laisser subsister. J'étais bien lasse de la peine que cette affaire donnait à tous nos amis; aussi, pour leur repos plutôt que pour le mien, j'entrai dans la pensée qu'il n'y aurait pas de mal à avoir des rentes jusqu'à ce que le trouble fût apaisé, sauf à y renoncer ensuite. Quelquefois même, à cause de mon imperfection et de mon peu de vertu, je me figurais que c'était peut-être la volonté de Notre Seigneur, puisque sans cela notre dessein ne pouvait s'exécuter; je n'étais donc pas loin de souscrire à cet accommodement. Mais la veille du jour où on devait le conclure, Notre Seigneur me dit, le soir, tandis que j'étais en oraison, de me garder d'accepter cette condition, parce que si nous commencions à avoir des revenus, on ne nous permettrait plus d'y renoncer. Il me donna encore quelques autres avis. La même nuit, le saint frère Pierre d'Alcantara, qui était déjà mort, m'apparut. Quelque temps avant de quitter cet exil, il m'avait écrit qu'ayant appris la vive opposition faite à notre établissement, et la grande persécution suscitée contre nous, il s'en était réjoui, parce que ces efforts du démon étaient un signe que Notre Seigneur y serait fidèlement servi, mais que je devais me garder de consentir à posséder des revenus; ce qu'il me répétait deux ou trois fois dans la même lettre; et il m'assurait que si j'étais fidèle à son conseil, tout réussirait au gré de mes désirs. Depuis que Dieu l'avait appelé à lui, je l'avais vu deux autres fois, et j'avais été témoin de la grandeur de sa gloire. Son aspect, loin de m'inspirer aucune terreur, avait inondé mon âme de joie; car il m'apparaissait toujours dans l'état d'un corps glorieux, rempli d'une félicité à laquelle je participais moi-même. Je me souviens que la première fois, en me parlant de l'excès de son bonheur, il me dit, entre autres choses, qu'heureuse était la pénitence qui lui avait mérité une si grande récompense. Je ne répéterai point ce que je crois avoir déjà écrit ailleurs de ces apparitions; je me contenterai d'ajouter que, cette troisième fois, il me montra un visage sévère, et disparut après m'avoir dit seulement que pour rien au monde je ne devais accepter des revenus: et pourquoi donc ne voulais-je pas suivre son conseil? J'en demeurai épouvantée, et après l'avoir raconté le lendemain à ce saint gentilhomme (François de Salcédo) qui s'employait pour nous plus que tout autre, je lui dis qu'il ne fallait en aucune manière consentir à avoir des revenus, mais plutôt continuer à poursuivre le procès. Il en eut une grande joie, sa résolution sur ce point étant plus ferme que la mienne; et il m'a avoué qu'il n'était entré qu'à contre-cur dans cet accommodement. L'affaire étant ainsi en bons termes, voilà qu'une personne fort vertueuse, et animée d'un bon zèle, proposa d'en remettre la décision à des hommes savants. Quelques-uns de ceux qui m'assistaient se rangèrent à cet avis; et de là pour moi une nouvelle source d'inquiétudes. Je puis dire avec vérité que de tous les artifices dont le démon traversa mon dessein, nul ne me causa plus de peine; mais Notre Seigneur vint à mon secours dans cette circonstance comme dans toutes les autres. Il ne m'est pas possible, dans une relation aussi succincte que celle-ci, de faire connaître tout ce qu'il y eut à souffrir durant les deux ans qui s'écoulèrent depuis que la fondation de cette maison fut entreprise jusqu'à ce qu'elle fût achevée; mais les six premiers mois et les six derniers furent les plus pénibles. L'émotion de la ville commençait à se calmer: le père présenté dominicain, auquel nous nous étions d'abord adressées (Pierre Ybañez), sut alors, quoique absent, si bien ménager les esprits, quil nous fut d'un très grand secours. Notre- Seigneur l'avait amené ici dans une conjoncture où son appui nous fut extrêmement utile; le divin Maître sembla même ne l'y avoir appelé que pour nous. Car ce père m'a dit depuis qu'il n'avait eu nul sujet de venir, et que c'était comme par hasard qu'il avait appris ce qui se passait; il ne resta ici que le temps nécessaire pour nos intérêts, et il partit. Malgré cela, il négocia si bien par certaines voies auprès de notre père provincial, que, contre toute espérance, celui-ci me permit dès lors de venir, avec quelques religieuses, habiter le nouveau monastère, afin d'y célébrer loffice divin et d'instruire celles qui y étaient déjà . La joie que j'éprouvai le jour où nous y entrâmes fut inexprimable. Avant de pénétrer dans la maison, je m'arrêtai à l'église pour faire oraison: là, étant presque en extase, je vis Notre Seigneur Jésus-Christ qui me recevait avec un grand amour, et qui, en me mettant une couronne sur la tête, me témoignait sa satisfaction de ce que j'avais fait pour sa très sainte Mère. Un autre jour, tandis qu'après complies nous étions toutes en oraison dans le chur, la très sainte Vierge m'apparut, environnée d'une très grande gloire, et revêtue d'un manteau blanc sous lequel elle nous abritait toutes. Elle me fit en même temps connaître le haut degré de gloire auquel son divin Fils devait élever les religieuses de cette maison. Nous n'eûmes pas plus tôt commencé à faire l'office, que le peuple fut touché d'une grande dévotion pour ce monastère. Nous reçûmes de nouvelles religieuses . Notre Seigneur changea le cur de ceux qui nous avaient le plus persécutées; ils se montraient pleins de dévouement à notre égard, et nous faisaient l'aumône, approuvant ainsi ce qu'ils avaient tant condamné. Ils se désistèrent peu à peu du procès intenté contre nous, et ils reconnaissaient que ce monastère était l'uvre de Dieu, puisque sa souveraine Majesté l'avait fait triompher d'une si étonnante opposition. Il est certain qu'il ne se trouve plus personne aujourd'hui qui pense qu'il eût été sage d'abandonner une pareille entreprise. Les habitants de la ville sont d'une charité admirable envers nous; sans faire de quête, et sans rien demander à personne, nous nous trouvons pourvues du nécessaire, le bon Maître les portant à nous l'envoyer d'eux-mêmes. J'ai l'intime confiance qu'il en sera toujours ainsi. Les religieuses étant en petit nombre, pourvu qu'elles remplissent bien leurs devoirs, comme Notre Seigneur leur en fait maintenant la grâce, je suis assurée qu'il prendra d'elles le même soin à l'avenir, et qu'ainsi elles ne seront jamais à charge ni importunes à qui que ce soit. C'est pour moi une indicible consolation de vivre au milieu de ces âmes si détachées de tout. L'unique objet qui les occupe est de toujours progresser dans le service de Dieu. La solitude fait leurs délices. Une visite même de leurs proches parents leur est à charge, à moins qu'elles n'y trouvent de quoi enflammer davantage l'amour qu'elles ont pour leur Époux. Aussi, il ne vient à cette maison que des personnes qui ont soif comme elles de ce divin amour: les autres n'y goûteraient aucune satisfaction, et ne leur en procureraient aucune. Tous leurs discours ne sont que de Dieu; et quiconque voudrait leur parler d'autre chose ne serait point entendu d'elles et ne les entendrait pas. Nous observons la règle de Notre-Dame du Mont-Carmel sans aucune mitigation, telle qu'elle a été rédigée par frère Hugues, cardinal de Sainte-Sabine, et approuvée l'an 1248 par le pape Innocent IV, en la cinquième année de son pontificat. Il me semble maintenant que tous les travaux que nous avons soufferts ne pouvaient être mieux employés. Il y a, je l'avoue, de l'austérité dans notre genre de vie: mangeons jamais de viande sans nécessité, nous jeûnons huit mois de l'année, et nous pratiquons beaucoup d'autres choses que l'on peut voir dans la règle primitive . Néanmoins, les surs comptent tout cela pour si peu, qu'elles gardent encore d'autres observances qui nous ont paru nécessaires pour accomplir cette règle avec plus de perfection. J'espère de la bonté de Notre Seigneur qu'il donnera de très grands accroissements à ce qui est commencé, puisqu'il lui a plu de me le promettre. L'autre maison que cette béate, dont j'ai parlé plus haut (Mère Marie de Jésus), voulait fonder, a été également favorisée de Notre Seigneur, et se trouve heureusement établie à Alcala, mais ce n'a pas été non plus sans de grandes oppositions, ni sans qu'il y ait eu bien des peines à souffrir. Je sais que l'on y vit dans une entière régularité, et dans l'observance de notre première règle. Plaise à Notre Seigneur que tout soit à son honneur et à sa louange, comme à l'honneur et à la louange de la glorieuse Vierge Marie, dont nous portons lhabit! Amen. Je crains, mon père, de vous avoir causé de l'ennui par une si longue relation de ce qui s'est passé touchant ce monastère. Elle est néanmoins fort brève, eu égard aux travaux que l'on a soufferts, et aux merveilles que Notre Seigneur a faites pour l'établir. Plusieurs personnes ont été témoins de ces merveilles, et peuvent les affirmer avec serment. C'est pourquoi je vous supplie, pour l'amour de Dieu, dans le cas où vous jugeriez à propos de détruire toutes les autres parties de cet écrit, de conserver celle qui regarde ce monastère, et de la remettre, après ma mort, entre les mains des religieuses qui me survivront. Toutes celles qui viendront dans la suite se sentiront puissamment excitées à servir Dieu, et non seulement à maintenir, mais à accroître ce qui a été commencé, lorsqu'elles liront dans ce récit tout ce que Notre Seigneur a fait pour cette maison, par une main aussi faible et aussi misérable que la mienne. Puisqu'il a montré, par une protection si visible, combien il avait à cur la fondation de ce monastère, quel mal ne feraient point, et quels châtiments ne mériteraient pas celles qui commenceraient à se relâcher de la perfection qu'il y a lui-même établie! Sa grâce rend ce joug si léger qu'on peut, il est facile de le voir, le porter sans fatigue et y trouver même de la douceur. Les âmes qui n'ont pas d'autre désir que de jouir seul à seul de Jésus-Christ, leur époux, rencontrent ici toutes les facilités pour vivre constamment en sa compagnie. Demeurer seules avec lui seul, tel doit être le but continuel de leurs désirs. Dans ce dessein, qu'elles ne cherchent point à être plus de treize; je sais par expérience, et par l'avis de plusieurs personnes fort habiles, que pour conserver l'esprit de notre règle, et pour vivre d'aumônes, sans rien demander, il ne faut pas dépasser ce nombre . Que là-dessus on croie de préférence celle qui, avec tant de travaux et l'assistance de tant de prières, a tâché d'établir ce qu'elle a jugé le meilleur. On peut encore se convaincre que c'est là ce qui convient, en voyant le contentement, l'allégresse, et la santé plus forte dont nous jouissons toutes depuis que nous sommes dans ce monastère, sans que les observances qui s'y pratiquent nous aient jamais pesé. Si cette vie parait trop austère à quelques personnes, elles doivent l'attribuer à leur peu de ferveur, et non à la règle qui se garde ici, puisque des femmes délicates et de peu de santé, soutenues seulement par cet esprit intérieur, l'observent avec tant de satisfaction. Je conseille à ces personnes de s'en aller en d'autres monastères, où elles se sauveront en vivant conformément à leur institut. Chapitre 37 J'ai de la peine à poursuivre le récit des grâces que Notre Seigneur m'a accordées;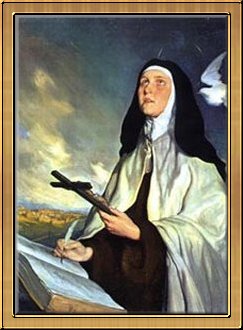 celles dont jai parlé jusqu'ici sont même déjà trop grandes pour que l'on puisse se persuader qu'il en ait favorisé une âme aussi imparfaite. Mais pour obéir au commandement du divin Maître et à l'ordre que vous m'en avez donné, mes pères, j'en rapporterai encore quelques-unes, dans le seul but de lui rendre gloire. Plaise au Seigneur que le spectacle des bienfaits dont il a enrichi ma misère puisse être utile à quelque âme Que ne fera-t-il pas pour ses véritables serviteurs! Que tous s'animent donc à contenter un Dieu qui donne, dans cette vie même, de tels gages de son amour. celles dont jai parlé jusqu'ici sont même déjà trop grandes pour que l'on puisse se persuader qu'il en ait favorisé une âme aussi imparfaite. Mais pour obéir au commandement du divin Maître et à l'ordre que vous m'en avez donné, mes pères, j'en rapporterai encore quelques-unes, dans le seul but de lui rendre gloire. Plaise au Seigneur que le spectacle des bienfaits dont il a enrichi ma misère puisse être utile à quelque âme Que ne fera-t-il pas pour ses véritables serviteurs! Que tous s'animent donc à contenter un Dieu qui donne, dans cette vie même, de tels gages de son amour. Je ferai d'abord observer qu'il y a dans ces grâces des degrés divers. Certaines visions l'emportent tellement sur d'autres par la gloire, les délices, la consolation, que je m'étonne de voir la jouissance de Dieu se faire sentir, même en cette vie d'une manière si différente. Parfois, la douceur et le plaisir dont l'âme se trouve inondée dans une vision ou dans un ravissement, s'élèvent si fort au-dessus de tout ce qu'elle a éprouvé, qu'il lui semble impossible de désirer quelque chose de plus ici-bas; et de fait, elle ne le désire point, elle ne demande pas plus de bonheur. Cependant, depuis que Notre Seigneur m'a fait connaître combien grande est l'inégalité qui existe dans le ciel entre la félicité des uns et celle des autres, je vois bien que, sur la terre il n'y a pas non plus, quand il le veut, de mesure à ses dons. Aussi voudrais-je n'en voir mettre jamais dans le dévouement à une si haute Majesté. Mon désir serait de consumer ma vie, mes forces, ma santé à son service, et de ne point perdre, par ma faute, le moindre degré de jouissance dans le ciel. Je ne crains pas de le dire, si l'on me demandait lequel je préfère, ou d'endurer toutes les peines de cet exil jusqu'au dernier jour du monde, à la condition de recevoir ensuite un degré de gloire de plus, si petit qu'il fût, ou d'aller, sans rien souffrir, occuper un moindre degré de gloire, de très grand cur j'achèterais, au prix de toutes les peines d'ici-bas, le bonheur de jouir tant soit peu davantage de la vue des grandeurs de Dieu; car je vois que plus on le connaît, plus on l'aime et on le loue. Sans doute, je m'estimerais trop heureuse, après avoir mérité la dernière place en enfer, d'occuper la dernière place du paradis; et plaise à sa divine Majesté de me la donner un jour, sans considérer la grandeur de mes péchés! elle userait envers moi de la plus grande miséricorde; mais j'affirme que, si je le pouvais, et si le Seigneur me donnait sa grâce pour endurer d'extrêmes souffrances, je ne voudrais, quoi qu'il dût m'en coûter, rien perdre par ma faute. Infortunée! J'avais cependant, par mes nombreux péchés, tout perdu pour jamais. Je dois dire aussi que chacune des visions ou révélations dont j'étais favorisée m'apportait de grands avantages; que même certaines visions opéraient en moi des effets extraordinaires. Ainsi, la vue de Jésus-Christ laissa son ineffable beauté empreinte en mon âme; et, jusqu'à ce jour, elle n'a point cessé de m'être présente. Il eût suffi, pour un tel effet, de le voir une seule fois; qu'on juge de ce qu'a dû produire en moi une pareille faveur si souvent accordée. Un des fruits les plus précieux que j'en retirai, fut de me corriger d'un défaut très nuisible à mon avancement. Ce défaut, le voici: venais-je à m'apercevoir qu'une personne m'était dévouée, si d'autre part elle avait le don de me plaire, je m'affectionnais à elle de telle sorte, que mon esprit était tout occupé de son souvenir. Sans avoir la moindre intention d'offenser Dieu, j'éprouvais un grand plaisir à la voir, à penser à elle et aux bonnes qualités dont elle était douée. Ce défaut était si grave que mon âme en souffrait le plus grand dommage. Mais depuis que j'eus aperçu la ravissante beauté de Notre Seigneur, nul mortel n'a plus rien offert à ma vue qui pût me toucher ni occuper ma pensée. Un simple regard sur la divine image que je porte gravée au fond de mon âme, me rend souverainement libre. Tout ce que je vois, loin de me captiver, excite mon dégoût, quand je le compare aux grâces et aux excellences que je découvre en ce divin Maître. Non, il n'y a ni science, ni félicité sur la terre qui soit de quelque prix a mes yeux, auprès du bonheur d'entendre une seule parole proférée par cette bouche divine: que ne doit donc pas éprouver une âme qui a eu le bonheur d'en entendre un si grand nombre! Aussi je tiens pour impossible, à moins que par une juste punition de mes péchés je ne vienne à perdre ce souvenir, que personne désormais puisse tellement occuper mon esprit, qu'il ne me suffise, pour être libre, de penser un moment à mon divin Maître. Je rapporterai à ce sujet ce qui m'est arrivé. J'ai toujours eu pour ceux qui gouvernent mon âme un véritable attachement; comme je vois Dieu même en eux, ils m'inspirent une sincère affection. Sachant d'ailleurs qu'il n'y avait nul danger pour moi, je leur témoignais mes sentiments. Quant à eux, prudents comme ils l'étaient, et serviteurs de Dieu, ils craignaient que l'affection toute sainte que je leur portais ne nuisît à ma liberté intérieure, et ils me traitaient assez durement. Ceci est arrivé depuis que je leur obéis avec une soumission absolue, car auparavant je ne leur étais pas aussi affectionnée. Je riais en moi-même de voir combien ils étaient trompés, et je ne leur disais pas toujours à quel point je me sentais détachée de toutes les créatures. Je me contentais de les rassurer; bientôt, par leurs rapports plus intimes avec moi, ils découvraient la liberté que je devais à Notre Seigneur, et ils perdaient ces craintes, qu'ils n'avaient, du reste, que dans les commencements. Plus Notre Seigneur se montrait à moi, plus je sentais croître mon amour pour lui et ma confiance en sa bonté. Ses fréquents entretiens me le faisaient connaître d'une manière plus intime; je voyais qu'étant Dieu et homme tout ensemble, il ne s'étonne pas des faiblesses des hommes; il sait toute la profondeur de notre misère, et à combien de chutes nous sommes exposés, par suite du péché de nos premiers parents, qu'il est venu réparer. Je sentais que je pouvais traiter avec ce souverain Seigneur comme avec un ami, parce qu'il ne ressemble pas à ceux de la terre, qui mettent toute leur grandeur dans l'appareil d'une puissance empruntée. On ne leur parle qu'à certaines heures, et il n'y a que les personnes qualifiées qui les approchent; si un homme de petite condition se trouve obligé d'implorer leur assistance, que de peines, que de détours lui faut-il prendre, et de combien de faveurs n'a-t-il pas besoin pour en obtenir audience! Mais si c'était au roi lui-même qu'on eût affaire, oh! alors point d'accès à espérer si vous êtes pauvre, et si vous n'êtes point gentilhomme. Il faut avoir recours aux favoris, et on peut être sûr qu'ils ne sont pas de ceux qui foulent le monde aux pieds. Ceux-ci, en effet, n'ayant aucune crainte et n'en devant point avoir, disent hardiment la vérité: de tels caractères ne sont pas propres pour la cour, où une si mâle franchise est inconnue. Là, il faut savoir taire le mal qu'on voit, et à peine ose-t-on le condamner dans sa pensée, de peur d'une disgrâce. O Roi de gloire et Seigneur de tous les rois! votre empire n'est point défendu par de frêles barrières, car il est éternel. Oh! comme, sans introducteur, on peut arriver jusqu'à vous! Il suffit de vous voir, pour comprendre que vous seul méritez de porter le nom de Seigneur. Sans cortège et sans gardes, la majesté de votre personne révèle en vous le souverain. Il n'en est pas ainsi d'un roi mortel: en vain, quand il est seul, voudrait-il se faire reconnaître; comme il n'a rien de plus que les autres, il faut voir les insignes de sa royauté pour y croire. Aussi s'entoure-t-il, à juste titre, de cette autorité d'emprunt sans laquelle il n'obtiendrait pas un regard. Aucun rejaillissement de puissance n'émanant de sa personne, l'autorité doit lui venir des autres. O mon Seigneur, ô mon Roi! que ne puis-je peindre en ce moment l'éclat de votre gloire! Il est impossible de ne pas voir que la source de votre suprême puissance est en vous-même. L'effroi saisit, quand on contemple une majesté si haute; mais combien cet effroi redouble quand on vous voit, Seigneur, malgré toute cette majesté, vous humilier si profondément, et témoigner tant d'amour à une créature telle que moi! Toutefois, après ce premier saisissement, nous pouvons traiter avec vous de tous nos intérêts, et vous parler au gré de nos désirs. A la crainte causée d'abord par la vue de votre gloire, en succède une autre plus grande, celle de vous offenser: et ce n'est pas la frayeur du châtiment qui la fait naître; non, Seigneur, mais la frayeur de vous perdre vous-même, auprès de laquelle la première n'est absolument rien. Voilà, sans parler des autres, quelques-uns des précieux avantages de cette vision, si elle vient de Dieu. Les effets le font connaître, lorsqu'il daigne éclairer l'âme; mais, comme je l'ai souvent dit, Notre Seigneur veut que de temps en temps elle soit dans les ténèbres et privée de sa divine lumière. Cela étant ainsi, on ne doit pas trouver étrange que, me voyant si misérable, je conçoive quelque crainte. Je viens de passer huit jours dans cette obscurité; je ne trouvais plus en moi ni sentiment de mes obligations envers Dieu, ni souvenir de ses grâces; mon esprit était frappé d'impuissance, et absorbé par je ne sais quoi. Je n'avais assurément nulle mauvaise pensée, mais je me sentais si incapable d'en avoir de bonnes, que je riais de moi-même, et prenais plaisir à voir la bassesse d'une âme, quand Dieu suspend en elle son opération. Elle voit bien qu'elle n'est pas sans lui dans cet état; car ce n'est point comme dans ces grandes peines intérieures que j'ai éprouvées de temps en temps, et dont j'ai parlé plus haut. Néanmoins, elle a beau mettre du bois, et faire de son côté le peu qui est en son pouvoir pour allumer le feu de l'amour divin, aucune flamme ne monte. C'est déjà une grande miséricorde de la part de Dieu, que la fumée paraisse, et montre qu'il n'est pas entièrement éteint. Notre Seigneur l'allume ensuite de nouveau; mais jusque-là, quand on se romprait la tête à souffler et à arranger le bois, on ne ferait que l'étouffer davantage. Je crois que le meilleur alors est d'avouer franchement que l'on ne peut rien par soi-même, et de s'employer, comme j'ai dit, à d'autres uvres méritoires. Peut-être Notre Seigneur enlève-t-il à l'âme l'oraison, afin qu'elle se livre à ces uvres, et connaisse par expérience le peu dont elle est capable par elle-même. Il est certain qu'aujourd'hui j'ai goûté de grandes délices auprès de Notre Seigneur: j'ai osé me plaindre de lui, et je lui ai dit: Eh quoi! mon Dieu, n'est-ce donc pas assez que vous me teniez dans cette misérable vie; que, pour l'amour de vous, je m'y soumette, et que je veuille vivre dans cet exil où tout m'empêche de jouir de vous, le manger, le dormir, les affaires, les rapports avec le monde? Vous seul connaissez la grandeur de ce tourment; et néanmoins, ô mon Seigneur, je l'endure pour l'amour de vous: faut-il encore que, dans ces rares instants où je pourrais jouir de votre présence, vous vous dérobiez à ma vue? Comment cela peut-il s'allier avec votre miséricorde? Comment l'amour que vous avez pour moi peut-il le tolérer? Seigneur, s'il m'était possible de me cacher de vous, comme vous de moi, votre amour, j'en suis sûre, ne le souffrirait jamais. Mais vous êtes toujours avec moi, et vous me voyez toujours. Mon tendre Maître, une pareille inégalité est trop cruelle; considérez, je vous en supplie, qu'elle n'est pas juste envers celle qui vous aime d'un si ardent amour. Avant de proférer ces paroles et d'autres de ce genre, je venais de considérer que la place où je m'étais vue dans l'enfer était trop douce pour une pécheresse comme moi. Souvent l'amour me transporte de telle manière, que je ne me possède plus; c'est alors qu'avec le plus libre abandon j'ose adresser ces plaintes à Notre Seigneur, et il veut bien souffrir tout cela de ma part. Louange en soit rendue à ce Roi si plein de bonté! Approcherions-nous de ceux de la terre avec une pareille hardiesse? Certes, que l'on n'ose parler au roi, je n'en suis point surprise; je trouve juste qu'on craigne le souverain et les premiers seigneurs du royaume. Mais, de nos jours, les choses en sont venues à ce point, que la vie n'est plus assez longue pour apprendre les devoirs, les déférences, les respects introduits par l'usage, quand, avec cela, on veut se réserver un peu de temps pour servir Dieu. Un tel spectacle me confond, et j'avoue qu'à l'époque où je vins m'abriter dans ce monastère, je ne savais plus comment traiter avec les grands. Pour peu que l'on rende à d'autres, sans y penser, plus d'honneur que leur qualité n'exige, ils ne le prennent pas en plaisanterie; ils s'en offensent même tellement, qu'il faut s'en justifier et leur en faire satisfaction; et encore Dieu veuille qu'ils s'en contentent! Je le répète, je ne savais plus comment vivre dans le monde. Une pauvre âme s'y trouve bien en peine; car on lui dit d'un côté que, pour se garantir des nombreux dangers qui l'environnent, elle doit continuellement élever ses pensées vers Dieu; et on veut, de l'autre, qu'elle ne manque à aucun de ces devoirs de civilité qui se pratiquent dans le monde, afin de ne point blesser ceux qui se font un point d'honneur de ces bagatelles. C'était pour moi une source d'ennui; je ne finissais jamais de faire des satisfactions; j'avais beau étudier, il m'échappait toujours bien de ces fautes que le monde ne regarde point comme légères. Mais n'est-il pas vrai que la vie religieuse nous excuse, et qu'on doit, si l'on veut être juste, nous pardonner des fautes de ce genre? Non; l'on dit, au contraire, que les monastères doivent être une école et une cour de politesse. Pour moi, je ne puis le comprendre. Un langage si faux ne viendrait-il pas de ce qu'on aurait pris de travers une parole comme celle-ci, dite par quelque saint: Les maisons religieuses doivent être une cour où l'on forme des courtisans pour le ciel? Et en effet, je ne sais vraiment comment ceux dont l'unique étude doit être de plaire en tout à Dieu et d'abhorrer le monde, peuvent s'occuper avec tant de soin de contenter les gens du monde en des choses si sujettes à changer. Encore si on pouvait les apprendre une fois pour toutes, patience; mais les seuls titres des lettres demandent aujourd'hui un enseignement tout spécial, et il nous faut de doctes leçons pour apprendre quand nous devons, laisser du papier de tel côté ou bien de tel autre, et quand nous devons donner le titre d'illustre à celui qui n'avait pas auparavant le titre de magnifique. J'ignore où l'on en viendra; car, bien que je n'aie pas encore cinquante ans, j'ai vu cela changer tant de fois, que je ne sais plus où j'en suis. Que feront donc ceux qui ne viennent que de naître, si Dieu leur donne une longue vie? En vérité, je plains les personnes spirituelles qui, pour de sainte motifs, doivent rester au milieu du monde; elles portent sur ce point une croix terrible. Si elles se déterminaient, d'un commun accord à vouloir passer pour ignorantes dans une pareille science, s'estimant même heureuses d'être tenues pour telles, elles se délivreraient d'un bien pesant fardeau. Dans quelles folies me suis-je engagée? Voilà qu'en parlant des grandeurs de Dieu, j'en suis venue à discourir des bassesses du monde! Mais, puisque je l'ai abandonné sans retour par la grâce de Notre Seigneur, je veux en sortir tout à fait. Qu'ils s'arrangent avec lui, ceux qui se donnent tant de peine pour des choses si futiles. Dieu veuille que dans la vie future, où rien ne change, nous n'ayons pas à les payer bien cher! Amen. Chapitre 38 Étant un soir retirée dans un oratoire, si indisposée que je voulais me dispenser de faire oraison, je pris mon rosaire pour m'occuper vocalement et sans aucun effort d'esprit. Mais, quand Dieu le veut, que nos industries sont inutiles! Quelques instants à peine s'écoulèrent, et un ravissement vint me saisir avec une impétuosité telle que je ne pus y résister. Il me sembla que j'étais transportée dans le ciel, et les premières personnes que j'y vis furent mon père et ma mère. Dans un très court espace de temps, celui d'un Ave Maria, je découvris de si grandes merveilles que, succombant sous le poids dune faveur qui me paraissait excessive, je demeurai entièrement hors de moi. La vision fut peut-être de plus logue durée que je ne lindique ici; mais le temps paraît alors très court. Jappréhendai ensuite que ce ne fût une illusion, sans trouver néanmoins aucun fondement à cette crainte. Je ne savais que faire, tant javais de honte den parler à mon confesseur, non, ce me semble, par humilité, mais de peur qu'il ne se moquât de moi, et ne me demandât si j'étais un saint Paul ou un saint Jérôme, pour avoir connaissance des choses du ciel. La pensée que de pareilles visions avaient été accordées à ces grands saints augmentait encore ma crainte, et je ne faisais que répandre des larmes, parce qu'une telle chose me semblait devoir être une illusion. Enfin, malgré ma répugnance j'allai trouver mon confesseur; car, pour rien au monde, je n'aurais osé lui rien cacher, quelque honte que me causât un tel aveu, tant je tremblais d'être trompée. Il fut touché de mon affliction, me consola beaucoup, et me dit les choses les plus capables de me tranquilliser. Dans la suite il m'est arrivé, et il m'arrive encore quelquefois, que Notre Seigneur me découvre de plus grands secrets, mais de telle manière que je ne vois que ce qu'il lui plaît de me montrer, sans qu'il soit au pouvoir de mon âme, quand elle le voudrait, d'apercevoir rien de plus. Le moindre de ces secrets suffit pour ravir l'âme d'admiration, et la faire avancer beaucoup dans le mépris et la basse opinion des choses de la vie. Je voudrais pouvoir donner une idée de ce qui m'était alors découvert de moins élevé; mais en cherchant à y parvenir, je trouve que c'est impossible; car, entre la seule lumière de ce divin séjour où tout est lumière, et la lumière d'ici-bas, il y a déjà tant de différence, qu'on ne peut les comparer, celle du soleil ne semblant plus que laideur. L'imagination la plus subtile ne peut arriver à se peindre et à se figurer cette lumière, ni à se représenter aucune des merveilles que Notre Seigneur me faisait alors connaître. Il est impossible de rendre le souverain plaisir qui accompagnait cette connaissance, et le haut degré de suavité dont tous mes sens étaient alors comblés; ainsi je suis forcée de n'en pas dire davantage. Je passai une fois plus d'une heure en cet état, Notre Seigneur se tenant toujours près de moi, et me découvrant des choses admirables. Il me dit: « Vois, ma fille, ce que perdent ceux qui sont contre moi; ne manque pas de le leur dire. » Hélas! mon cher Maître, lui répondis-je, que peuvent mes paroles auprès de ceux que leurs crimes aveuglent, à moins que vous ne les éclairiez vous-même? Vous avez fait connaître vos grandeurs à certaines âmes, et elles vous ont glorifié; mais cette chétive et misérable créature, à qui vous les manifestez, rencontrera-t-elle une seule personne qui veuille lui donner créance? Loué soit du moins votre nom et bénie votre miséricorde, pour l'heureux changement que vous avez opéré en moi! Depuis, mon âme voudrait toujours demeurer dans cette région supérieure, sans revenir à la vie, tant elle a conçu de mépris pour toutes les choses de la terre. Elles ne sont à ses yeux que de la fange, et elle comprend combien basse est l'occupation de ceux qui s'y arrêtent. Durant mon séjour chez cette dame dont j'ai parlé (Louise de la Cerda à Tolède), je fus une fois saisie de ces douleurs du cur auxquelles j'étais si sujette, et qui maintenant me font moins souffrir. Comme cette dame est d'une admirable charité, elle me fit apporter des joyaux d'or, des pierreries de grand prix, et en particulier des diamants qu'elle estimait beaucoup, espérant que la vue de ces objets ferait une agréable diversion à mon mal. Je riais en moi-même, et comparant intérieurement ce que les hommes estiment avec ce que Notre Seigneur nous réserve, je ne pouvais me défendre d'un sentiment de compassion. Je sentais qu'il me serait impossible, quand je le voudrais, de faire le moindre cas de ces biens périssables, à moins que Dieu n'effaçât de mon esprit le souvenir des biens célestes. Cette disposition est pour l'âme une espèce de souveraineté si haute, que je ne sais si on peut la comprendre, à moins de la posséder. C'est le vrai et pur détachement Dieu seul l'opère en nous, sans aucun travail de notre part. C'est lui qui nous découvre ces vérités; elles demeurent imprimées dans notre esprit, et nous voyons avec évidence combien il nous serait impossible, par nous-mêmes, d'acquérir si promptement un bien de cette nature. Ces lumières ont banni de mon cur, en très grande partie, une crainte fort vive que j'avais toujours eue de la mort. Mourir me semble maintenant la chose du monde la plus facile pour l'âme fidèle à Dieu, puisque, en un moment, elle se voit libre de sa prison, et introduite dans le repos. Il existe, selon moi, une grande ressemblance entre l'extase et la mort. En effet, l'esprit ravi en Dieu contemple les ineffables merveilles qu'il lui découvre; et l'âme, dès l'instant même où elle est séparée du corps, est mise en possession de ces mêmes biens. Je ne parle point des douleurs de la séparation, dont il faut faire très peu de cas; d'ailleurs, ceux qui auront véritablement aimé Dieu et méprisé les vanités de la terre, doivent mourir avec plus de douceur. J'appris aussi à connaître quelle est notre véritable patrie, et à regarder cette vie comme un pèlerinage. C'est un grand avantage d'avoir vu ce qui nous est réservé là-haut, et de savoir où nous sommes appelés à habiter. Celui qui doit aller s'établir dans une contrée lointaine trouve un puissant secours, pour supporter les fatigues du voyage, dans la connaissance du pays où il doit mener une vie pleine de repos. L'âme trouve de même, dans la connaissance qu'elle a reçue, une grande facilité pour s'élever à la considération des choses d'en haut, et pour faire en Sorte que sa Conversation soit dans le ciel. Il y a là d'inappréciables avantages. Un seul regard vers le ciel suffit pour la recueillir. Notre Seigneur ayant bien voulu lui montrer quelque chose des grands biens qui s'y rencontrent, elle aime à y attacher sa pensée. Souvent ceux qui forment ma société ici-bas, et auprès de qui je me console, sont ceux que je sais être vivants là-haut; eux seuls me paraissent jouir de la véritable vie. Quant à ceux qui vivent sur la terre, ils me semblent tellement morts, que le monde entier ne saurait me tenir compagnie, surtout lorsque j'éprouve ces grandes impétuosités d'amour. Tout ce que je vois des yeux du corps ne me paraît alors qu'une plaisanterie et un songe, tandis que j'appelle de toute l'ardeur de mes vux ce qui a frappé les yeux de mon âme; et comme je m'en vois encore loin, je puis dire que je me sens mourir. Enfin, ces visions sont une des grâces les plus insignes dont Dieu puisse favoriser une âme; elle y puise une force admirable; en particulier elles l'aident à porter une croix bien pesante, je veux dire l'ennui et le dégoût que tout lui inspire ici-bas. Et si le Seigneur ne suspendait de temps en temps le souvenir de ce qu'elle a vu, bien que ce souvenir ne tarde pas à se réveiller, je ne sais comment elle pourrait supporter la vie. Louange et bénédiction sans fin à ce Dieu de bonté! Qu'il ne permette point, je l'en supplie au nom du sang versé pour moi par son divin Fils, qu'après avoir compris, quelque chose de ces biens si élevés et avoir commencé à en jouir en quelque manière, j'aie le malheur, comme Lucifer, de tout perdre par ma faute! Ah! qu'il ne le permette jamais, je l'en conjure encore au nom de lui-même Parfois, la crainte que j'en ai n'est pas petite; mais le plus ordinairement, la miséricorde de mon Dieu ne donne l'assurance quaprès m'avoir retirée de tant de péchés, il ne voudra point cesser de me soutenir de sa main, et m'exposer ainsi à me perdre. Je vous prie très instamment, mon père, de joindre pour ce sujet vos prières aux miennes. La grâce dont je vais parler l'emporte, ce me semble, en plusieurs choses, sur les faveurs précédentes, en particulier par l'excellence des biens, et par la force qu'elle communique à l'âme. Néanmoins, chacune de ces faveurs, considérée à part, est d'un tel prix, qu'il n'y a point lieu de les comparer ensemble. Une veille de la Pentecôte, m'étant retirée après la messe dans un endroit fort solitaire où j'allais prier souvent, je me mis à lire, dans l'ouvrage d'un chartreux , ce qui avait trait à cette fête. J'y trouvai les marques auxquelles ceux qui commencent, ceux qui ont déjà fait des progrès dans la vertu, et ceux qui ont atteint la perfection, peuvent connaître si le Saint-Esprit est avec eux. Après avoir lu ce qui était dit sur ces trois états, il me sembla que, par la bonté de Dieu, ce divin Esprit, autant que j'en pouvais juger, était avec moi. Je lui en rendis aussitôt de vives actions de grâces. Je me souvins en ce moment d'avoir lu autrefois les mêmes choses, et je vis que j'étais en ce temps-là bien éloignée de l'état où je me trouvais alors; ainsi, par le contraste même, la grandeur de la grâce que Dieu mavait faite m'apparaissait dans tout son jour. Puis, considérant la place que j'avais méritée dans l'enfer par mes péchés, je ne pouvais donner assez de louanges à Dieu; car je ne reconnaissais presque plus mon âme, tant elle était transformée. Tandis que j'étais occupée de ces pensées, je fus saisie, sans en connaître la cause, d'un véhément transport. Mon âme paraissait vouloir sortir du corps, tant elle était hors d'elle-même, et se sentait incapable d'attendre davantage le bien qu'elle entrevoyait. Ce transport était si excessif que je ne pouvais y résister; il agissait sur moi, me semblait-il, d'une manière toute nouvelle. Mon âme était si profondément saisie, que je ne savais ni ce qu'elle avait ni ce qu'elle voulait. Sentant toutes les forces naturelles m'abandonner, et ne pouvant me soutenir, quoique je fusse assise, je m'appuyai contre la muraille. A ce moment, je vis au-dessus de ma tête une colombe bien différente de celles d'ici-bas; car elle n'avait point de plumes, et ses ailes semblaient formées de petites écailles qui jetaient une vive splendeur; elle était aussi plus grande qu'une colombe ordinaire. Il me semble que j'entendais le bruit qu'elle faisait avec ses ailes; elle les agita à peu près l'espace d'un Ave Maria. Mon âme, se perdant alors dans le ravissement, perdit aussi de vue cette divine colombe. L'esprit s'apaisa avec la présence d'un hôte si excellent, tandis que, selon ma manière de voir, une faveur si merveilleuse aurait dû le remplir de trouble et d'effroi. Mais dès que je commençai à jouir, la crainte fit place au repos, et je restai en extase. La gloire de ce ravissement fut extraordinaire; je demeurai la plus grande partie des fêtes comme interdite et hors de sens; je ne savais que devenir, je ne pouvais comprendre comment je ne succombais point sous le poids d'une si étonnante faveur; je n'entendais plus, je ne voyais plus, si je puis m'exprimer ainsi, tant était grande ma joie intérieure. Depuis ce jour, je vois en moi un bien plus haut degré d'amour de Dieu, et je me sens beaucoup plus affermie dans la vertu. Bénédiction et louange sans fin à ce Dieu de bonté! Amen. J'aperçus une autre fois sur la tête d'un père de l'ordre de Saint-Dominique la même colombe; mais il me sembla que les rayons et la splendeur de ses ailes s'étendaient beaucoup plus loin. Il me fut dit que ce religieux devait attirer à Dieu un grand nombre d'âmes. Notre-Dame m'apparut un jour, mettant un manteau d'une éblouissante blancheur sur les épaules de ce présenté du même ordre, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois (Pierre Ybañez). Elle me dit que pour prix du service qu'il lui avait rendu en aidant à l'établissement de cette maison, elle lui donnait ce manteau, comme marque du soin qu'elle prendrait désormais de conserver son âme pure, et de la préserver du péché mortel. Cette promesse s'est accomplie, j'en ai la certitude; car depuis cette époque jusqu'à sa mort, arrivée peu d'années après, ce père mena une vie si pénitente, et sa mort elle-même fut si sainte, que je ne saurais concevoir le moindre doute sur son bonheur. Un religieux présent à sa dernière heure m'a rapporté qu'il avait dit, un peu avant d'expirer, qu'il voyait saint Thomas auprès de lui. Il mourut ainsi plein de joie, et appelant de tous ses vux le moment de sortir de cet exil. Il m'est apparu quelquefois depuis, dans une très grande gloire, et m'a révélé diverses choses. C'était un homme de si haute oraison que, dans les derniers temps de sa maladie, voulant s'en distraire à cause de son extrême faiblesse, il ne le pouvait, tant ses ravissements étaient fréquents. Il m'écrivit même, un peu avant sa mort, pour me demander par quels moyens il pourrait les prévenir, parce qu'en achevant de dire la messe, il entrait malgré lui en extase, et y demeurait très longtemps. Enfin, Dieu lui donna la récompense des grands services qu'il lui avait rendus pendant toute sa vie. J'ai également connu par vision quelques-unes des grâces extraordinaires que Notre Seigneur faisait au recteur de la compagnie de Jésus dont j'ai plusieurs fois fait mention (Gaspar de Salazar); mais, pour ne pas trop m'étendre, je n'en parlerai point ici; je dirai seulement ce qui m'arriva à une époque où ce père avait une croix pesante à porter; il se trouvait en butte à une grande persécution, et son affliction était extrême. Un jour, en entendant la messe, je vis, au moment où l'on élevait la sainte hostie, Notre Seigneur Jésus-Christ en croix. Il me dit certaines paroles de consolation pour les lui rapporter; il en ajouta d'autres, par lesquelles je devais le prévenir de ce qui devait encore arriver, et lui mettre sous les yeux ce que le divin Maître avait souffert pour lui, afin de l'engager à se préparer à la souffrance. Cela lui donna beaucoup de consolation et de courage: et l'événement confirma ensuite la vérité de tout ce que Notre Seigneur m'avait dit. Il m'a été révélé de grandes choses sur les religieux de l'ordre auquel appartient ce père, je veux dire la compagnie de Jésus, et sur l'ordre lui-même tout entier. Plusieurs fois je les ai vus dans le ciel, tenant en leurs mains des bannières blanches. Je le répète, j'ai vu, touchant ces religieux, d'autres choses extrêmement admirables. Aussi j'ai une grande vénération pour cet ordre, parce qu'ayant eu beaucoup de rapports avec ses membres, je reconnais que leur vie est conforme à ce que Notre Seigneur m'a dit d'eux. Tandis que j'étais un soir en oraison, Notre Seigneur commença par m'adresser quelques paroles qui retraçaient à mon souvenir les infidélités de ma vie. Elles me remplirent de confusion et de peine. Sans être prononcées d'un ton sévère, de telles paroles causent un regret et une douleur qui anéantissent; une seule nous est plus utile pour acquérir la connaissance de nous-mêmes, que plusieurs jours passés dans la considération de notre misère, parce qu'elles portent avec elles un caractère de vérité qu'il nous est impossible de nier. Le Sauveur me représenta alors les amitiés si vaines auxquelles je m'étais laissée aller: je devais regarder comme une grande grâce, me dit-il, qu'il permît à un cur qui avait fait un si mauvais mage de ses affections, de s'attacher à lui, et qu'il voulût bien le recevoir. D'autres fois, il me dit de me souvenir du temps où je semblais mettre mon honneur à aller contre le sien. Il me dit, en une autre circonstance, de me rappeler ce dont je lui étais redevable: lorsque je l'outrageais le plus, c'était alors qu'il m'accordait ses faveurs. Lorsque je commets des fautes, et elles ne sont pas en petit nombre, sa Majesté me les fait comprendre de telle sorte que j'en suis tout anéantie; comme j'en commets beaucoup, cela se renouvelle fréquemment. Il m'est arrivé quelquefois de chercher à me consoler dans l'oraison d'une réprimande qui m'avait été faite par mon confesseur; j'en recevais alors une seconde, auprès de laquelle la première n'était rien. Je reviens à ce que je disais. Notre Seigneur ayant mis sous mes yeux le tableau des infidélités de ma vie, je fondais en larmes, dans la pensée que je n'avais encore rien fait pour son service. Il me vint alors à l'esprit qu'il voulait peut-être me préparer par là à recevoir quelque grâce; car le plus ordinairement il choisit, pour m'accorder une faveur particulière, le temps où je viens de me confondre devant lui, sans doute pour me faire connaître plus clairement combien j'en suis indigne. Quelques instants s'étant écoulés, mon âme entra dans un tel ravissement, qu'elle me semblait avoir entièrement abandonné le corps; du moins, si elle vivait encore en lui, elle n'en avait nul sentiment. Je vis alors la très sainte humanité de Jésus-Christ, dans un excès de gloire où je ne l'avais point encore contemplée. Par une connaissance admirable et lumineuse, elle me fut représentée dans le sein du Père; à la vérité, je ne saurais dire de quelle manière elle y est. Il me parut seulement que, sans la voir, je me trouvais en présence de la Divinité. Mon âme en resta plongée dans un tel étonnement, que je passai, je crois, plusieurs jours sans pouvoir revenir à moi; il me semblait que j'avais sans cesse devant les yeux cette majesté du Fils de Dieu, mais ce n'était pas comme la première fois, je le comprenais bien. Pour brève que soit une si haute vision, elle se grave si profondément dans l'esprit, qu'elle ne saurait s'en effacer de longtemps; j'y trouvai à la fois de grandes consolations et de précieux avantages. J'ai eu trois autres fois la même vision; c'est, à mon avis, la plus sublime de toutes celles dont le Seigneur m'a favorisée. Ses effets sont admirables; il me semble qu'elle purifie merveilleusement l'âme, et enlève à la sensualité presque toute sa force; c'est comme une grande flamme, qui consume et anéantit tous les désirs de cette vie. Par la grâce de Dieu, je n'étais touchée de rien de mortel; mais la vanité des choses de la terre et le néant des grandeurs humaines m'apparurent dans un nouveau jour. C'est pour l'âme un enseignement admirable, qui élève ses désirs jusqu'à la vérité pure; il imprime en outre un inexprimable respect pour Dieu, fort différent de celui que nous pouvons acquérir par nous-mêmes ici-bas. L'âme ensuite ne peut voir sans effroi qu'elle ait osé offenser une si redoutable Majesté, et que qui que ce soit ait une pareille hardiesse. J'ai déjà fait observer que les avantages des visions et autres faveurs sont plus ou moins grands. Celle dont je parle en produit de merveilleux. Lorsqu'en allant communier je me souvenais de cette souveraine Majesté que j'avais vue, et considérais que cette même Majesté était présente au très saint Sacrement; quand surtout, ce qui arrivait souvent, Notre Seigneur daignait m'apparaître dans la sainte hostie, les cheveux se dressaient sur ma tête et je me sentais tout anéantie. O mon Seigneur, si dans ce sacrement vous ne couvriez votre grandeur d'un voile, qui oserait si souvent s'en approcher, pour unir une créature si souillée et sujette à tant de misères à une si haute Majesté! Soyez béni, Seigneur! Que les anges et toutes les créatures vous louent de ce que vous vous accommodez de telle sorte à notre infirmité, que vous nous laissez goûter de si étonnantes faveurs, sans nous effrayer par votre suprême Puissance! Son éclat nous ôterait la hardiesse d'en jouir, tant notre faiblesse et notre misère sont grandes. Si vous en agissiez autrement, pourrait en être de nous comme dun laboureur, auquel je sais très certainement que la chose arriva ainsi. Ayant trouvé un trésor qui dépassait de beaucoup les basses pensées de son esprit il eut un tel chagrin de ne savoir à quoi l'employer, que la tristesse le conduisit lentement au tombeau. Si, au lieu de se voir soudainement possesseur de tout ce trésor, il eût seulement reçu de temps en temps quelque partie de sa valeur, il eût pourvu par là à son entretien, il se serait estimé plus heureux qu'au temps de sa pauvreté, et il ne lui en aurait pas coûté la vie. Mais vous, Seigneur, richesse des pauvres, que vous savez admirablement pourvoir aux besoins des âmes, en leur découvrant peu à peu vos trésors, sans leur en montrer d'abord toute la grandeur! Lorsque je contemple une si haute Majesté cachée dans une si petite hostie, j'admire vraiment une sagesse si profonde. Non, je n'aurais point le courage, je ne pourrais prendre sur moi de mapprocher ainsi du Seigneur, si aux grandes grâces dont il n'a cessé de me combler, il n'ajoutait celle de soutenir ma faiblesse; je ne pourrais également ni concentrer en mon cur ce que j'éprouve, ni m'empêcher de publier à haute voix de si étonnantes merveilles. Que doit donc éprouver une misérable comme moi, chargée d'abominations, dont la vie sest passée avec si peu de crainte de Dieu, au moment de s'unir à ce souverain Seigneur, les jours où il veut que mon âme le voie dans sa majesté! Comment ma bouche, qui l'a offensé par tant de paroles, ose-t-elle s'approcher de ce corps infiniment glorieux, et où tout respire une pureté, une bonté divine? Ah! pour l'âme autrefois infidèle, l'effroi qu'inspire une Majesté si haute n'est rien auprès du regret et de la douleur qu'elle éprouve, en lisant sur ce visage d'ineffable beauté tant de tendresse et de douceur. Mais qu'ai-je dû sentir, deux fois témoin de ce que je vais rapporter! Certes, mon Seigneur et ma gloire, je ne crains pas de l'affirmer: dans ces grandes douleurs de mon âme, j'ai, d'une certaine manière, fait quelque chose pour votre service. Mais que dis-je? Je ne le sais plus; ce n'est presque plus moi qui parle en écrivant ceci; je me sens troublée, et comme hors de moi par de tels souvenirs. O mon Seigneur, j'aurais eu raison de dire que j'avais fait quelque chose pour vous, si ce sentiment venait de moi; mais puisque je ne puis avoir une bonne pensée si vous ne me la donnez, vous ne devez m'en garder aucune reconnaissance; de mon côté se trouve la dette, et c'est vous, Seigneur, qui êtes l'offensé. Une fois, en allant communier, je vis des yeux de l'âme, plus clairement que je n'aurais fait des yeux du corps, deux démons d'une figure horrible qui serraient avec leurs cornes la gorge du pauvre prêtre, et je vis en même temps, dans l'hostie qu'il était prêt à me donner, Notre Seigneur Jésus-Christ avec cette majesté dont je viens de parler: ce qui me fit connaître que mon Dieu était dans des mains criminelles, et que cette âme était en état de péché mortel. Quel spectacle, ô mon Sauveur, de voir votre divine beauté au milieu de ces abominables figures, et ces démons saisis d'un tel effroi et d'une telle stupeur devant vous, qu'ils auraient soudain pris la fuite si vous le leur eussiez permis! Dans le trouble extrême qui s'empara de moi, je ne sais comment j'eus la force de communier. J'étais également agitée d'une crainte très vive: il me semblait que si cette vision venait de Dieu, il n'aurait pas permis que je visse le mauvais état de cette âme. Mais Notre Seigneur me dit de prier pour elle; il ajouta qu'il avait permis cette vision pour me faire comprendre la force des paroles de la consécration, et comment, quelque mauvais que soit le prêtre qui les profère, il ne laisse pas d'être présent sur l'autel. C'était aussi afin que je visse l'excès de sa bonté, qui le porte à se mettre entre les mains même d'un ennemi, et cela pour mon bien et pour le bien de tous. Je compris l'obligation où sont les prêtres d'être plus vertueux que les autres, ce qu'il y a de terrible dans la réception indigne d'un sacrement si saint, et le grand pouvoir du démon sur une âme qui est en péché mortel. J'en retirai la plus grande utilité, et une connaissance plus intime de ce que je dois à Dieu. Qu'il soit béni à jamais! Voici un autre fait dont j'ai été témoin, et qui me causa une étrange épouvante. Dans un endroit où je me trouvais, mourut une personne qui avait, durant plusieurs années, fort mal vécu, comme je l'ai appris, mais qui, toujours malade les deux dernières années de sa vie, paraissait s'être amendée en quelque chose. Elle mourut sans confession; mais à cause de ce que je viens de dire, je ne croyais pas qu'elle se damnerait. Or, pendant qu'on l'ensevelissait, je vis un grand nombre de démons qui prirent ce corps, qui paraissaient s'en amuser, le maltraitaient, et à l'aide de grands crocs le traînaient de côté et d'autre, ce qui me causa une extrême frayeur. Au moment où on le portait en terre avec l'honneur et les cérémonies accoutumées, j'admirai la grande bonté de Dieu, qui ne permettait pas que cette âme fût déshonorée, ni que l'on sût qu'elle était son ennemie. J'étais tout interdite de ce qui venait de frapper mes regards. Je n'aperçus aucun démon durant l'office; mais quand on mit le corps dans la fosse, j'en vis une grande multitude qui étaient dedans pour le recevoir. Je fus comme hors de moi à ce spectacle, et il ne me fallut pas peu de courage pour ne rien laisser paraître au dehors. Je considérais en moi même à quelles tortures ces esprits de ténèbres livreraient l'âme dont ils traitaient ainsi le malheureux corps. Plût au Seigneur que tous ceux qui sont en mauvais état, vissent de leurs yeux comme moi une scène si épouvantable! elle les exciterait puissamment, me semble-t-il, à embrasser une meilleure vie. Je connus alors de plus en plus combien j'étais redevable à Dieu, et de quel malheur il m'avait délivrée. Quant à la crainte qui m'avait saisie, elle dura jusqu'à ce que j'en eusse parlé à mon confesseur; il me venait en pensée que c'était peut-être un artifice de l'esprit ennemi pour déshonorer cette personne, qui, du reste, ne passait pas pour avoir beaucoup de religion. Ce qui est vrai, c'est que ce malheur n'ayant été que trop réel, jamais je ne m'en souviens sans que l'effroi s'empare de mon âme. Puisque j'ai commencé à parler de visions touchant les morts, je veux faire connaître les lumières que Dieu m'a données sur quelques âmes. Mais, pour abréger, je ne rapporterai qu'un petit nombre de faits; d'ailleurs, il ne me paraît ni nécessaire ni utile d'en dire davantage. On m'annonça la mort d'un religieux qui avait été jadis provincial de cette province, et qui l'était alors d'une autre; j'avais eu des rapports avec lui, et il m'avait rendu de bons offices. Il était, au reste, orné de bien des vertus. Néanmoins cette nouvelle me causa un grand trouble; j'étais inquiète pour le salut de son âme, parce qu'il avait été durant vingt ans supérieur, et je crains toujours beaucoup pour ceux qui ont rempli ces fonctions: avoir charge d'âmes me semble une chose extrêmement périlleuse. Je m'en allai fort triste à un oratoire; là, je conjurai Notre Seigneur d'appliquer à ce religieux le peu de bien que j'avais fait en ma vie, et de suppléer au reste par ses mérites infinis, afin de tirer son âme du purgatoire. Pendant que je demandais cette grâce avec toute la ferveur dont j'étais capable, je vis, à mon côté droit, cette âme sortir du fond de la terre, et monter au ciel avec une grande allégresse. Bien que ce père fût fort âgé, il m'apparut sous les traits d'un homme qui n'avait pas encore trente ans, et avec un visage tout resplendissant de lumière. Cette vision, fort courte dans sa durée, me laissa inondée de joie. Dès ce moment, il me fut impossible de partager la douleur de plusieurs autres personnes, qui regrettaient en lui un ami extrêmement cher. La consolation qui remplissait mon âme était si grande, que je n'avais plus de peine de sa mort; en outre, je ne pouvais concevoir aucun doute sur la vérité de ce que javais vu; je comprenais clairement que ce n'était pas une illusion. Il n'y avait pas alors plus de quinze jours qu'il avait cessé de vivre. Je ne laissai pas de demander des prières pour lui, et d'en offrir aussi à Dieu. A la vérité, je ne pouvais plus y apporter la même ardeur; car, lorsque le Seigneur m'a ainsi fait voir une âme s'élevant au ciel, il me semble que prier pour elle, c'est vouloir donner l'aumône à un riche. Comme j'étais séparée par une grande distance de l'endroit où ce serviteur de Dieu avait fini ses jours, je n'appris qu'après un certain temps les particularités de sa mort édifiante: tous ceux qui en furent témoins ne purent voir sans admiration la connaissance qu'il garda jusqu'au dernier moment, les larmes qu'il versa, et les sentiments d'humilité dans lesquels il rendit son âme à Dieu. Une religieuse de ce monastère, grande servante de Dieu, était décédée il n'y avait pas encore deux jours. On célébrait l'office des morts pour elle dans le chur une sur lisait une leçon, et j'étais debout pour dire avec elle le verset. A la moitié de la leçon, je vis l'âme de cette religieuse sortir du même endroit que celle dont je viens de parler, et s'en aller au ciel. Cette vision fut purement intellectuelle, tandis que la précédente s'était présentée aux yeux de mon âme sous des images; mais l'une et l'autre laissent à l'âme une égale certitude. Dans ce même monastère venait de mourir une autre religieuse, à l'âge de dix-huit ou vingt ans. Au milieu de continuelles maladies, elle s'était montrée vraie servante de Dieu, zélée pour l'office divin et la pratique de toutes les vertus. Je ne doutais point qu'après tant de souffrances, elle n'eût plus de mérites qu'il ne lui en fallait pour être exempte du purgatoire. Cependant, tandis que j'assistais aux heures, avant qu'on la portât en terre, et environ quatre heures après sa mort, je vis son âme sortir également de terre et aller au ciel. Un jour où j'endurais, comme il m'arrive de temps en temps, ces grandes souffrances de corps et d'esprit qui me mettent dans l'impuissance d'avoir la moindre bonne pensée, je me trouvais dans l'église d'un collège de la compagnie de Jésus. Un frère de cette maison était mort la nuit même, et je le recommandais à Dieu comme je pouvais. Tandis que j'entendais une messe qu'un père de la Compagnie disait pour lui, j'entrai dans un profond recueillement, et je vis ce religieux monter au ciel, tout éclatant de gloire, et accompagné de Notre Seigneur. Je compris que c'était par une faveur particulière que le divin Maître le conduisait ainsi lui-même au séjour des bienheureux. Un très bon religieux de notre ordre était malade à l'extrémité. Pendant la messe, étant profondément recueillie, je le vis rendre l'esprit et monter au ciel sans entrer au purgatoire; et j'ai appris depuis qu'il était mort à l'heure même où j'avais eu cette vision. Je fus étonnée de ce qu'il n'avait point passé par le purgatoire; mais il me fut dit qu'ayant été très fidèle observateur de sa règle, il avait bénéficié des bulles de l'ordre touchant le purgatoire . J'ignore à quelle fin cela me fut dit; ce fut sans doute pour me faire comprendre que ce n'est pas l'habit qui fait le religieux, mais que, pour jouir des biens d'un état aussi parfait, il faut en accomplir fidèlement tous les devoirs. Je pourrais rapporter un très grand nombre de visions de ce genre dont il a plu au Seigneur de me favoriser; mais, n'en voyant pas l'utilité, je me borne à ce qui a été dit. Seulement je ferai observer que, parmi tant d'âmes, je n'en ai vu que trois aller droit au ciel sans passer par le purgatoire: celle de ce religieux dont je viens de parler, celle du saint frère Pierre d'Alcantara, et celle de ce père dominicain plus haut mentionné (Pierre Ybañez) Le Seigneur a aussi daigné me faire voir la place de quelques unes de ces âmes dans le ciel, et les degrés de gloire dont elles jouissent. L'inégalité de cette gloire est fort grande. Chapitre 39 Une personne à qui j'avais de l'obligation ayant presque entièrement perdu la vue, j'en fus si affligée, que je suppliai avec importunité Notre Seigneur de la lui rendre; je craignais toutefois que mes péchés ne me rendissent indigne d'être exaucée. Cet adorable Sauveur mapparut alors comme il l'avait fait tant d'autres fois, me montra la plaie de sa main gauche, et en tira avec sa main droite un grand clou dont elle était percée. Il me semblait que le clou emportait en même temps la chair. Je fus émue de la plus tendre compassion, en songeant à l'excès de douleur que devait endurer mon divin Maître. Il me dit de ne point douter qu'après avoir souffert cela pour mon amour, il ne fit à plus forte raison ce que je lui demandais. Il me promit d'exaucer toutes mes prières, sachant bien que je ne solliciterais rien que pour sa gloire; il allait donc m'accorder la faveur que j'implorais. Il me dit encore de considérer que dans le temps même où je ne le servais pas, il avait toujours exaucé mes demandes au delà de mes désirs; combien plus le ferait-il maintenant qu'il était sûr de mon amour: je ne devais pas avoir de doute là-dessus. Huit jours, je crois, ne s'étaient pas écoulés, que Notre Seigneur rendit la vue à cette personne, et l'on se hâta d'en porter la nouvelle à mon confesseur. Il se peut que cette guérison ne fût pas due à mes prières; quant à moi, néanmoins, après cette vision, je ne pus en douter, et j'en remerciai le divin Maître comme d'une grâce qu'il m'avait accordée. Une autre fois, quelqu'un était en proie à une maladie très douloureuse, je ne sais laquelle; voilà pourquoi je ne la spécifie pas ici. Depuis deux mois il souffrait des douleurs intolérables, et son tourment était tel qu'il se déchirait lui-même. Le père recteur dont j'ai parlé (Père Gaspar de Salazar), et qui me confessait alors, le visita et en eut tant de compassion, qu'il me commanda d'aller le voir, des liens de parenté m'autorisant à le faire. Je me rendis donc auprès du malade, et demeurai si touchée de le voir en cet état, que je demandai instamment à Notre Seigneur de vouloir lui rendre la santé. Je vis clairement que ma prière avait été exaucée, puisque dès le lendemain il ne sentit plus aucune douleur. Sachant qu'une personne, à qui j'avais beaucoup d'obligation, avait pris une détermination qui blessait à la fois l'honneur de Dieu et le sien, j'en fus profondément affligée; pour comble de peine, je ne voyais pas le moyen de la faire renoncer à son dessein, et il semblait n'y en avoir aucun. Je suppliai Dieu très instamment d'y apporter remède, mais avec un chagrin que le changement seul de cette personne pouvait adoucir. Dans cet état, je me retirai dans un ermitage fort solitaire (car il y en a de tels en ce couvent); c'était celui où lon a peint Jésus-Christ attaché à la colonne . Là, tandis que je le suppliais de m'accorder cette grâce, jentendis une voix très douce qui ressemblait à un agréable sifflement. Mon effroi fut d'abord si grand, que les cheveux se dressèrent sur ma tête; j'aurais voulu saisir d'une manière distincte ce que cette voix me disait, ce fut impossible, elle cessa trop tôt de se faire entendre. Mais bientôt, la crainte faisant place au calme, au bonheur, au plaisir intérieur, je ne pouvais assez admirer comment le son d'une voix (car je l'entendis des oreilles du corps), et d'une voix dont je ne déglinguai point les paroles, pouvait produire un si étonnant effet dans mon âme. Je connus par là que ma prière était exaucée, et je me sentis aussi libre de toute peine que si j'eusse vu à l'instant même cette personne renoncer à son dessein, comme elle y renonça, en effet, peu après. J'en rendis compte à mes confesseurs; car jen avais deux à cette époque, fort savants et grands serviteurs de Dieu. Une personne qui était résolue de servir Dieu, et qui, depuis peu de temps, s'adonnait à l'oraison et y recevait de grandes grâces, l'avait abandonnée, à cause de certaines occasions fort dangereuses dont elle ne voulait point s'éloigner. J'en ressentis une peine très vive, parce que je l'aimais beaucoup, et je le lui devais bien. Durant plus d'un mois, je crois, je ne fis que supplier le Seigneur de ramener cette âme à lui. Enfin, étant un jour en oraison, je vis près de moi un démon qui déchirait avec un grand dépit certains papiers qu'il avait entre les mains. Je jugeai par là que Dieu avait exaucé ma prière, et j'en eus une joie extrême. De fait, j'appris ensuite que cette personne s'était confessée avec une grande contrition, et était sincèrement revenue à Dieu. J'espère de son infinie bonté qu'il lui fera la grâce de s'avancer toujours de plus en plus dans son service. Qu'il soit béni de tout! Amen. Je pourrais rapporter une infinité d'exemples de pareilles grâces que le Seigneur a accordées à mes prières, soit en retirant des âmes de l'état du péché, soit en faisant avancer les unes dans le chemin de la perfection, soit en délivrant les autres du purgatoire, soit enfin en opérant en leur faveur des prodiges non moins signalés. Mais le nombre de ces grâces est tel, que je ne pourrais en faire le récit sans fatiguer celui qui le lirait et sans me fatiguer moi-même. Je ferai observer que j'ai bien plus souvent obtenu la guérison des âmes que celle des corps. C'est, au reste, une chose si connue, que plusieurs personnes peuvent en rendre témoignage. Dans le principe, c'était pour moi un grand sujet de scrupule, parce que, tout en regardant ces grâces comme un pur effet de la bonté du Seigneur, je ne pouvais m'empêcher de croire qu'il les accordait à mes prières. Mais maintenant elles sont en si grand nombre, et connues de tant de personnes, que cette croyance ne me cause plus de peine. Je bénis mon divin Maître de tant de bienfaits, et j'en suis toute confuse; mais plus je me vois redevable à son égard, plus aussi je sens croître mon désir de le servir et s'enflammer mon amour pour lui. Voici ce qui me surprend le plus: ma prière a-t-elle pour objet des choses que le Seigneur voit ne pas convenir, je ne puis, malgré mon désir et tous mes efforts, les lui demander que faiblement, presque sans zèle et sans ardeur. Quant à celles que sa Majesté doit accorder, je vois que je peux les lui demander souvent, et même avec grande importunité; sans aucun souci de ma part, la pensée s'en présente d'elle-même à mon esprit. Il existe entre ces deux manières de demander une différence si grande, que je ne sais comment l'expliquer. Car, lorsque je sollicite les unes, bien qu'elles me touchent de près et que j'y emploie tous mes efforts, ce n'est point avec ferveur, mais comme une personne qui, ayant la langue liée, essaie en vain de parler, ou qui parle de telle sorte qu'elle connaît bien qu'on ne l'entend pas. Quand je demande les autres, je suis au contraire comme une personne qui parle distinctement,,et avec vivacité, à une autre dont elle se voit écoutée avec plaisir. Je puis encore, ce me semble, comparer la première manière à l'oraison vocale, et la seconde à cette contemplation élevée, où Notre Seigneur se montre à nous de manière à nous faire sentir qu'il nous entend, qu'il agrée notre prière et se plaît à l'exaucer. Louange éternelle à ce Dieu qui nous donne tant, et à qui je donne si peu! Car que fait, ô mon divin Maître, une âme qui ne se consume pas tout entière pour votre service? Mais, hélas! que je suis loin, que je suis loin, je puis le dire mille fois encore, que je suis loin d'une pareille fidélité! La vue seule de ma négligence à remplir mes devoirs envers vous ne devrait-elle pas suffire, indépendamment de tant d'autres motifs, pour me faire souhaiter sortir de cet exil? Que d'imperfections je découvre en moi! Que je suis lâche dans votre service! En vérité, je voudrais parfois avoir perdu le sentiment, pour ne pas voir tout le mal qui est en moi. Que Celui qui en a le pouvoir daigne y apporter remède! Durant mon séjour chez cette dame dont j'ai parlé (Louise de la Cerda à Tolède) j'avais besoin de veiller continuellement sur moi, et de considérer sans cesse la vanité de toutes les choses de la vie. Que de fois la grande estime dont j'étais l'objet, et les louanges qu'on me prodiguait, auraient pu incliner mon âme vers la terre, si je me fusse seulement regardée moi-même! Mais j'avais l'il fixé sur Celui qui voit tout dans la vérité, et je le suppliais de me soutenir de sa main. Cela me rappelle le martyre qu'endurent les âmes à qui Dieu a fait connaître la vérité, lorsque le devoir les contraint à s'occuper des choses d'ici-bas, où elle est, selon que Notre Seigneur me le dit un jour, couverte d'un épais voile. j'avais besoin de veiller continuellement sur moi, et de considérer sans cesse la vanité de toutes les choses de la vie. Que de fois la grande estime dont j'étais l'objet, et les louanges qu'on me prodiguait, auraient pu incliner mon âme vers la terre, si je me fusse seulement regardée moi-même! Mais j'avais l'il fixé sur Celui qui voit tout dans la vérité, et je le suppliais de me soutenir de sa main. Cela me rappelle le martyre qu'endurent les âmes à qui Dieu a fait connaître la vérité, lorsque le devoir les contraint à s'occuper des choses d'ici-bas, où elle est, selon que Notre Seigneur me le dit un jour, couverte d'un épais voile. Je le ferai, du reste, observer en passant: beaucoup de choses consignées ici ne sont pas tirées de ma tête; elles m'ont été dites par ce Maître céleste. Ainsi, l'on doit se souvenir que toutes les fois que je me sers de ces expressions: Jentendis ces paroles, ou Notre Seigneur me dit ceci, je me ferais un très grand scrupule d'y ajouter ou d'en retrancher une seule syllabe. Mais lorsque je n'ai pas un souvenir précis de ce qu'il m'a dit, je parle comme de moi-même, parce qu'il peut y avoir quelque chose du mien. A vrai dire, il n'y a rien de bon qui m'appartienne, puisque Dieu me l'a donné sans mérite de ma part. J'appelle donc mien ce qu'il ne m'a pas fait connaître par une révélation. Mais hélas! ô mon Dieu, comment nous arrive-t-il si souvent d'apprécier selon nos faibles vues, je ne dis pas les choses de ce monde, mais les choses spirituelles elles-mêmes, et d'en porter un jugement bien éloigné de la vérité? Nous mesurons, par exemple, notre avancement spirituel sur les années marquées par quelque exercice d'oraison, comme si nous voulions poser des limites à Celui qui, quand il veut, prodigue ses faveurs sans mesure, et peut en six mois plus enrichir une âme qu'une autre en plusieurs années. J'en ai vu des preuves en tant de personnes, que je ne comprends pas comment on peut en douter. Celui qui a reçu de Dieu le don du discernement des esprits et une véritable humilité, ne s'y trompera pas. Éclairé d'en haut, il juge de l'avancement des âmes par les effets, par leur résolution de servir Dieu, et par leur amour pour lui. Voilà ce qu'il considère, et non le nombre des années, persuadé qu'une âme peut faire en six mois plus de progrès dans la vertu que d'autres en vingt ans. Le Seigneur, je le répète, accorde ses dons à qui il veut, et j'ajouterais volontiers, à qui se dispose le mieux à les recevoir. J'en vois une preuve admirable dans ces jeunes filles de qualité qui entrent maintenant dans ce monastère. A peine Notre Seigneur les a-t-il éclairées de sa lumière et embrasées des premières étincelles de son amour, en commençant à leur faire goûter les douceurs de sa grâce, que sans délai elles sont venues se donner à lui. N'ayant nul souci des nécessités corporelles, elles semblent mépriser leur vie même, en s'enfermant pour toujours dans une maison sans revenus. Abandonnant tout pour Celui dont elles se savent aimées, elles ne veulent plus avoir de volonté propre, et n'ayant pas même la pensée qu'elles puissent éprouver un moment de déplaisir dans une clôture si austère, elles s'offrent toutes à l'envi en sacrifice pour Dieu. Que je reconnais volontiers l'avantage qu'elles ont sur moi! et quelle ne devrait pas être ma honte en la présence de Dieu! Il y a tant d'années que je fais oraison et qu'il me comble de ses grâces; cependant, il n'a pu encore obtenir de moi ce qu'avec de moindres faveurs il a obtenu de ces âmes généreuses dans l'espace de trois mois, et d'une d'entre elles dans l'espace de trois jours. Il est vrai qu'il récompense admirablement leur fidélité. Aussi n'ont-elles point de regret d'avoir tout abandonné pour lui. Rappelons, je le veux bien, pour nous confondre, nos longues années d'oraison ou de vie religieuse, mais gardons-nous d'inquiéter ces âmes qui ont fait en peu de temps de si admirables progrès, en les obligeant à retourner en arrière pour suivre la lenteur de notre pas. Ne prétendons point que ces aigles, à qui le souffle de la grâce a fait prendre leur essor, n'aillent pas plus vite qu'un petit oiseau qui aurait les pieds liés. Adorons plutôt avec humilité la manière dont Notre Seigneur les conduit; et tandis qu'elles s'élèvent si haut, ne craignons pas que Celui qui les comble de grâces, les laisse tomber dans l'abîme. Fortes des vérités de la foi, ces âmes se confient entièrement en Dieu; et pourquoi ne les lui abandonnerions-nous pas de même? Pourquoi vouloir les mesurer à notre faiblesse et à notre peu de courage? Non, cela ne doit pas être. Et puisque, n'étant pas arrivés au même état, nous ne pouvons comprendre les héroïques déterminations que la grâce fait naître en elles, humilions-nous, mais ne les condamnons pas. En paraissant nous intéresser à leur progrès spirituel, nous négligerions le nôtre; ce serait perdre une excellente occasion que nous présente Notre Seigneur, de nous confondre devant lui à la vue de nos défauts, et de reconnaître combien ces âmes doivent l'emporter sur nous en détachement et en union avec Dieu, puisque sa divine Majesté se communique à elles d'une manière si intime. J'aime, je le déclare, une oraison qui en très peu de temps embrase l'âme de cet amour fort, qui seul peut la déterminer à tout abandonner, dans l'unique vue de plaire à Dieu; et puisque celle dont je viens de parler produit cet effet, je la préfère, quoiqu'elle soit de fraîche date, à ces oraisons qui, après plusieurs années, ne nous portent à rien entreprendre de, grand pour la gloire de Dieu: à moins que nous ne regardions comme de grands effets de la grâce, et une véritable mortification, ces petites choses, menues comme des grains de sel, n'ayant ni poids ni volume, et qu'un oiseau enlèverait, ce semble, avec son bec. Nous voir faire cas d'actes de ce genre, accomplis pour Dieu, ces actes fussent-ils même nombreux, vraiment c'est une pitié. C'est à moi surtout que convient cette honte, à moi qui oublie en outre à tout moment les grâces que j'ai reçues. Je ne prétends pas nier néanmoins que Notre Seigneur, dans sa bonté infinie, ne nous tienne grand compte de ces petites choses; mais comme elles ne sont rien, je ne voudrais ni leur accorder quelque estime, ni même m'apercevoir que je les fais. Pardonnez-moi, mon cher Maître, et ne m'imputez pas à faute si par là je cherche à me consoler un peu de mon inutilité dans votre service. Si j'accomplissais pour vous de grandes choses, je ne ferais aucun cas de ces riens. Qu'heureuses sont les personnes qui vous glorifient par de grandes uvres! Si l'envie que je leur porte et le désir que j'ai de les imiter peuvent être comptés pour quelque chose, je les suivrais, ce me semble, de bien près. Mais mes uvres sont de nulle valeur: c'est à vous, Seigneur, de leur en donner, puisque vous me portez tant d'amour. Je rapporterai à ce sujet ce que j'éprouvai un de ces jours. Le bref de Rome qui nous autorisait à vivre sans revenus étant arrivé, la fondation de ce monastère se trouvait complètement terminée. Il semble qu'elle m'avait bien coûté quelque chose; aussi je goûtais une grande consolation en la voyant ainsi achevée. Songeant aux travaux que j'avais soufferts, et remerciant Notre Seigneur de la grâce qu'il m'avait faite de se servir un peu de moi, je me mis devant les yeux tout ce qui s'était passé dans cette affaire. Je vis que ce que je paraissais avoir fait de bien était mêlé de fautes et d'imperfections; souvent j'avais montré peu de courage, et plus souvent encore peu de foi; car, jusqu'à cette heure, où je vois l'accomplissement de tout ce que Notre Seigneur m'avait dit de la fondation du monastère, je n'avais pu gagner sur moi de le croire avec une foi absolue; et d'un autre côté, je ne pouvais pas non plus en douter. Je ne sais comment allier ces deux contraires: regarder une chose comme impossible, et conserver en même temps une ferme assurance de son succès. Enfin, trouvant que tout ce qu'il y avait eu en cela de bien venait de Notre Seigneur, et que tout ce qu'il y avait eu de mal venait de moi, je me hâtai de détourner ma pensée d'un tel objet; et je serais heureuse de ne m'en souvenir jamais, afin de n'être pas attristée par la vue de tant de fautes. Béni soit Celui qui, quand il lui plait, sait tirer du bien des fautes mêmes! Amen. Je disais qu'il est dangereux de compter ses années d'oraison; car, bien qu'on soit humble, l'on doit toujours craindre de se complaire dans la pensée d'avoir mérité quelque chose. Ce n'est pas que je veuille dire que l'on n'ait rien mérité, et que l'on ne doive en être bien récompensé; Mais je tiens pour certain que toute personne qui, dans les voies spirituelles, se flattera d'avoir, par plusieurs années d'oraison, mérité des faveurs si relevées, n'arrivera point au comble de la perfection. Ne lui suffit-il pas que, pour prix de ses efforts, Dieu l'ait soutenue de sa main, et préservée des offenses où elle tombait avant de faire oraison? Faut-il encore qu'elle lui intente procès pour ses propres deniers, comme on dit? Selon moi, ce n'est pas ainsi qu'agit une âme profondément humble: je puis me tromper, mais enfin, je trouve une grande témérité dans cette conduite, et quoique j'aie bien peu d'humilité, je n'ai jamais osé en venir là. Cela peut venir, je l'avoue, de ce que je n'ai jamais servi Dieu comme je le devais; si je l'avais mieux servi, j'aurais été peut-être plus empressée que toute autre à lui en demander le paiement. Je ne nie pas qu'une âme qui, pendant plusieurs années, persévère humblement dans l'oraison, ne fasse des progrès, et que Dieu ne lui accorde des faveurs; je dis seulement qu'elle ne doit point se souvenir de ces années. Que sont, en effet, tous nos misérables services, en comparaison d'une goutte du sang adorable versé pour nous par le divin Maître? Et s'il est vrai que plus nous le servons, plus nous lui sommes redevables, quelle n'est pas notre folie d'entrer en compte avec un Dieu qui, pour un maravédi que nous lui payons, nous donne en retour mille ducats! Laissons là, je vous en supplie au nom de son amour, ce calcul qu'il n'appartient qu'à lui de faire. Les comparaisons sont odieuses, même dans les choses d'ici-bas; et à combien plus forte raison dans celles dont lui seul peut être juge. Le divin Sauveur ne nous l'a-t-il pas clairement enseigné, quand il a donné le même salaire aux derniers venus qu'aux premiers? A cause de mon peu de loisir (car j'en manque souvent, je l'ai déjà dit), j'ai écrit ces trois feuilles en tant de jours, et à tant de reprises, que j'ai oublié une vision dont j'allais parler: la voici. Etant en oraison, je me vis seule dans une vaste campagne, environnée d'une multitude de gens d'aspects divers, armés, me semblait-il, de lances, d'épées, de dagues, d'estocs fort longs, et prêts à m'attaquer. Impossible de fuir d'aucun côté sans m'exposer à la mort; j'étais seule, sans personne pour me défendre. Dans cet excès de détresse, je ne savais que faire. Levant les yeux vers le ciel, je vis Jésus-Christ, non dans le ciel, mais bien haut dans l'air, au-dessus de moi; il me tendait la main et me couvrait de sa protection, en sorte que ma crainte s'évanouit, et cette multitude, malgré sa furie, n'avait plus le pouvoir de me faire aucun mal. Cette vision, qui paraît sans utilité, me fut néanmoins très avantageuse; elle me fit connaître ce qui devait m'arriver. Car peu après, m'étant trouvée presque dans cet état, je reconnus que Dieu avait voulu me montrer un tableau du monde. Là, en effet, tout semble armé contre la pauvre âme; je ne parle pas de ceux qui ne sont pas fidèles à Dieu, ni des honneurs, des richesses, des plaisirs, ni de tant d'autres adversaires qui manifestement nous tendent des pièces et tâchent de nous y entraîner, si nous ne sommes pas sur nos gardes; mais je parle des amis mêmes, des parents, et, ce qui m'étonne le plus, des personnes les plus vertueuses. A quelque temps de là, tous me combattant à l'envi croyant bien faire, je me vis tellement pressée de toutes parts, que je ne savais ni comment me défendre ni que devenir. O mon Dieu! Si je rapportais en particulier tout ce que j'endurai alors, indépendamment de ce que j'ai dit déjà, quelle souveraine horreur un pareil récit ne nous donnerait-il pas du monde! Ce fut, selon moi, la plus grande des persécutions auxquelles j'aie été en butte dans ma vie. Souvent j'étais tellement accablée de toutes parts, que mon unique remède était de lever les yeux au ciel, et d'appeler Dieu à mon secours. Ce qui m'avait été montré dans cette vision était parfaitement présent à mon souvenir, et me servit beaucoup pour ne mettre ma confiance dans aucune créature, mais en Dieu, qui seul est stable. Durant le cours de cette grande tribulation, mon divin Maître, selon qu'il me l'avait montré dans cette vision, m'envoya toujours quelqu'un qui venait comme de sa part me tendre la main. Ainsi, ne m'appuyant sur aucune créature, je ne songeais qu'à contenter le Seigneur. Vous en avez agi de la sorte, ô mon Dieu, pour soutenir ce commencement de vertu qui était en moi, et qui ne consistait qu'en un sincère désir de vous servir. Soyez-en à jamais béni! Étant un jour dans une inquiétude et un trouble extrêmes, loin de pouvoir me recueillir et de sentir en moi ce détachement qui m'est ordinaire, je voyais mon esprit se porter à des pensées imparfaites. Je souffrais un véritable combat et comme un déchirement intérieur. La vue de cet excès de misère me fit appréhender que les grâces dont j'avais été comblée ne fussent des illusions, et mon âme se trouva obscurcie par d'épaisses ténèbres. Lorsque j'étais en cette peine, Notre Seigneur, daignant m'adresser la parole, me dit de ne point m'affliger; qu'en me voyant de la sorte, je devais comprendre dans quelle misère je tomberais s'il s'éloignait de moi. Il ajouta que nous ne pouvons être en assurance tant que nous vivons dans cette chair mortelle. Il m'éclaira en ce moment sur les avantages et le mérite de cette guerre et de ces combats intérieurs, auxquels il réserve une si belle récompense. Il me sembla également qu'il nous portait compassion, à nous qui sommes encore en ce monde. Il me dit ensuite que je ne devais pas croire qu'il m'eût oubliée; que jamais il ne m'abandonnerait; mais qu'il voulait que, de mon côté, je fisse tout ce qui dépendrait de moi. A ces paroles, prononcées avec beaucoup de tendresse et d'amour, le divin Maître daigna en ajouter d'autres qui étaient pour moi le comble de la faveur; je ne vois aucune raison de les rapporter. Voici celles qu'il me dit souvent en me témoignant beaucoup d'amour: « Désormais tu es mienne, et moi je suis tien. » Je lui réponds toujours, et avec vérité, ce me semble, par celles-ci: Y a-t-il pour moi, Seigneur, quelque chose hors de vous? Lorsque je considère qui je suis, ces paroles et ces caresses de mon Dieu me jettent dans une indicible confusion; et j'ai besoin, comme je l'ai déjà remarqué et le dis quelquefois à mon confesseur, de plus de force pour recevoir de telles grâces, que pour porter les plus, grandes croix. Dans ces moments, le souvenir de mes bonnes uvres est comme effacé; mes imperfections sont seules devant moi, et mon esprit, sans avoir besoin de discourir, les embrasse d'un regard: ce qui me semble quelquefois surnaturel. De temps en temps, je me sens saisie d'un si ardent désir de communier, que nulles paroles ne sont capables de l'exprimer. Cela m'arriva un matin où la pluie, tombant par torrents, semblait m'interdire de faire un pas hors de la maison. Je sortis néanmoins, et je me trouvai bientôt tellement hors de moi par la véhémence de ce désir, que, quand on aurait dressé des lances contre ma poitrine, j'aurais passé outre; qu'on juge si la pluie pouvait m'arrêter! A peine arrivée à l'église, j'entrai dans un grand ravissement. Le ciel qui, les autres fois, ne s'était ouvert que par une porte, parut s'ouvrir à mes yeux dans toute son étendue: et alors, mon père, parut à ma vue le trône dont je vous ai parlé et que j'ai déjà vu d'autres fois. Au-dessus de ce trône j'en aperçus un autre, où, sans rien voir, et par une connaissance qui ne peut s'exprimer, je compris que résidait la Divinité. Ce trône était soutenu par certains animaux dont il me semble avoir entendu expliquer les figures, et je me demandai si c'étaient les évangélistes; mais je ne pus voir ni comment il était fait, ni qui y siégeait. Je vis seulement une grande multitude d'anges, qui me semblèrent incomparablement plus beaux que ceux que j'avais vus auparavant dans le ciel. Je pensai que c'étaient des chérubins ou des séraphins, parce que leur gloire, comme je viens de le dire, l'emporte de beaucoup sur celle des autres; et ils paraissaient tout enflammés. La gloire dont je me sentis investie ne peut ni se dire ni s'écrire, et à moins de l'avoir éprouvé, on ne peut s'en former aucune idée. Je compris que tout le bien qu'on peut souhaiter se rencontrait là, et néanmoins je ne vis rien. Il me fut dit, par qui, je l'ignore, que ce qui était alors uniquement en mon pouvoir était de comprendre que je ne pouvais rien comprendre, et de considérer comment toutes choses ne sont qu'un pur néant en comparaison de ce bien invisible. La vérité est qu'à partir de cette époque mon âme était remplie de confusion, à la pensée qu'elle était capable de s'arrêter à quelque chose de créé, et plus encore de s'y affectionner, le monde ne me paraissant qu'une fourmilière. J'assistai à la messe et je communiai, mais je ne saurais dire comment je fus durant tout ce temps; car il me parut très court, et je fus extrêmement surprise de voir, quand l'horloge sonna, que j'avais été deux heures dans ce ravissement et dans cette gloire. Ce feu du véritable amour de Dieu qui vient d'en haut est tellement surnaturel, qu'avec tous mes désirs et mes efforts, je ne saurais en obtenir une seule étincelle, si le divin Maître, comme je l'ai dit ailleurs, ne me l'accorde en pur don. Je ne pouvais ensuite me lasser d'admirer comment, lorsque l'âme s'en approche, il semble consumer le vieil homme avec toutes ses imperfections, ses langueurs et ses misères, et le fait en quelque sorte renaître de ses cendres, comme je l'ai lu du phénix. L'âme ne paraît plus la même, tant elle a changé de désirs et acquis de vigueur; ainsi transformée, elle marche dans le chemin du ciel avec une pureté toute nouvelle. Comme je suppliais le divin Maître qu'il en fût ainsi pour moi, afin que je pusse commencer à le servir, il me répondit: « La comparaison que tu viens d'employer est très juste; prends bien garde de ne pas l'oublier, afin qu'elle t'excite à faire sans cesse de nouveaux efforts pour devenir plus parfaite ». Dans un de ces moments où j'étais dans ce même doute dont j'ai parlé naguère, si ces visions venaient de Dieu, Notre Seigneur m'apparut et me dit d'un ton sévère: « O enfants des hommes, jusqu'à quand aurez vous le cur dur? » Il ajouta que je ne devais examiner en moi qu'une chose: était-il vrai, oui ou non, que je me fusse entièrement donnée à lui? Si je m'étais donnée toute à lui, ce qui était vrai, je devais croire qu'il ne me laisserait point me perdre. Cette exclamation par laquelle il avait commencé à me parler m'ayant extrêmement touchée, il me dit, avec beaucoup de tendresse et de douceur, de ne point m'affliger; j'étais, il le savait bien, prête à tout pour son service; aussi m'accorderait-il tout ce que je lui demanderais (et de fait, il m'accorda ce que je lui demandais alors); je n'avais qu'à voir ce continuel accroissement de mon amour pour lui, il était la preuve que ces visions ne venaient point du démon; je ne devais pas croire que Dieu permît à cet esprit de ténèbres d'exercer un tel empire sur les âmes de ses serviteurs. « Non, continua-t-il, il n'est pas en son pouvoir de donner cette lumière de l'esprit et ce calme profond dont tu jouis. » Il me fit comprendre aussi que tant de personnes, surtout d'un tel caractère, m'ayant assuré que ces faveurs venaient de Dieu, je ferais mal de ne pas le croire. Un jour, tandis que je récitais le symbole qui commence par ces mots: Quicumque vult, Notre Seigneur me fit entendre de quelle manière un seul Dieu est en trois personnes, et me le fit voir si clairement, que jen demeurai tout à la fois extrêmement surprise et consolée. Cela me servit beaucoup pour mieux connaître la grandeur de Dieu et ses merveilles; et comme, lorsque je pense à la très sainte Trinité, ou que j'en entends parler, je comprends comment les trois adorables Personnes ne font qu'un seul Dieu, j'en éprouve un inexprimable contentement. Un jour de l'Assomption de Notre-Dame, il plut à Notre Seigneur de me montrer dans un ravissement comment cette Reine des anges était montée au ciel, avec quelle joie et quelle solennité elle y avait été reçue, et la place qu'elle y occupait. Mais rapporter comment cela se passa, c'est ce qui m'est impossible; tout ce que je puis en dire, c'est que la vue d'une telle gloire en faisait rejaillir une très grande sur mon âme. Cette grâce produisit en moi les plus heureux effets: elle me donna une soif plus insatiable des souffrances, et un désir plus ardent de servir cette Souveraine, élevée par ses mérites à un tel comble de gloire. Me trouvant dans l'église d'un collège de la compagnie de Jésus, je vis un dais fort riche sur la tête des frères de ce collège, quand ils recevaient la communion; cela m'est arrivé deux fois, et je ne le voyais point quand d'autres personnes communiaient. Chapitre 40 Un jour, inondée dans l'oraison de délices excessives, et me réputant indigne d'une telle faveur, je considérai à combien plus juste titre je méritais la place qui m'avait été montrée dans l'enfer, et dont la vue, comme je l'ai dit, ne s'efface jamais de mon souvenir. Cette pensée m'enflamma d'une nouvelle ardeur, et j'entrai dans un ravissement que je ne puis exprimer. Abîmée et absorbée dans cette Majesté que j'avais vue d'autres fois, je connus une vérité qui est la plénitude de toutes les vérités. Je ne saurais dire comment cela se fit, parce que je ne vis rien. J'entendis alors ces paroles, sans voir qui les proférait, mais comprenant que c'était la Vérité elle-même: « Ce que je fais pour toi en ce moment n'est pas peu, c'est une des plus grandes faveurs dont tu me sois redevable; car tous les malheurs qui arrivent dans le monde viennent de ce que l'on n'y connaît pas clairement les vérités de l'Ecriture, dans laquelle il n'est pourtant pas un point qui ne doive s'accomplir. » Il me semblait que je l'avais toujours cru ainsi, et que tous les fidèles le croyaient de même; mais il me fut dit: « Ah! ma fille, qu'il y en a peu qui m'aiment véritablement! S'ils m'aimaient, je ne leur cacherais pas mes secrets. Sais tu ce que c'est que de m'aimer véritablement? C'est de bien comprendre que tout ce qui ne m'est pas agréable n'est que mensonge. Cette vérité que tu ne comprends pas maintenant, tu l'entendras clairement un jour par le profit qu'en retirera ton âme. » J'ai vu, en effet, l'accomplissement de ces paroles. Le Seigneur en soit béni! Depuis lors, je ne, saurais dire jusqu'à quel point je découvre la vanité et le mensonge de tout ce qui ne tend pas au service de Dieu, ni jusqu'où va ma compassion pour ceux qui demeurent dans une obscurité profonde à l'égard de cette vérité. J'en tirai plusieurs autres avantages; je ne vais en rapporter que quelques-uns, parce que, pour le plus grand nombre, les termes me manquent absolument. Notre Seigneur me dit dans ce ravissement une parole de tendresse très particulière; j'ignore comment cela se passa, car je ne vis rien; mais elle opéra en moi une transformation que je ne puis non plus expliquer. Je me sentis armée d'un courage invincible pour accomplir de tout mon pouvoir jusqu'aux moindres choses que l'Ecriture sainte nous ordonne. Il me semble qu'il n'y a rien au monde que je ne sois prête à souffrir pour cela. Une connaissance de cette divine Vérité s'imprima dans mon âme, sans que je puisse dire de quelle manière elle me fut représentée, ni ce qu'elle est en elle-même. Elle me pénétra d'un nouveau respect pour Dieu, me manifestant sa majesté et son pouvoir avec une lumière si vive qu'elle ne peut s'exprimer; on comprend seulement que c'est une chose admirable. Il me resta un ardent désir de ne jamais dire que des choses d'une entière vérité, et fort éloignées de celles dont on traite dans le monde; aussi, dès ce moment, ce fut pour moi une peine d'y vivre. D'autres fruits de cette vision furent une grande tendresse d'amour pour Dieu, une joie intime, une humilité profonde. Il me semble que sans que j'en connusse la manière, Notre Seigneur, par cette grâce, m'enrichit de grands biens; de plus, j'étais sans la moindre crainte qu'il y eût de l'illusion. Je ne vis rien, mais je connus combien il est avantageux de n'estimer que ce qui nous approche de Dieu; je compris ce que c'est pour une âme que de marcher dans la vérité en présence de la Vérité même: et Notre Seigneur me fit connaître qu'il est lui-même cette Vérité. Toutes ces lumières me furent communiquées tantôt par des paroles, et tantôt sans paroles, mais d'une manière encore plus claire. J'entendis sur cette Vérité de très sublimes vérités, que ne m'auraient pas enseignées plusieurs docteurs réunis: non, jamais ils n'auraient pu, ce me semble, les imprimer si profondément en mon âme, ni me faire voir d'une manière si claire la vanité de ce monde. Cette Vérité qui daigna alors se montrer à moi, est en soi-même vérité; elle est sans commencement et sans fin; toutes les autres vérités dépendent de cette Vérité, comme tous les autres amours de cet Amour, et toutes les autres grandeurs de cette Grandeur. Ce que j'en dis, je le sens, est obscur comparativement à la clarté avec laquelle Notre Seigneur daigna me le faire entendre. Oh! qu'il éclate admirablement le pouvoir de cette Majesté qui, en si peu de temps, enrichit de tant de biens, et laisse de si hautes vérités gravées dans l'âme! O Grandeur! ô Majesté que j'ose appeler mienne! Que faites-vous ô mon cher Maître? Dieu tout-puissant, considérez à qui vous accordez ces souveraines faveurs. Ne vous souvenez-vous donc plus que j'ai été un abîme de mensonges et un océan de vanités, et cela purement par ma faute? J'avais reçu de vous, Seigneur, un naturel qui abhorrait le mensonge, et en combien de choses néanmoins n'ai-je pas fait alliance avec lui! Tant d'amour et de bonté, ô mon Dieu, envers une âme qui en est aussi indigne, cela peut-il se souffrir, cela peut-il se concilier? Un jour, pendant que nous étions toutes réunies au chur pour les heures, j'entrai soudain dans un profond recueillement, et je vis mon âme sous la forme d'un clair miroir, sans revers, sans côtés, sans haut ni bas, mais resplendissant de toutes parts. Au centre m'apparaissait Notre Seigneur Jésus-Christ, comme il le fait d'ordinaire; je le voyais néanmoins dans toutes les parties de mon âme comme s'il s'y était réfléchi; et ce miroir de mon âme, à son tour, je ne puis dire comment, se gravait tout entier dans Notre Seigneur par une communication ineffable, mais toute pleine d'amour. Je puis affirmer que cette vision me fut très avantageuse, et qu'elle me fait encore le plus grand bien, toutes les fois que je me la rappelle, principalement après la communion. A l'aide de la lumière qui me fut donnée, je vis comment, dès que l'âme commet un péché mortel, ce miroir se couvre d'un grand nuage et demeure extrêmement noir; en sorte que Notre Seigneur ne peut s'y représenter ni y étre vu, quoiqu'il soit toujours présent comme donnant l'être. Quant aux hérétiques, c'est comme si le miroir était brisé; malheur bien plus considérable que s'il n'était qu'obscurci. Il y a une grande différence entre voir cela et le dire; on ne peut que difficilement faire comprendre une pareille chose. Je le répète, j'en ai retiré les plus précieux avantages; j'y ai trouvé aussi le sujet d'une extrême douleur, à la pensée des offenses par lesquelles j'ai si souvent obscurci mon âme et me suis privée de la vue d'un si bon Maître! Cette vision me paraît excellente pour apprendre aux personnes recueillies à considérer Notre Seigneur dans le plus intime de leur âme. Cette manière est plus attachante et plus utile que de le contempler hors de soi, comme je l'ai déjà dit ailleurs, d'accord sur ce point avec les livres sur l'oraison qui traitent de la manière de chercher Dieu. C'est en particulier l'avis du glorieux saint Augustin, qui dit de lui-même que cherchant Dieu dans les places publiques, dans les plaisirs, partout dans cet univers, il ne l'avait trouvé nulle part comme au dedans de son cur. L'avantage d'une pareille méthode est visible: elle nous fait trouver Dieu en nous-mêmes, sans qu'il soit nécessaire de nous élever par la pensée jusqu'au ciel, nous épargnant ainsi un effort qui fatigue l'esprit, distrait l'âme, et nous fait recueillir moins de fruit. Je veux ici faire une observation, qui pourra avoir son utilité pour quelques personnes. Il arrive, dans les grands ravissements, qu'au sortir de cette union avec Dieu, qui dure peu, comme je l'ai dit, et dans laquelle toutes les puissances sont suspendues et absorbées, l'âme demeure dans un tel recueillement, même à l'extérieur, qu'elle a de la peine à retourner à ses occupations ordinaires; la mémoire et l'entendement sont encore tellement égarés, qu'ils paraissent en proie à une sorte de délire. Ceci se produit quelquefois, surtout dans les commencements. Je me demande si cela ne procède pas de la faiblesse même de notre nature: comme elle ne peut supporter une action si forte de l'esprit, l'imagination, par contre-coup, se trouve affaiblie; je sais, du moins, que quelques personnes l'ont éprouvé de la sorte. Elles devraient alors se faire violence pour laisser l'oraison pendant quelque temps, avec dessein de la reprendre ensuite; parce qu'autrement la santé pourrait en être gravement altérée. On en voit assez d'exemples, pour se convaincre qu'il est de la prudence de regarder jusqu'où peuvent aller nos forces. Si l'expérience est nécessaire à une âme arrivée à cet état, un guide spirituel ne l'est pas moins; car elle devra le consulter sur bien des choses. Si, après en avoir cherché un, elle ne le trouve point, Notre Seigneur ne manquera pas de suppléer à ce défaut, puisque, malgré toute ma misère, il n'a pas laissé de m'assister en de semblables occasions. Les maîtres spirituels qui ont une connaissance expérimentale de choses si élevées sont, je crois, en petit nombre; et ceux qui ne l'ont pas tenteront en vain de donner le remède sans causer de l'inquiétude et de l'affliction; mais le divin Maître ne laissera pas de nous tenir compte d'une pareille épreuve. Aussi le meilleur est que le confesseur soit mis au courant de tout, et qu'il soit expérimenté, s'il est possible; je l'ai peut-être dit ailleurs; mais, ne m'en souvenant pas bien, je ne crains pas de le répéter, tant cela est important, spécialement pour les femmes. C'est une vérité que le nombre des femmes à qui Dieu fait de semblables faveurs, est beaucoup plus grand que celui des hommes: je l'ai entendu de la bouche même du saint frère Pierre d'Alcantara, et je l'ai vu de mes propres yeux. Ce grand serviteur de Dieu me disait que les femmes avançaient beaucoup plus que les hommes dans ce chemin, et il en donnait d'excellentes raisons qu'il est inutile de rapporter ici, mais qui étaient toutes en faveur des femmes.  Étant un jour en oraison, il me fut en un instant représenté de quelle manière toutes les choses se voient et sont contenues en Dieu. Je ne les apercevais pas sous leurs propres formes, et néanmoins la vue que j'en avais était d'une entière clarté: tenter de la décrire serait impossible. Elle est pourtant restée vivement empreinte dans mon âme. C'est une des grâces les plus insignes que le Seigneur m'ait faites, et qui m'ont le plus servi à m'humilier et à me confondre au souvenir des péchés que j'ai commis. Si le Seigneur eût daigné m'accorder plus tôt cette lumière, s'il l'eût accordée à ceux qui l'offensent, jamais ni eux ni moi n'eussions eu le cur et la hardiesse de l'outrager. Ce spectacle fut sous mes yeux, sans que je puisse affirmer pourtant avoir vu quelque chose. Cependant je devais voir quelque objet, puisque je vais pouvoir en donner une comparaison. Mais cette vue est si subtile et si déliée, que l'entendement ne saurait l'atteindre. Ou bien, c'est que je ne sais me comprendre moi-même dans ces visions qui semblent sans images. Pour quelques-unes, il doit y avoir jusqu'à un certain point des images; mais comme elles se forment dans le ravissement, les puissances ne peuvent plus, hors de cet état, ressaisir la manière dont Dieu leur montre les choses et veut qu'elles en jouissent. Étant un jour en oraison, il me fut en un instant représenté de quelle manière toutes les choses se voient et sont contenues en Dieu. Je ne les apercevais pas sous leurs propres formes, et néanmoins la vue que j'en avais était d'une entière clarté: tenter de la décrire serait impossible. Elle est pourtant restée vivement empreinte dans mon âme. C'est une des grâces les plus insignes que le Seigneur m'ait faites, et qui m'ont le plus servi à m'humilier et à me confondre au souvenir des péchés que j'ai commis. Si le Seigneur eût daigné m'accorder plus tôt cette lumière, s'il l'eût accordée à ceux qui l'offensent, jamais ni eux ni moi n'eussions eu le cur et la hardiesse de l'outrager. Ce spectacle fut sous mes yeux, sans que je puisse affirmer pourtant avoir vu quelque chose. Cependant je devais voir quelque objet, puisque je vais pouvoir en donner une comparaison. Mais cette vue est si subtile et si déliée, que l'entendement ne saurait l'atteindre. Ou bien, c'est que je ne sais me comprendre moi-même dans ces visions qui semblent sans images. Pour quelques-unes, il doit y avoir jusqu'à un certain point des images; mais comme elles se forment dans le ravissement, les puissances ne peuvent plus, hors de cet état, ressaisir la manière dont Dieu leur montre les choses et veut qu'elles en jouissent.
Je dirai donc que la Divinité est comme un diamant d'une transparence parfaite, et beaucoup plus grand que le monde; ou bien comme un miroir, semblable à celui où l'âme m'était montrée dans la vision précédente; seulement, c'est d'une manière si sublime que je n'ai point de termes pour l'exprimer. Chacune de nos actions se voit dans ce diamant, parce que rien ne saurait exister en dehors d'une grandeur qui renferme tout en soi. Mon étonnement fut au comble de voir, dans un espace de temps si court, tant de choses représentées dans ce diamant admirable, et je ne saurais me souvenir, sans une extrême douleur, des taches affreuses que mes péchés imprimaient dans cette lumineuse pureté. Oui, toutes les fois que ce souvenir vient s'offrir à ma pensée, je ne sais comment je n'y succombe pas. Aussi, après cette vision, j'étais tellement remplie de honte, que je ne savais en quelque sorte où me mettre. Oh! que ne m'est-il donné de communiquer une pareille lumière à ceux qui commettent des péchés déshonnêtes et infâmes, pour leur faire comprendre que leurs attentats ne sont point secrets, et que Dieu en est justement blessé, puisqu'ils sont commis sous ses yeux mêmes, et d'une manière si insultante pour une si haute Majesté! Je vis à combien juste titre on mérite l'enfer pour un seul péché mortel, tant est énorme et incompréhensible l'outrage qu'on fait à Dieu en le commettant en sa présence, et tant sa sainteté infinie repousse de tels actes. C'est aussi ce qui fait briller davantage sa miséricorde; car sachant que ces vérités sont connues de nous, il ne laisse pas de nous souffrir. Je me suis souvent dit: Si une telle vision imprime à l'âme tant de terreur, que sera-ce au jour du jugement, quand cette Majesté se montrera clairement à nous, et que nous verrons pleinement à découvert toutes nos offenses? O Dieu, quel aveuglement a donc été le mien! Souvent j'ai été saisie de frayeur, en pensant à ce que j'écris ici. Mon Père, vous n'en serez point étonné, ce qui doit uniquement vous surprendre, c'est qu'ayant ces lumières, et me regardant ensuite moi-même, je puisse encore vivre. Qu'il soit béni a jamais Celui qui m'a supportée avec tant de patience! J'étais un jour profondément recueillie dans l'oraison, y goûtant beaucoup de douceur et un calme très pur, lorsqu'il me sembla être environnée d'anges, et fort proche de Dieu. Je me mis à prier de toute mon âme pour les besoins de l'Eglise: sa divine Majesté me fit voir alors les grands services que devait rendre un certain ordre dans les derniers temps, et le courage, avec lequel les religieux de cet ordre devaient défendre la foi. Un autre jour, pendant que jétais en prière devant le très saint Sacrement, un saint, dont l'ordre était un peu déchu, m'apparut tenant en main un grand livre; l'ayant ouvert, il me dit d'y lire certaines paroles écrites en caractères grands et très distincts, et j'y lus ces mots: « Dans les temps à venir, cet ordre sera florissant; et il aura beaucoup de martyrs. » Une autre fois, étant au chur à matines, éclairée d'une semblable lumière, je vis devant moi six ou sept religieux tenant des épées en main: il me semble que ce pouvaient être des religieux de ce même ordre. Ces épées signifiaient, à mon avis, qu'ils sont appelés à défendre la foi. Car dans un autre ravissement, transportée en esprit dans une vaste plaine où se livrait un grand combat, je vis les relijeux de cet ordre combattre avec une grande ardeur. Leurs visages étaient beaux et tout en feu; ils renversaient à terre plusieurs de leurs ennemis, et en tuaient un grand nombre. Cette bataille me paraissait livrée contre les hérétiques. Ce glorieux saint m'est apparu un certain nombre de fois, et m'a dit plusieurs choses importantes. Il m'a témoigné me savoir gré des prières que je fais pour son ordre, et m'a promis de me recommander au Seigneur. Je ne désigne point les ordres dont je parle, de peur que d'autres ne s'en offensent; si Dieu veut qu'ils soient connus, il saura les faire connaître. Mais chacun des ordres religieux devrait s'efforcer de servir l'Eglise dans les grands besoins où elle se trouve de nos jours; et chacun des membres qui les composent devrait faire en sorte que ce fût par lui que le Seigneur accordât à son ordre un tel bonheur. Heureuses les vies qui se consumeraient pour une telle cause! Quelqu'un m'ayant priée de demander à Dieu qu'il voulût lui faire connaître s'il était de son bon plaisir qu'il acceptât un évêché, Notre Seigneur me dit après la communion: « Lorsqu'il aura compris et clairement reconnu que la vraie domination est de ne rien posséder, alors il pourra l'accepter »; me donnant à entendre que ceux qui sont élevés aux dignités de l'Eglise, doivent être très éloignés de les désirer, ou au moins de les rechercher. Telles sont les grâces que le Seigneur a accordées et accorde encore d'une manière presque continuelle à cette pécheresse. Je pourrais en rapporter un grand nombre d'autres. Je ne vois pas de raison de le faire, parce qu'on peut, d'après ce qui a été dit jusqu'à présent, comprendre l'état de mon âme et la manière dont il a plu à Dieu de me conduire. Qu'il soit béni à jamais d'avoir pris tant de soin de moi! Un jour, le Seigneur, voulant me consoler de mes peines, me dit avec beaucoup d'amour de ne point m'affliger, que les âmes en cette vie ne pouvaient être toujours dans le même état: tantôt je serais fervente et tantôt sans ferveur, tantôt dans la paix et tantôt dans le trouble et les tentations; mais je devais espérer en lui et ne rien craindre. Je me demandais un jour s'il n'y avait pas quelque attache, soit dans mon affection pour les maîtres spirituels de mon âme et tous les grands serviteurs de Dieu, soit dans la consolation que me causaient leurs entretiens. Notre Seigneur me dit que si un malade en danger de mort se voyait guéri par un médecin, ce ne serait pas en lui une vertu de ne pas témoigner de la reconnaissance à son bienfaiteur et de ne pas l'aimer: qu'aurais-je fait sans le secours de ces personnes? la conversation des bons ne nuit point; en ayant soin seulement que mes paroles fussent pesées et saintes, je devais continuer de traiter avec eux, loin de me nuire, leur entretiens seraient très utiles à mon âme. Ces paroles me consolèrent beaucoup; car souvent, de crainte de quelque attache, j'aurais souhaité n'avoir plus de rapports avec eux. C'est ainsi que Notre Seigneur m'assistait en tout de ses conseils, allant jusqu'à me dire de quelle manière je devais me conduire avec les faibles, et avec certaines personnes: enfin il ne cesse jamais de veiller sur moi. Il y a des temps où je ne puis sans douleur me voir si inutile pour son service, et contrainte de donner au soin d'un corps aussi faible et aussi infirme que le mien, plus de temps que je ne voudrais. Un soir, pendant que j'étais en oraison, l'heure du repos étant venue, je me trouvais assaillie de grandes douleurs, et le temps de mon vomissement ordinaire approchait. Me voyant enchaînée par la faiblesse du corps, et mon âme, d'un autre côté, demandant du temps pour elle, je sentis dans ce combat une telle affliction, que je me mis à répandre d'abondantes larmes. Cela m'est arrivé, non une fois seulement, mais bien souvent; je m'en veux alors à moi-même, et je me prends véritablement en horreur. Mais dans le cours ordinaire de la vie, je ne m'abhorre pas autant que je le devrais, et je ne manque pas de prendre les soins qui me sont nécessaires; et Dieu veuille que souvent je n'excède pas, comme j'ai sujet de le craindre. Tandis que j'étais dans cette angoisse que je viens de décrire, Notre Seigneur m'apparut; il me consola avec beaucoup de bonté, et me dit de prendre ces soins et d'endurer cette souffrance pour l'amour de lui; que ma vie était encore nécessaire. Ainsi, à dater du jour où je me suis déterminée à servir de toutes mes forces ce bon Maître ce tendre Consolateur, je ne me suis jamais trouvée, me semble-t-il, dans une peine véritable. Car s'il me laisse d'abord un peu souffrir, il me comble ensuite de tant de consolations, qu'en vérité je n'ai aucun mérite à désirer les souffrances. Il me semble que souffrir est la seule raison de l'existence, et c'est ce que je demande à Dieu avec le plus d'ardeur. Je lui dis quelquefois du fond de mon âme: Seigneur, ou mourir ou souffrir! je ne vous demande pas autre chose. Lorsque j'entends sonner l'horloge, c'est pour moi un sujet de consolation, à la pensée que je touche d'un peu plus près au bonheur de voir Dieu, et que c'est une heure de moins à passer dans cette vie. À cet état d'âme en succède néanmoins parfois un autre, où je ne sens ni peine de vivre ni envie de mourir. C'est une absence de ferveur, et je ne sais quel obscurcissement à l'égard de tout, qui peut provenir, comme je l'ai dit, des grandes souffrances que j'endure. Lorsque Notre Seigneur me dit, il y a quelques années, que son dessein était de rendre publiques les grâces dont il me favorisait, j'en éprouvai une peine, très sensible. Et de fait, comme vous le savez, mon père, je n'ai pas eu peu à souffrir jusqu'à ce moment, parce que chacun les interprète à sa façon. Mais ce qui me console, c'est qu'il n'y a point eu de ma faute; car j'ai eu un soin extrême de n'en parler qu'à mes confesseurs, ou à des personnes à qui je savais qu'ils en avaient eux-mêmes parlé: cette réserve, comme je m'en suis déjà expliquée, procédait moins de mon humilité, que de la peine excessive que je ressentais de les déclarer, même à mes confesseurs. Maintenant, quoique quelques-uns murmurent contre moi par un bon zèle, que d'autres appréhendent de me parler et même de me confesser, et que d'autres me fassent bien des observations, je n'en suis, grâce à Dieu, nullement émue. Voyant clairement que Notre Seigneur a voulu se servir de ce moyen pour ramener à lui beaucoup dâmes, et me souvenant de tout ce qu'il souffrirait lui-même pour une seule, je me mets fort peu en peine de tout ce que l'on peut dire et penser sur ce sujet. Peut-être suis-je redevable, jusqu'à un certain point, de cette liberté intérieure, à la retraite où je vis dans ce petit coin de terre. J'espérais, il est vrai, que le monde, pour qui j'étais comme morte, ne se souviendrait plus de moi; mais mon espérance n'a pas été entièrement réalisée, et, contre mon désir, je suis forcée de parler encore à quelques personnes. Néanmoins, comme on ne peut me voir, je me considère comme dans un port où la bonté de Dieu m'a jetée, et j'espère de sa miséricorde que j'y serai en sûreté. Vivant si loin du monde, avec une si petite et si sainte compagnie, je regarde de là comme d'une hauteur ce qui se passe dans ce monde, et je ne suis nullement touchée de l'opinion qu'on se forme de moi. Mais je le serai toujours extrêmement du moindre petit avantage que je pourrai procurer à une âme; et c'est le but où, par la grâce de Dieu, tendent tous mes désirs, depuis que je suis ici. Ma vie ne me semble en quelque sorte qu'un songe. Je ne vois en moi ni plaisir ni peine de quelque importance. Que si j'en éprouve de temps en temps, cela passe si vite, que j'en suis tout étonnée, et mon âme n'en est pas plus émue que d'un rêve. C'est la pure vérité; et quand je voudrais maintenant me réjouir ou m'attrister de quelque sujet particulier de plaisir ou de peine, ce serait pour moi chose aussi impossible qu'à une personne sage de concevoir de la joie ou du chagrin d'un songe qu'elle aurait eu. Notre Seigneur a daigné amortir en moi ces sentiments qui n'étaient autrefois si vifs que parce que je n'étais ni mortifiée, ni morte aux choses de ce monde. Plaise à sa divine Majesté que je ne retombe plus dans un pareil aveuglement! Voilà, mon père, la vie que je mène maintenant; demandez à Dieu pour moi, je vous en conjure, ou qu'il m'appelle à lui, ou qu'il me donne les moyens de le servir. Plaise à sa Majesté que cet écrit vous soit de quelque utilité! Faute de loisir, il m'a bien coûté quelque peine; mais quelle heureuse peine, si j'avais réussi à dire quelque chose qui fit louer Dieu une seule fois! Oh! que je me tiendrais pour bien payée, quand même, aussitôt après, vous devriez jeter mon écrit au feu! Je souhaiterais néanmoins qu'auparavant il fût examiné par les trois serviteurs de Dieu connus de vous, qui ont été et sont encore mes confesseurs. Si c'est mal, il est juste qu'ils perdent la bonne opinion qu'ils ont de moi; si c'est bien, savants et vertueux comme ils sont, ils sauront, j'en suis sûre, remonter au principe, et ils loueront Celui qui a daigné parler par moi. Je supplie Notre Seigneur de vous soutenir toujours de sa main, et de faire de vous un si grand saint, que, rempli de l'esprit et de la lumière d'en-haut, vous puissiez éclairer cette misérable créature, dépourvue d'humilité et pleine de hardiesse, qui a osé se résoudre à écrire des choses si relevées. Dieu veuille que je n'y aie point commis d'erreur; du moins, mon intention et mon désir ont été de bien faire, d'obéir, et de porter ceux qui liront ces pages à donner quelques louanges au Seigneur. Déjà, depuis plusieurs années, je lui demande instamment cette grâce; et comme les uvres me manquent, le désir de contribuer tant soit peu à sa gloire, m'a fait prendre la hardiesse de mettre en ordre le récit de ma vie désordonnée. Je n'y ai pas mis plus de soin ni de temps qu'il n'en était nécessaire pour l'écrire, disant ce qui s'est passé en moi avec toute la simplicité et toute la vérité dont j'étais capable. Daigne mon Dieu, qui est tout-puissant et qui peut, s'il le veut, m'accorder cette faveur, faire en sorte que j'accomplisse en tout sa volonté! Qu'il ne permette point la perte de cette âme, que son amour, au moyen de tant d'artifices et par tant de voies différentes, a si souvent arrachée à l'enfer et ramenée à lui! Amen. JHS Le Saint-Esprit soit toujours avec vous, mon père . Amen. Ce ne serait pas mal, je crois, de faire valoir à vos yeux l'obéissance que je vous ai rendue en écrivant ceci, afin de vous obliger par là à me recommander instamment à Notre Seigneur. Je le ferais, ce me semble, à bon droit, après tout ce que j'ai souffert en me voyant dépeinte dans ces pages, et en rappelant à mon souvenir mes innombrables misères. Néanmoins, je puis le dire avec vérité, j'ai ressenti plus de peine à écrire les grâces que le Seigneur m'a accordées, que les offenses que j'ai commises contre sa divine Majesté. J'ai fait ce que vous m'avez commandé, en donnant de l'étendue à cet écrit; mais, vous le savez, c'est à la condition que vous tiendrez votre promesse de déchirer ce qui ne vous paraîtra pas bien. Je n'avais pas encore achevé de le relire, quand on est venu le réclamer de votre part. Ainsi, vous pourrez y trouver quelques endroits où je me suis mal expliquée, et d'autres où je me serai répétée. J'ai eu si peu de temps pour ce travail, que je n'ai pu revoir à mesure ce que j'écrivais. Je vous supplie, mon père, de le corriger et de le faire transcrire, si on doit l'envoyer au père maître Avila (Bienheureux Jean d'Avila), de crainte qu'on ne reconnaisse mon écriture. Je désire ardemment que des mesures soient prises pour qu'il le voie, car je le commençai avec cette intention. S'il trouve que je suis en bon chemin, j'en demeurerai extrêmement consolée: ma tâche est maintenant terminée pour ce qui dépendait de moi. Quant à vous, mon père, disposez de tout ainsi que vous le jugerez à propos, et considérez que vous êtes obligé envers celle qui vous confie ainsi son âme. Tant que je vivrai, je recommanderai la vôtre à Notre Seigneur. Hâtez-vous donc de servir sa divine Majesté, pour pouvoir me venir en aide. Vous verrez dans cet écrit ce que l'on gagne à se donner tout entier, comme vous avez commencé de le faire, à Celui qui se donne à nous sans mesure. Qu'il soit béni à j aimais! J'espère de sa miséricorde que nous nous verrons un jour, vous et moi, là où nous connaîtrons mieux qu'ici-bas les grandes grâces qu'il nous a faites, et où nous le bénirons éternellement. Amen. Ce livre a été terminé au mois de juin de l'an 1562. Cette date se rapporte à la première relation, composée par la Mère Thérèse de Jésus, sans division de chapitres Plus tard elle fit cette transcription, en y ajoutant plusieurs choses survenues postérieurement à la date donnée ici, par exemple, la fondation du monastère de Saint-Joseph d'Avila, comme on petit le voir à la feuille 169. Frère Dominique BANÈS .
|